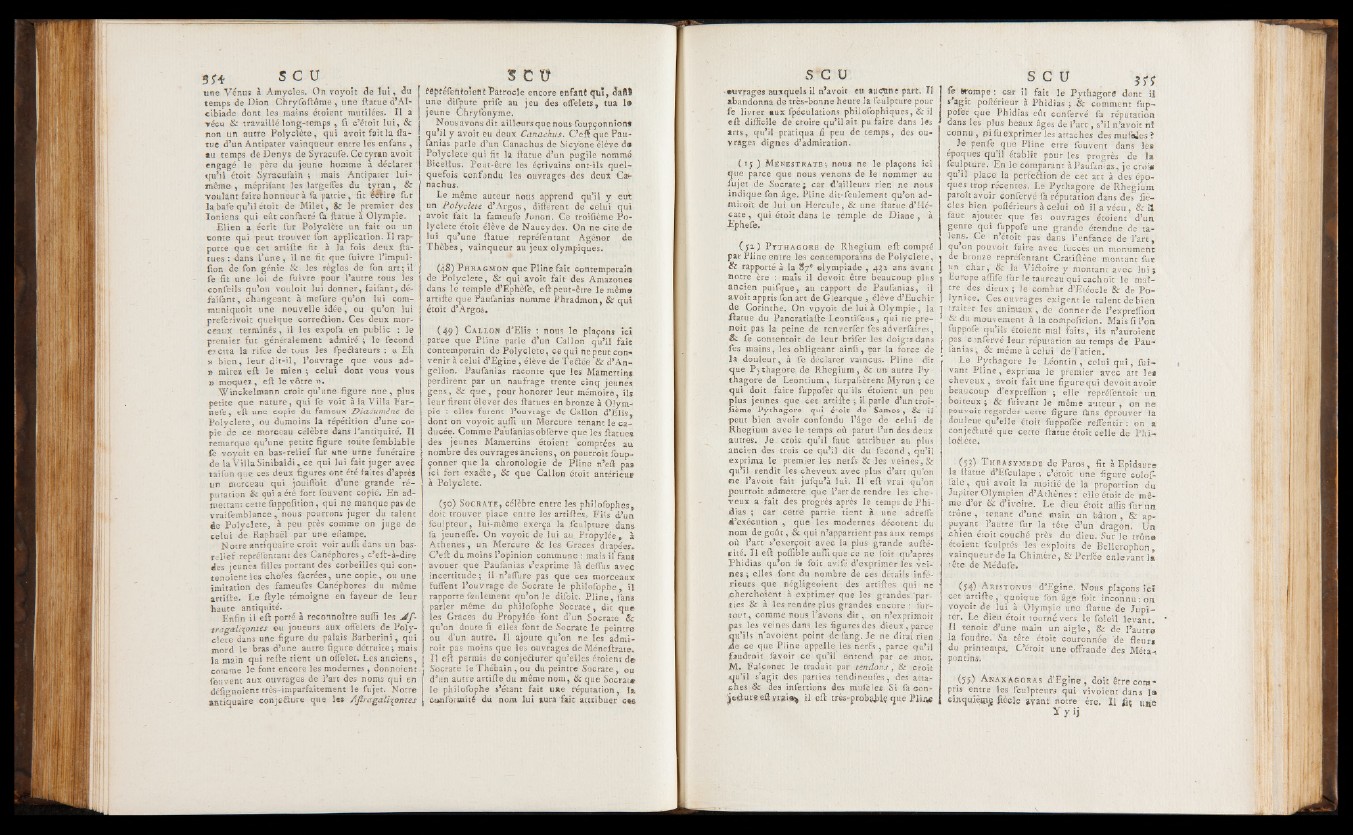
5 ^ 4 S C U
tine Vénus à Amycles. On voyoit de lu i , du
temps de Dion Chryfoftôme , une ftatue d’A lcibiade
dont les mains étoient mutilées. Il a
vécu & travaillé long-temps , fl c’étoit lu i, &
non un autre Polyclète, qui avoit fait la ila-
tue d’ un Antipater vainqueur entre les enfans ,
au temps de Denys de Syracufe. Ce tyran avoit
engagé le père du jeune homme à déclarer
qu’ il étoit Syracufain -, mais Antipater lui-
même , méprifant les largefi.es du tyran, &
voulant faire honneur à fa patrie , fit êèfire fur
labafe qu’ il étoit de Milet, èc le premier des
Ioniens qui eût confacr.é fa ftatue à Olympie.
Elien a écrit fur Polyclète un fait ou un
conte qui peut trouver fon application. Il rapporte
que cet artifte fit à la fois deux fta-
tues : dans l’u n e , il ne fit que fuivre l’impuL
fion de fon génie & les règles de fon art; il
fe fit une loi de fuivre pour l’autre tous les
confeils qu’on vouloit lui donner, faifant, dé-
fai fant, changeant à mefure qu’on lui com-
xnuniquoit une nouvelle idée, ou qu’on lui
prefcrivoit quelque correftion. Ces deux morceaux
terminés, il les expofa en public : le
premier fut généralement admiré ; le fécond
excita la rifte de tous les fpeftateurs : « Eh
» bien, leur d it-il, l’ouvrage que vous ad-
» mirez eft le mien ; celui dont vous vous
» moquez, eft le vôtre ».
Winckelmann croit qu’une figure nue, plus
petite que nature, qui fe voir à la V illa Far-
nefe, eft une copie du fameux Diadumène de
Polyclete, ou dumoins la répétition d’une copie
de ce morceau célèbre dans l ’antiquité. Il
remarque qu’une petite figure toute femblable
fe voyoit eh bas-relief fur une urne funéraire
de laVillaSinibald i, ce qui lui fait juger avec
i ai fon que ces deux figures ont été faites d’après
un morceau qui jouifioit d’une grande réputation
& qui a été fort fouvent copié. En admettant
cette fuppofition , qui ne manque pas de
vraifemblance, nous pourrons juger du talent
de Polyclete, à peu près comme on juge de
celui de Raphaël par une eflampe.
Notre antiquaire croit voir auflï dans un bas-
re lie f repréfentant des'Canéphcres , c’eft-à-dire
des jeunes filles portant des corbeilles qui con-
tenoient les çhôfes facrées, une copie, ou une
imitation des fameufes Canéphores du même
artifte. Le ftyle témoigne en faveur de leur
haute antiquité. -
Enfin il eft porté à reconnoître aufii les j l f -
trdgalï\ontes ou joueurs aux ofielets de Poly-
clete dans une figure du palais Barberini, qui
mord le bras d’une autre figure détruite; mais
la main qui refte tient un offelet. Les anciens,
comme le font encore les modernes, donnoient
fouvent aux ouvrages de l’art des noms qui en
défi^noient très-imparfaitement le fujet. Notre
antiquaire conjefture que le* Afiragali^ontes
S C Ü fôpféfefftoïefltPatrocle encore enfattt q\iï, cïafil
une difipute prife au jeu des ofielets, tua 1®
jeune Chrylonyme.
Nous avons dit ailleurs que nous-foimçonnionè
qu’ il y avoit eu deux Canachus. C’en que Pau-
fanias parle d’un Canachus de Sicyone élève de
Polyclete qui fit la ftatue d’un pugile nommé
Biceilus. Peut-être les écrivains ont-ils quelquefois
confondu les ouvrages des deu* Cat-
nachus.
Le même auteur nous apprend qu’il y eut
un Polyclete d’Argos, différent de celui qui
avoit fait la fameufe Junon. Ce troifième Polyclete
étoit élève de Naucydes. On ne-cite de
lui qu’ une ftatue repréfentant Agénor de
Thèbes, vainqueur au jeux olympiques.
(48) Phragmon que Pline fait contemporain
de Polyclete, & qui avoit fait des Amazone*
dans le temple d’Ëphèfe, eft peut-être le mémo
artifte que Paufanias nomme Phradmon, & qui
étoit d’Argos.
(4 9 ) Caiion d’Elis : nous le plaçons ici
parce que Pline parle d’un Cal Ion qu’il fait
contemporain de Polyclete, ce qui ne peut convenir
à celui d’E gine, élève de Teftée & d’An-
gelion. Paufanias raconte que les Mamertin*
perdirent par un naufrage trente cinq jeunes
gens, & q u e , pour honorer leur mémoire, ils
leur firent élever des ftatues en bronze à Olympie
: elles furent l ’ouvrage de Gallon d’Elis*
dont on voyoit aufti un Mercure tenant le caducée.
Comme Paufanias obferve que les ftatues
des jeunes Mamertins étoient comptées au
nombre des ouvrages anciens, on pourroit fbup-
çonner que la chronologie de Pline n’ eft pas
ici fort exafte, & que Callon étoit antérieur
à Polyclete.
(50) Socrate, célèbre entre les philofophes,
doit trouver place entre les artiftes, Fils d’un
fculpteur, lui-même exerça la fculpture dans
fa jeunefle. On voyoit de lui au Propylée, à
Athènes , un Mercure & les Grâces drapées.
C’eft du moins l’opinion commune : mais il fau*
avouer que Paufanias s’exprime là defliis avec
incertitude; il n’aflure pas que ces morceaux
fulTent l ’ouvrage de Socrate le philofophe, il
rapporte feulement qu’on le difoic. P line, fans
parler même du philofophe Socrate, dit que
les Grâces du Propylée font d’un Socrate &
qu’on doute fi elles font de Socrate fe peintre
ou d’un autre. Il ajoute qu’on ne les admi-
roit pas moins que les ouvrages de Méneftrate.
Il eft permis de conjefturer qu’elles étoient de
Socrate le Thébain , ou du peintre Socrate, ou
d’ un autre artifte dù même nom, & que Socrate
le philofophe s’étant fait une réputation, 1»
conformité du nom lui aura fait attribuer cas
s c u
•uvrages auxquels il n’avoit eu aucttne part. Il
abandonna de très-bonne heure la fculpture pour
fe livrer aux fpéculations philofophiques., & il
eft difficile de croire qu’ il ait pu faire dans les
arts, qu’ il pratiqua fi peu de temps, des ouvrages
dignes d’admiration.
( 1 5 ) Ménestrate; nous ne le plaçons ici
que parce que nous venons de le nommer au
fujet de Socrate $ car d ’ailleurs rien ne nous
indique fon âge. Pline dit* feulement qu’on ad-
miroi't de lui un Hercule, & une ftatue d’Hécate
, qui étoit dans le temple de Diane, à
Ephefe.
(52) Ptthagore de Rhegium eft compté
par Pline entre les contemporains de Polyclete,
& rapporté à la 87e olympiade , 431 ans avant
notre ère : mais il de voit être beaucoup plus
ancien puifque, au rapport de Paufanias, il
avoit appris fon art de Gîearque , élève d’Euchîr
de Corinthe. On voyoit de lui à Olympie, la
ftatue du Pancratiafte Leontifcus, qui ne pre-
noit pas la peine de renverfer fes adverfaires,
& fe contentoit de leur brifer les doigts dans
fes mains , les obligeant ainfi, par la force de
la douleur, à fe déclarer vaincus. Pline dit
que P)thagore de Rhegium, & un autre P y -
thagore de Leontium, lurpafsèrent Myron ; ce
qui doit faire fuppofer qu'ils étoient un peu
plus jeunes que cet artifte ; il parle d’ un troisième
Pythagore qui étoit de Samos , & il
peut bien avoir confondu l’âge de celui de
Rhegium avec le temps où parut l’ un des deux
autres. Je crois qu’ il faut attribuer au plus
ancien des trois ce qu’ il dit du fécond , qu’ il
exprima le premier les nerfs & les veines ,&
qu’il rendit les cheveux avec plus d’art qu’on
ene l’avoit fait jufqu’à lui. Il eft vrai qu’on
pourroit admettre que l’ art de rendre les cheveux
a fait des progrès après le temps de Phidias
; car cette partie tient à une adrefte
d’exécution , que les modernes décorent du
nom de goût, & qui n’appartient pas aux temps
où l’art s’exerçoit avec la plus grande aufté-
rité. Il eft poflible aufti que ce ne foit qu’après
Phidias qu’on fe foit avifé d’exprimer les veines
; elles font du nombre de ces détails inférieurs
que négîi.geoient des artiftes qui ne
„cherchoient à exprimer que les grandes.'par >
ti.es & à les rendre plus grandes encore: fur-
tout, comme nous l’avons d it, on n’exprimoit
pas les veines dans les figures des dieux, parce
qu’ils n’avoient point de fan g. Je ne dirai rien
de ce que Pline appelle^ les nerfs, parce qu’ il
faudroit favoir ce qu’i l entend par ce mot. 3VL. Falconet le traduit par tendons, & croit
qu’il s’agit des parties tendineufes, des attaches
& des infertions des mufcles. Si fa con-
’jefture eft yiai®^ il eft très-probablç que Pline
s c ü
fe trompe : car il fait le Pythagore dont il
s poftérieur à Phidias ; & comment fuppofer
que Phidias eût confervé fa réputation
dans les plus beaux âges de l’a r t , s’il n’avoit nî
connu , ni fu exprimer les attaches des mu foies ?
Je penfe que Pline erre fouvent dans les
époques qu il établit pour les progrès de la
fculpture. En le comparant à Paufanias, je croas
qu’ il place la perfeftion de cet art à des époques
trop récentes. Le Pythagore de Rhegium
paroît avoir confervé fa réputation dans des fie—
clés bien poftérieurs à celui où il a vécu, & il
faut ajouter que fes ouvrages étoient d’ un
genre qui fuppofe une grande étendue de ta-
lens. Ce n’étoit pas dans l’enfance de l’a r t,
qu’on pouvoit faire avec fuccès un monument
] de bronze repréfentant Cratiftène montant fur
] un char, & la Viftoire y montant avec lui 5
| Europe affife fur le taureau qui cachoit le maî-
I tre des dieux; le combat d’Etéocle & de Po-
) lynice. Ces ouvrages exigent le talent de bien.
I trs-ft-r les animaux, de donner de l’ expreflion
‘ & du mouvement à la compofition. Mais fi l’on
j fuppofe qu’ils étoient mal faits, ils n’ auroienc
r P2S c tnfervé leur réputation au temps de Pau-*
1 l'anias, & même à celui deTatien.
Le Pythagore le Léontin , celui q u i, fui-
vant P lin e , exprima le premier avec art le*
cheveux, avoit fait une figure qui devoit avoir
beaucoup d expreftion ; elle repréfentoit un
boiteux ; & fuivant le même auteur , on ne
pouvoit regarder cette figure fans éprouver la
douleur qu’elle etoit fuppofée reflentir : on a
conjefturé que cette ftatue étoit celle de P h i-
loftète*
(53) T hrasymede de Paros, fit à Epidaure
la ftatue d’Efculape ; c’étoit une figure coloft-
la ie , qui avoit la moitié de la proportion du
Jupiter Olympien d’Athènes t elle étoit de même
d’or & d’ ivoire. Le dieu étoit aflis fur un
trône , tenant d’uné main un bâton , & appuyant^
l’autre fur la tête d’un dragon, Un
-chien étoit couché près du dieu. Sur le trôn»
étoient fculptés les exploits de Bellerophon,
vainqueur de la Chimère, & Perfée enlevant la
tête de Médufe.
(54) Aristonus d’Egine. Nous plaçons ic i
cet artifte, quoique fôn âge (bit inconnu: on
voyoit de lui à Olympie une ftatue de Jupiter.
Le dieu étoit tourné vers le foleil levant.
Il tenoit d’une main un a ig le , & dé l ’autre
la foudre. Sa tête étoit couronnée de fleur*
du printemps, C ’étoit une offrande des Méta-,
pontins,
•(55) Anaxagoras d’Egine , doit être cora-
pris entre les fculpteurs qui vivotent dans 1»
cinquième flècle ayant notre èrq, I] ftç wae
y y ij