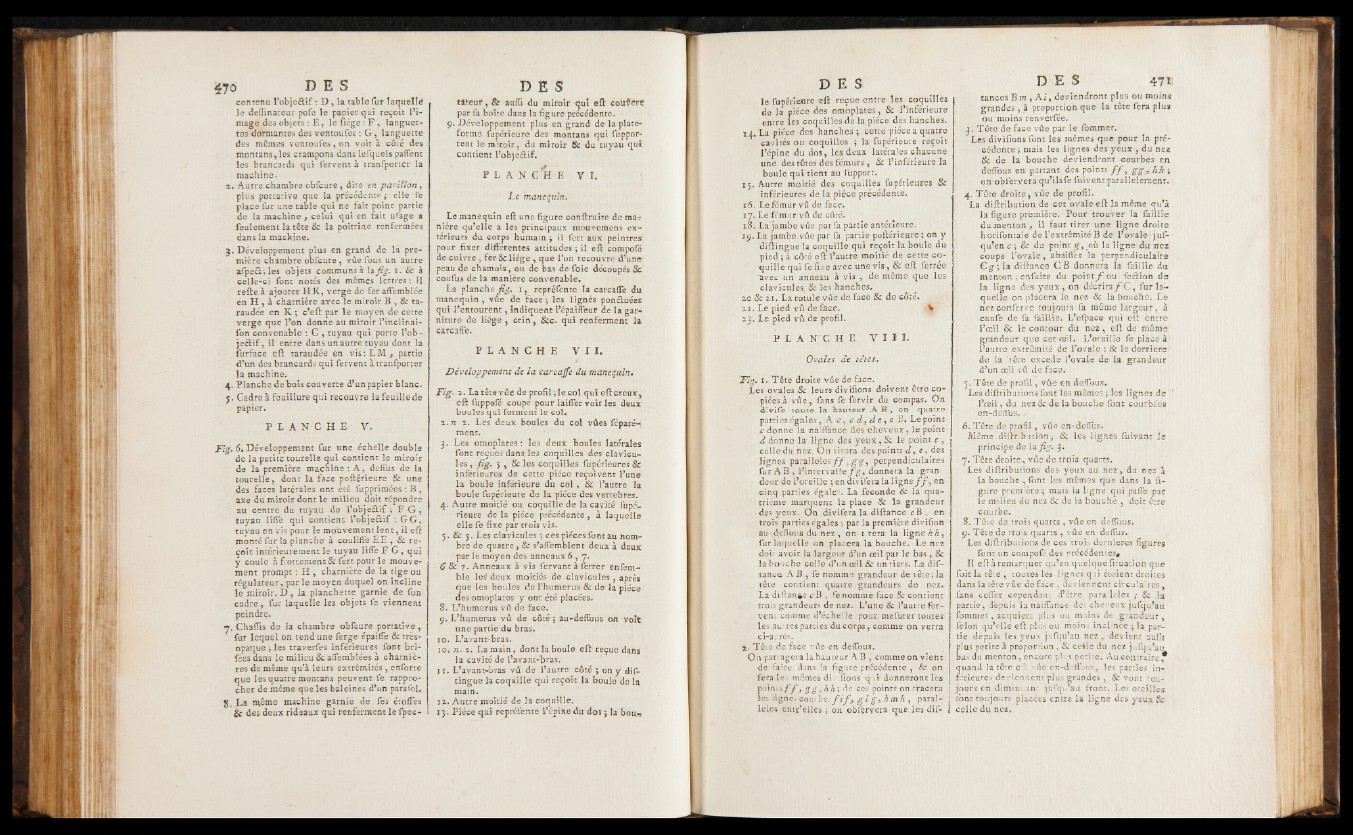
contenu l’o b jeôif : D , la table fur laquelle
le deffinateur pofe le papier qui reçoit l’ image
des objets : E , le fiége : F , languettes
dormantes des ventoufes : G , languette
des mêmes ventoufes, on voit à côté des
montans, les crampons dans lefquels paffent
les brancards qui fervent à tranfporter la
machine.
2, Autre chambre obfcure, dite en pavillon,
plus portative que la précédente ,* elle fe
place fur une table qui ne fait point partie
de la machine y celui qui en fait ufage a
feulement la tête & la poitrine renfermées
dans la machine.
g. Développement plus en grand de là première
chambre obfcure , vûe fous un autre
afpe&; les objets communs à la fig. i. & à
celle-ci font notés des mêmes lettres: il
refte.à ajouter H K , verge de fer affemblée
en H , à charnière avec le miroir B , & taraudée
en K ; c’eft par le moyen de cette
verge que l ’on donne au miroir l’inclinai-
fon convenable : C , tuyau qui porte l’ob-
je é l if , il entre dans un autre tuyau dont la
furface eft taraudée en v is :LM j partie
d’un des brancards qui fervent à tranfporter
la machine. 4. Planche de bois couverte d’ un papier blanc.
5. Cadre à feuillure qui recouvre la feuiflede
papier.
P L A N C H E - V .
Fier. 6, Développement fur une échelle double
de la petite tourelle qui contient le miroir
de la première machine : A , deflus de la
tourelle, dont la face poftérieure & une
des faces latérales ont été fupprimées : B ,
axe du miroir dont le milieu doit répondre
au centre du tuyau de l’o b je â i f -, F -G ,
tuyau liffe qui contient l’objectif : G G ,
tuyau en vis pour le mouvement len t, il eft
monté fur la planche à couliflè E E , & reçoit
intérieurement le tuyau liffe F G , qui
y coule à frottement & fe r t pour le mouvement
prompt : H , charnière de la tige ou
régulateur, par le moyen duquel on incline
le miroir. D , la planchette garnie de fon
cad re, fur laquelle les objets fe viennent
peindirq.
«7. Chaflis de la chambre obfcure portative,
fur lequel on tend une ferge épaiffe & très-
opaque ; les traverfes inférieures font bri-
fées dans le milieu & affemblées à charnières
de même qu’à leurs extrémités , enforte
que 1 es quatre montans peuvent fe rapprocher
de même que les baleines d’ un parafol.
8. L a même machine garnie de fes étoffes
& des deux rideaux qui renferment le fpectâteirt,
& aufli du miroir qui eft cou v re
par fa boîte dans la figure précédente.
9. Développement plus en grand de la plateforme
fupérieure des montans qui fuppor-
tent le miroir, du miroir & du tuyau qui
contient l’obje&if.
P L A N C H E T I.
Le manequin.
_ Le manequin eft une figure conftruite de ma;
nière qu’elle a les principaux mouvemens extérieurs
du corps humain ; il fert aux peintres
pour fixer différentes attitudes ; il eft compofé
de cuivre , fer & liège , que l ’on recouvre d’une
peau de chamois, ou de bas de foie découpés &
coufus de la manière convenable.
La planche ^/zg. 1 , repréfente la carcaffe du
manequin, vûe de face ; les lignés ponéhiées
qui l ’entourent, indiquent l’épaiffeur de la gar-<
niture de liège , c r in , & c. qui renferment la
carcaffe.
P L A N C H E V I I .
Développement de la carcajfe du manequin
Fig. z. La tête vûe de profil; le col qui eft creux,.'
eft fuppefé coupé pour laiffer voir les deux
boules qui forment le col.
2. n 2. Les deux boules du coi vûes fcparement.
3. Les omoplates : les deux boules latérales
font reçues'dans les coquilles des clavicules
, fig. 5 , & les coquilles fupérieures &
inférieures de cette 'pièce reçoivent l’une
la boule inférieure du c o l , 8c l’autre la
boule fupérieure de la pièce des vertebres.
4. Autre moitié ou coquille de la cavité fupérieure
de la pièce précédente, à laquelle
elle fe fixe par trois vis.
5. & 5. Les clavicules ; ces pièces font au nombre
de quatre, & s’ affemblent deux à deux
par le moyen des anneaux 6 , 7 .
6 8c 7. Anneaux à vis fervant à ferrer enfern-*
ble le£ deux moitiés de clavicules , après
que les boules de l’humerus & de la pièce
des omoplates y ont été placées.
8. L’humerus vû de face.
9. L’humerus vû de côté ; au-deffous on voit
une partie du bras.
10. L’avant-b ras.
10. n. 2. La main, dont la boule eft reçue dans
la cavité de l’avant-bras.
11. L’avant-bras vû de l’autre côté ; on y distingue
la coquille qui reçoit la boule de la
main.
12. Autre moitié de la ctoquille.
13. Pièce qui repréfente l ’épine du dos ; la bou,«,
le fupérieure eft reçu e en tre le s co q u ille s
d e la p ièce d es o m o p la te s, & l’in férieu re
en tre les c o q u ille s d e la p ièce d es h a n ch es.
1 4 . La p ièce d es h a n ch es ; cette-p ièce a quatre
ca v ités o u c o q u ille s ; la fupérieu re reço it
l ’ép in e du d o s, le s d eu x latérales ch a cu n e
u n e des têtes d es fém urs , & l’in férieu re la
b o u le q u i tie n t au liipport.
1 5 . A u tre m o itié des c o q u ille s fupérieu res &
in férieu res d e la p ièce p récéd en te.
1 6. L e rémur vû de face.
17* L e fém ur vû d e côté.
18. La jam be vûe par fa partie antérieu re.
19. La jam be v û e par fa partie poftérieure ; o n y
d iftin g u e la c o q u ille q u i reço it la b o u le du
p ie d ; à côté e ft l’au tre m o itié d e c e tte c o q
u ille q u i fe fix e a v ec u n e v is , & e ft ferrée
"avec un anneau à v is , d e m êm e q u e le s
c la v ic u le s & les h a n ch es.
20 & 21. L a rotu le v û e d e face & d e cô té .
2 2 . L e p ied v û d e fa c e . ^
2 3 . L e p ied v û d e profil.
P L A N C H E V I I I .
Ovales de têtes.
Fig. 1. T ê te d roite v û e de fa ce.
L es o v a les 8c leu rs d ivifio n s d o iv e n t être c o piées
à v û e , fan s fe fervir du com pas. On
d iv ife to u te la h auteur A B , en q u atre
parties é g a le s , A c , c d , d e , e B. L e p oin t
c d o n n e la n aiffance des c h e v e u x , le p o in t
d d on n e la - lig n e des y e u x , & le p o in t e ,
c e lle du n ez. O n tirera d es poin ts d y e , des
lig n e s p a rallèles f f y g g , perp en d icu laires
fur A B , l’in t e r v a lle /‘g , donnera la g ra n d
e u r d e l’o r e ille ; e n d iv ife ra la lig n e ƒ ƒ , en
c in q parties é g a le ’. La féco n d é 8c la quatrièm
e m arq u en t la p lace & la gran d eu r
des y eu x . O n d ivifera la d ifta n ce « B % en
trois parties é g a le s -, par la prem ière d ivifion
au--.de flou s du n ez , o n t rera la lig n e h h,
fur la q u e lle on placera la b o u ch e. L e n ez
doit avo ir la largeu r d’un oe il par le bas , &
la b o u c h e c e lle d’un oe il & un tiers. La d ifta
n ce A B , fe n om m e gran d eu r d e tê te ; la
tê te c o n tie n t quatre gran d eu rs d e n ez.
L a d ifta n ce <?B , fe nom m e face & co n tien t
trois grandeurs de n ez. L’u n e & l’autre ferv
en t com m e d’é c h e lle pour m efurer tou tes
le s autres parties du c o r p s, com m e o n verra
ci-après.
à . T ê te d e fa ce vû e en deffou s.
O n partagera la hauteur A B , com m e o n v ie n t
d e faire dans la fig u re précédence , & on
fera les m êm es d i fions qui- d o n n eron t les
points f f y g g . h h ; de ces points on tracera
le s lig n es coû t b e > f i f y g l gyhmhy parai- j
le le s en tr’e ile s ; on o b ieryera q u e le s d if- |
tances B m , A i , deviendront plus ou moins
grandes, à proportion que la tête fera plus
ou moins renverfée.
. 3. Tête de face vûe par le femme t.
Les divifions font les mêmes que pour la précédente
; mais les lignes des yeux , du nez
8c de la bouche deviendront courbes en
deffous en partant des points ƒ ƒ , g g y h h ;
on obl’ervera qu’ ils fe fuivent parallèlement.
4. Tête droite, vûe de profil.
La diftribution de cet ovale eft la même qu’à
la figure première. Pour trouver la faillie
du menton, il faut tirer une ligne droite
horifontale de l’extrémité B de l’ovale jufi-
qu’en c , 8c du point g , où la ligne du nez
coupe l ’o v a le , abaiffer la perpendiculaire
C g ; la diftance C B donnera la faillie du
menton ; enfuite du point ƒ ou fedion de
la ligne des yeux , on décrira f iC , fur laquelle
on placera le nez 8c la bouche. Le
nezeonferve toujours fa même largeur, à
caufe de fa faillie. L’efpace qui eft entre
l’oeil 8c le contour du nez , eft de même
grandeur que cet oeil. L’oreille fe place à
l ’autre extrémité de l ’ovale : & le derrière
de la ’tête excede l’ovale de la grandeur
d’ un oeil vû de face.
J 5. Tête de profil, vûe en deffous.
Les diftributions font les mêmes ; les lignes de
l’oe il, du nez 8c de la bouche font courbées
' en-deffus. .?
6. Tête de profil, vûe en-deflus.
Même diftribution, & les lignes fuivant le
principe de la fig. 3*
7. Tête droite, vûe de trois quarts.
Les diftributions des yeux au n e z , du nez à
la bouche , font les mêmes que dans la figure
première; mais.la ligne qui paffe par
le mi-lieu du nez & de la bouche , doit être
courbe.’
8. Tête de. trois quarts , vûe en deffous.
. 9. Tête de trois quarts , vûe en deflus.
Les diftributions de ces trois dernieres figures
font un compofé des précédent es*
Il eft à remarquer qu’ en quelque fituation que
foît la tête , toutes les lignes qui étoient droites
dans la tête vûe de face , deviennent circulaires,
fans cefler cependant d’ être parallèles ; & la
partie, dbpuis la naiffance des cheveux jufqu’au
fommet, acquiert plus ou moins de grandeur,
félon qu’elle eft plus ou moins inclinée ; la partie
depuis les yeux jufqu’ au nez , devient aufli
plus petite à proportion, 8c celle du nez jufqu’ au
bas du menton, encore plus petite. Au contraire,
quand là tête eft vûe en-dcffjus, les parties inférieures
deviennent plus grandes , & vont toujours
en diminuant jufqu’au front. Les oreilles
lont toujours placées entre la ligne des yeux &
celle du nez.