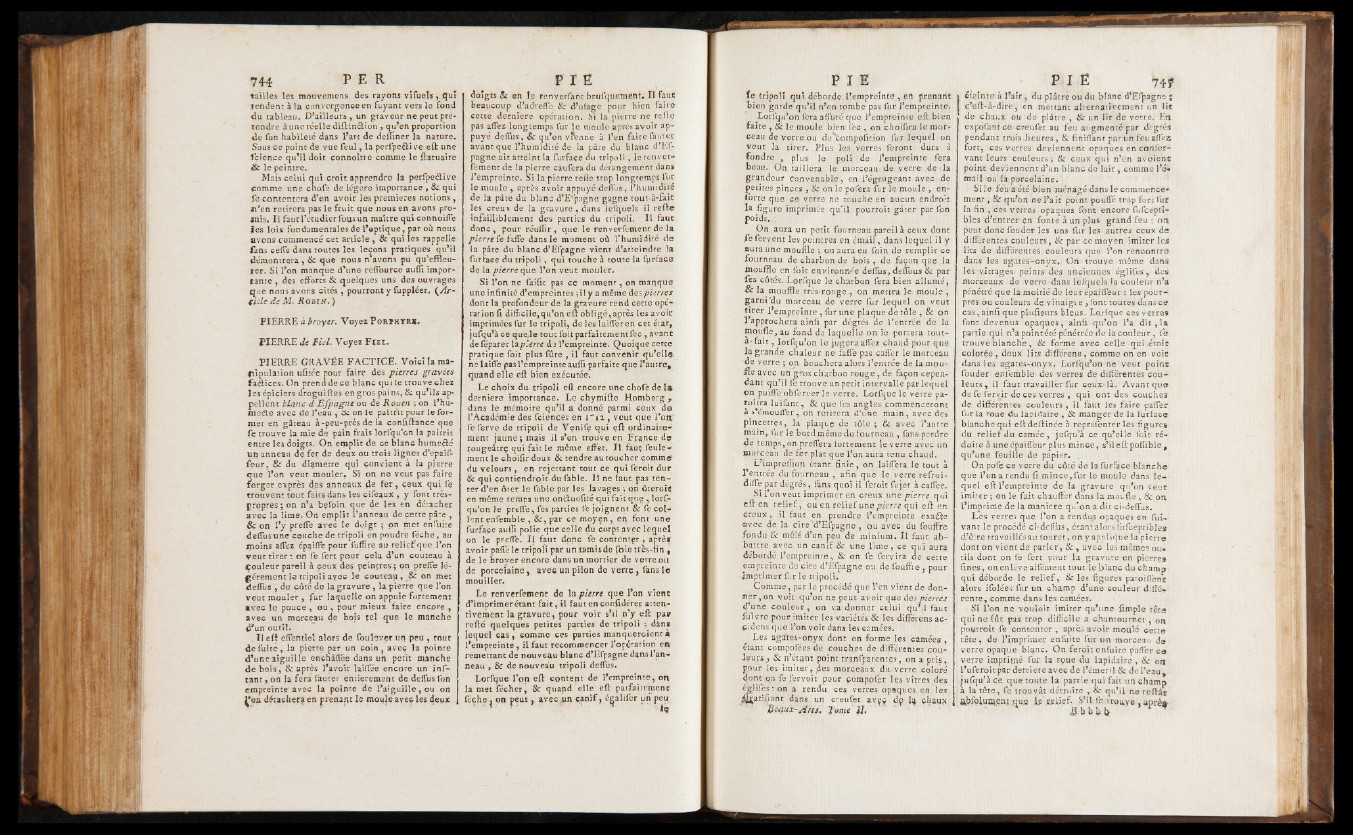
tailles les mouvemens des rayons vifuels, <juî
tendent a la çonvcrgenoe en fuyant vers le fond
du tableau. D’ailleurs, un graveur ne peut prétendre
aune réelle diftinction 9 qu’en proportion
de fon habileté dans l’ art de defiiner la nature.
Sous ce point de vue feu l, la perfpe&ive eft une
Science qu’ il doit connoître comme le ftatuaire
& le peintre.
Mais celui qui croit apprendre la perfpe&ive
çomme une chofe de légère importance , & qui
fe, contentera d’en avoir les premières notions ,
n’en retirera pas le fruit que nous en avons promis.
Il faut l’étudier fous un maître quiconnoiffe
J es îoix fondamentales de l’optique, par où nous
avons commencé cet article, & qui les rappelle
fans celle dans toutes les leçons pratiques qu’ il
démontrera , 8c que nous n avons pu qu’ effleurer.
Si l’on manque d’une rcffource aufîi importante
, des efforts & quelques uns des ouvrages
que nous avons cités , pourront y fuppléer. (Ar ticle
de M. R obin.)
PIERRE à broyer. Voyez P or îhyr *.
PIERRE de t i d . Voyez F t s i .
PIERRE GRAVÉE FA CT IC E . Voici la manipulation
ufitée pour faire des pierres gravées
faftices. On prend de ce blanc qui le trouve chez
les épiciers droguiftes en gros pains, & qu’ ils appellent
blanc d Efpagrte ou de Rouen ; on l’ hu-
meéle avec de l’eau , & on le paitrit pour le former
en gâteau à-peu-près de la confiftance que
fe trouve la miç de pain frais lorfqu’on la paicrit
entre les doigts. On emplit de ce blanc humeéié
un anneau de fer de deux ou trois lignes d’ëpaif-
feur, & du digmetre qui convient à la pierre
que l’ on veut mouler, Si on ne veut pas faire
forger exprès des anneaux de fe r , ceux qui fe
trouvent tout faits dans les cifeaux , y font très-
propres; on n’ a bçfoin que 4e l es en détacher
avec la lime. On emplit l’anneau de cette pare ,
& on l’y preffe avec le doigt ; on iqet enfuite
delTus une couche de tripoli en poudre féche, au
ipôins affez épaiflè pour fuffire au relief que l’on
veut tirer: on fe fert pour cela 4>un couteau' à
couleur pareil à feux des peintres; on preffe légèrement
le tripoli ayec le couteau, & on met
deffus , du côte de la gravure , la pierre que l’on
veut mouler , fur laquelle on appuie fortement
avec le pouce , ou , pour mieux faire encore ,
avec un morceau de bois tel que le manche
d’ un outil.
Tl eft effentiel alors' de foulcver un peu , tout
de fuite, la pierre par un coin ^ aveç la pointe
d’ur.e aiguille encnâffée dans un petit manche
de bois, & après l’avoir laiffée encore un inf-
tan t,on la fera fauter entièrement 4e deffusfon
empreinte avec ia pointe de l ’aiguille, ou on I
Çe» détachera en prenait le moule avec les deux |
doigts Sc en le renverfant brulquetnent, Il faut
beaucoup d’adreffe & d’ ulage pour bien faire
cette derniere opération. Si la pierre*ne refie
pas affez longtemps lur le moule après avoir appuyé
deffus, 8c qu’on vfenne à l’ en faire fauter
avant que l’humidité de la pâre du blanc d’Ef-
■ pagne ait atteint la furface du tripoli, letenver-
fement de la pierre çàufera du dérangement dan?
l’empreinte. Si la pierre relie trop longtemps fur
le moule , après avoir appuyé deffus, l’humidité
de la pâte du blanc d’E'pagne gagne tout-à-faic
les creux de la gravure, dans lefquels il relie
infailliblement des parties du tripoli. Il faut
donc, pour réulïir , que le renverftment de la
pierre fe faffe dans le moment où l ’humidité de
la pâte du blanc d’Efpagne vient d’atteindre la
furface du tripoli, qui touche à toute la fprface
de la pierre que l’on veut mouler.
Si l’on ne failit pas ce moment, on manque
une infinité d’empreintes -, i 1 y a même des pierres
dont la profondeur de la gravure rend cette ope*
ration fi difficile,qu’on elt obligé, après les avoir
imprimées fur le tripoli, de les laifferen cet état,
jufqu’ à ce que le tout foit parfaitementfec, avant
de féparer la pierre d2 l’empreinte. Quoique cette
pratique foit plus fûre , il faut convenir qu’elle
ne laiffe pas l’empreinte aufii parfaite que l’autre*
quand elle eft bien exécutée.
Le choix du tripoli efi encore une chofe de 1»
derniere importance. Le chymifte Homberg,
dans le mémoire qu’ il a donné parmi ceux do
l’Académie des feiences en iTxx , veut que l'oitf
(e ferve de tripoli de Venife qui eft ordinaire«^
ment jaune; m^is il s’en trouve en France de
rougeâtrç qui fait le même effet. I l faut feule-*
ment le choifir doux & tendre au toucher commer
du velours , en rejettant tout ce qui ferait dur
& qui contiendrait du fable. Il ne faut pas tenter
d’en ôter le fable par les lavages ; qp ôteroifi
en même temps une onéluofité qui fait que , lorsqu’on
le preffe, fes parties fe joignent & fe «plient
enfembie, & , par ce moyen, en font une
furface auili polie que celle du corps avec lequel
on le preffe. Il faut dope fe contenter , aprèç
avoir paffé le tripoli par un tamis de foie tr,ès-fin ,
de le broyer encore dans un mortier de verre ou
de porceiaine, avec un pilon de verre , fans le
mouiller.
Le renverfement de la pierre que l’ on vient
d’imprimer étant fait, il faut en considérer attentivement
la gravure, pour voir s?il n’y eft pa»
refté quelques petites parties de tripoli ; dàns
lequel c a s , comme ces parties manqueraient à
l’empreinte, il faut recommencer l’operation en
remettant de nouveau blanc d’Efpagne dans l’anneau
, & de nouveau tripoli deffus.
Lorfque l’on eft content de l’empreinte, on
la met fécher, & quapd elle eft parfaitement
féche j on peut, avec jun qanif, égalifer un peu
P I E
ïe tripoli qui déborde l’ empreinte , en prenant
bien garde qu’ il n’en tombe pas fur l ’empreinte.
Lorfqu’on fera affuré que l’empreinte eft bien
faire , & le moule bien i’ec , on choifira le mort-
ceau de verre ou de'compofition fur lequel on
veut la tirer. Plus les verres feront durs à
fondre , plus le poli de l’ emp.reinte fera
beau. On taillera le morceau de .verre:.de la
grandeur convenable, en l’égrugeant avec de
petites pinces , & on le pofera fur le moule , en-
forte que ce verre ne touche en aucun endroit
la figure imprimée qu’ il pourrait gâter par fon
poids.
On aura un petit fourneau pareil à ceux dont
fe fervent les peintres en émail, dans lequel il y
aura une mouffle -, on aura eu foin de remplir ce
fourneau de charbon de bois, de façon q tte la
mouffle en foit environnée deffus, deffous & par
fes côtés. Lorfque le charbon fera bien allumé,
£c la mouffle très-rouge , on mettra le moule ,
garni'du morceau de verre fur lequel on veut
tirer l’ empreinte , fur une plaque de tô le , & on
1 approchera ainfi par degrés de l ’entrée de la
moufle, au fond de laquelle on le portera tout-
a - fa it , lorfqu’on le jugera affez chaud pour que
la grande chaleur ne faffe pas caffer 1« morceau
-de verre ; on bouchera alors l’entrée de la moufle
avec un gros charbon rouge, de façon cependant
qu’ il le trouve un petit intervalle par lequel
on puiffVobferver le verre. Lorfque le verre paraîtra
luifant, & que fes angles commenceront
a s emouffer, on retirera d’une main, avec des
pincettes, la plaque de tôle ; 8c avec l’ autre
main, lur le bord même du fourneau , fans perdre
de temps, on preffera fortement le verre avec un
morceau de fer plat que l’on aura tenu chaud.
L’imprelfion étant finie, on laiffera le tout à
l ’ entrée du fourneau , afin que le verre refroi-
diffe par degrés, Uns quoi il ferait fujet à caffer.
Si l’ on veut imprimer en creux une pierre qui
eft en relief, ou en relief une pierre qui eft en
creux, il faut en prendre l’empreinte exaéte
•avec de la cireM’Efpagne , ou avec du fouft’re
fondu 8c mêlé d’ un peu de minium. I l faut ab-
battre avéc un canif & une lime , ce qui aura
débordé l’empreinte, & on fe fervira de cette j
empreinte de cire d’Efpagne ou de louffre , pour !
-imprimer fur le tripoli.
Comme, par le procédé que l’en vient de donn
e r , on voit-qu’on ne.peut avoir que des pierres
d’ une couleur, on va donner celui qu’ il faut
finvre pour imiter les variétés & les differens ac-
Cidens que l’on voit dans les camées.
Les agîftes-onyx dont on forme les caméep ,
étant compofées de couches de différentes couleurs
? & n’ét^nt point trajifparentes, on a pris,
pour les imiter ? des morceaux du.verre coloré ;
dont .on fefervoit pour çompofer les vîtres des
églifes : on a rendu ces verres opaques en les
R a tifian t dans un creufet avçç dp la cl^aux
$edux-jirts. f'ome
j éteinte.à l’a ir , du plâtre ou du blanc d’Efpagne J
c’eft-à-dire, en mettant alternativement un lit
de chaux ou de plâtre , & un lit de verre. En
expofant ce creufet au feu augmenté par degrés
pendant trois-heures, & finiffant par un feu affez
fort, ces verres deviennent opaques en confer-
vanc leurs couleurs-, 8c ceux qui n’en avoienc
point deviennent d’un blanc de la it , comme l ’é*
mail ou la porcelaine.
Si le feu&été bien ménâgé dans le commencement
, & qu’ôn ne l’ait point pouffé trop fort fur
la fin , ces verres opaques font encore fufcépri-
bles d’entrer en fonte à un plus grand feu : on
peut donc fonder les uns fur les autres ceux de
differentes couleurs, 8c par ce moyen imiter les
lits de differentes couleurs que l’on rencontre
dans les agates-onyx. On trouve même dans
les vitrages, peints des anciennes églifes, des
morceaux de verre dans lefquels la couleur n’a
pénétré que la moitié de leur épaiffeur : les pour—
près ou couleurs de vinaigie , font toutes dans ce
cas, ainfi que plufieurs bleus. Larlque ces verras
font devenus opaques, ainfi qu’on l’ a dit, la
partie qui n’ a pointété pénétrée de la couleur, le
trouve blanche, & forme avec celle qui étoic
colorée, deux lits differens, comme on en voie
dans les agates-onyx. Lorfqu’on ne veut poinc
fouder enfëmble des verres de différentes couleurs,
il faut travailler fur ceux-là. ' Avant que
de fe fervir de ces verres , qui ont des couches
de differentes couleurs , il faut les faire paffer
fur la roue du lapidaire , & manger de la furfac©
blanche qui eftdeftinée à repréfentér les figures
du relief du camée, jufqu’à ce qu’ elle (oit réduite
à uneépaiffeur plus mince, s’ il eft pofîible*
qu’une feuille de papier.
On pofe ce verre du côté de la furface blanche
que l’on a rendu fi mince,fur le moulé dans lequel
eft l’empreinte de la gravure qu’on veut
imiter ; ôn 1e fait chauffer dans la moufle , & on
l’imprime de la maniéré qu’on a dit ci-deffus.
Les verres que l’on a rendus opaques en fui-,
vant le procédé ci-deffus, étant alors lufceptible»
d’ê:re travaillés àu tourec, on y applique la pierre
dont on vient de parler, & , avec les mêmes outils
dont .on fe fert pour la gravure en pierres
fines, on enlève aifément tout le blanc du champ
qui déborde le relief, 8c les figures paroiffenc
alors ifolées fur un champ d’une couleur différente,
comme dans les camées.
Si l ’on ne voulôit imiter qu’ une (impie tête
qui ne fût pas trop difficile a chantourner, on
pourroit fe contenter , après avoir moulé cette
tê te , de l’imprimer enfuite fur un morceau dé
verre opaque blanc. On feroit enfuite paffer ce
verre imprimé fur la rpue du lapidaire , & on
l’ uferoit par derrière avec de l’émeril & de l’eau ,
jufqu’à ce que toute la partie qui fait un champ
à la tête, fe trouvât détruite , 8c qu’ il ne reftâç
&bfoiuaven£ «us le jelief. S’ il fe.trouve , aprè»
& b b b b