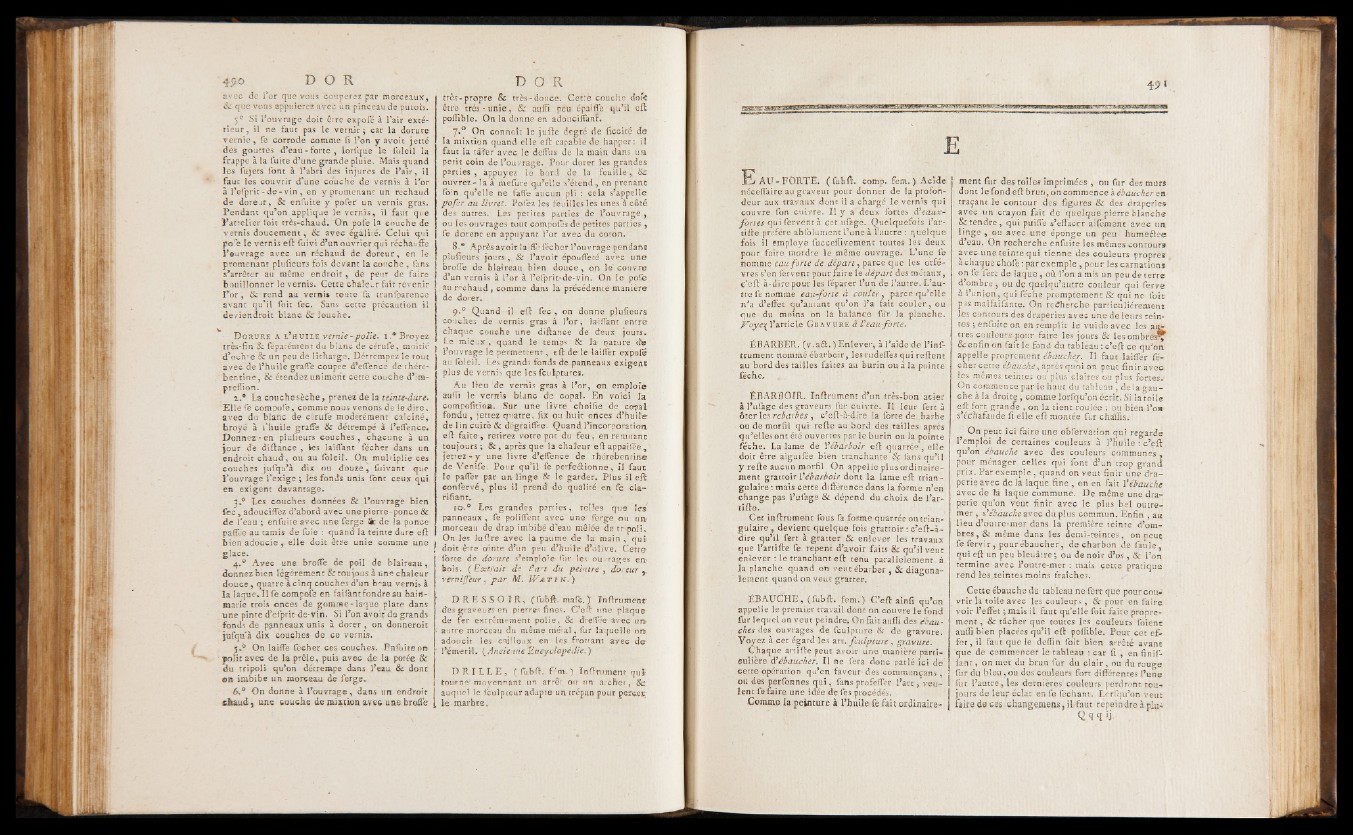
avec de For que vous couperez par morceaux,
& que vous appuierez avec un pinceau de putois.
5° Si l’ouvrage doit être expofé à l’air extérieur,
il ne faut pas le vernir ; car la dorure
vernie, fe corrode comme fi l ’on y avoit jette
des gouttes d’e au -fo r te , Iorfque lte folcil la
frappe à la fuite d’une grande pluie. Mais quand
les lujets font à l ’abri des injures de l’air, il
faut les couvrir d*une couche de vernis, à For
à l’efprit - de-vin , en y promenant un réchaud
de doreur, & enfuite y pofer un vernis gras.
Pendant qu’on applique le vernis, il faut que
ï ’atrelier loit très-chaud. On pofe la couche de
vernis doucement, & avec égalité. Celui qui
jpo!e le vernis eft fuivi d’ un ouvrier.qui réchauffe
l ’ouvrage avec un réchaud de doreur, en le
promenant plufieurs fois devant la couche , fans
s’arrêter au même endroit, de peur de faire
bouillonner le vernis. Cette chaleur fait revenir
l ’o r , tk rend au vernis toute fa tranfparence
avant qu*il foit fec. Sans cette précaution il
deviendront blanc & louche*
Dorure a l’ huile vernie-polie. i.° Broyez
très-fin & féparément du blanc de cérufe, moitié
<Fouhre & un peu de litharge. Détrempez le tout
avec de l’ huile grade coupee d’ eflence de thére-
' ber.tirre, & étendez uniment cette couche d’im-
preffion.
z.® La couche sèche , prenez de la teinte-dure.
Elle fe compofe, comme nous venons de le dire,
avec du blanc de cérufe modérément calciné,
broyé à l’huile graffe & détrempé â l ’elfence.
Donnez-en plufieurs couches, chacune à un
jour dé difiance , les laiflant fécher dans un
endroit chaud, ou au foleiî. On multiplie ces
couches jufqu’à dix ou douze, Çuivant que
l ’ouvrage Fexige ; les fonds unis font ceux qui
en exigent davantage.
Les couches données & l’ouvrage bien
très-propre & très-douce. Cetîè couche donc
être très-unie , <&r auffi peu. épaiffe qu’ il cft
pollible. On la donne en adoucifFanï.
7-° On connoît le jufte degré de ficcité de
la mixtion quand elle eft capable de happer: il
faut la tâïter avec le dëffus de la main dans un
périt coin de l ’ouvrage. Pour dorer les grandes
parties , appuyez le bord de la feuille , &
ouvrez -la à rhefure qu’elle s’étend, en prenant
foin qu’elle ne fade aucun pli : cela s’appelle
pôfer au livret. Pofez les feuilles les unes à côté
des autres. Les petites parties de l’ouvrage,
ou les ouvrages tout compofés de petites parties ,
fe dorent en appuyant l’or avec du coton.
8.®' Après avoir laiffe fécher l’ouvrage pendant
plufieurs jours,. & l’avoir époufieté avec une
broffe de blaireau bien douce , on lé couvre
d’un vernis à l’ or à l’efprit-de-vin. On le pôle
. au réchaud , comme dans la précédente manière
de dorer.
9.0 Quand il eft fec , on donne plufieurs
couches de vernis gras à For, laiffant entre
chaque couche une diftance de deux jours.
Le mieux , quand le temps & la pâture de
l’ ouvrage le permettent, eft de le laiffer expofé
au folei-1. Les grands fonds de panneaux exigeas
plus de vernis que les fculptures.
Au lieu 'de vernis gras à For, on emploie
auffi le vernis blanc de copal. En voici la
compofitioa. Sur une livre choifie de copal
fondu, jettez quatre, fix ou hure onces d’huile-
de lin cuite & dégraiflee. Quand l’ incorporation
eft faite , retirez votre pot du feu , en remuant
toujours; & , après que la chaleur eft appàifée ,
jetrez - y une livre d’eflence de rhéreben titre
de Venife, Pour qu’ il fe perfectionne, il faut
le palier par un linge & le garder. Plus il efb
confervé, plus il prend de qualité en fe clarifiant.
ro.° Les grandes parties, telles que les
panneaux, fe poli fient avec une ferge ou un-
morceau de drap imbibé d’eau mêlée de trpoli,.
On les Juftre avec la paume de la main , qui
doit être ointe d’un peu d’huile d’olive. Cette
forte de dorure s’emploie- fur les ouvrages en>
bois. | Extrait de Vart du peintre , doreur r
verniffeur, par M. JVA t i tf. )
D R E S S O I R , ( fubft. maie. ) Infiniment-
des graveurs en pierres fines. C’eft une plaque-
de ter extrêmement polie, & drefiée- avec irm
autre morceau du même nierai, fur laquelle or»
adoucir les cailloux en les frotiam avec de-
Fémeril. { Ancienne 'Encyclopédie. )'
D R I L L E , (fubft. fe tri;. ) Infiniment qui
tourne-'moyennant un arrêt ou un archet, Sz
auquel le fculpceur adapte un trépan pour percer
le marbre.
fec , adoucïffez d’abord avec une pierre-ponce &
de l’eau ; enfuite avec une ferge <sk de la ponce
paifée au tamis de foie : quand la teinte dure eft
bien adoucie elle doit être unie comme une
glace..
4.0 Avec une brofle de poil de blaireau,
donnez bien légèrement & tou jous à une chaleur
douce, quatre à cinq couches d’un beau vernis à
la laque. Il fe compofe en faifant fondre au bairt-
snarie trois onces de gomme-laque plate dans
une pinte d’efprit-de-vin. Si Foiyavoif de grands
fonds de panneaux unis à dorer , on donneroit
jufqu à dix couches de ce vernis.
5- 0 On laiffe fécher ces couches. Enfuite on
polit avec de la prèle, puis avec de la potée &
du tripoli qu’on détrempe dans l’eau & dont
on imbibe un morceau de ferge.
6- .Q On donne à l’ouvrage, dans tin endroit
chaud, une couche de mixtion avec une broffe
E
E a u - f o r t e , (fubft. comp. fem. ) Acide
nécefiaire au graveur pour donner de la profond
deur aux travaux dont il a chargé le vernis qui
couvre fon cuivre. Il y a deux fortes dh eaux-
fan e s qui fervent à cet .ufage. Quelquefois Parti
fié préféré abfolument l’une à l’autre : quelque
fois il employé fuccefiivement toutes les deux
pour faire mordre le même ouvrage. L’une fe
nomme eau-forte de départ, parce que les orfèvres
s’ en fervent pour faire le départ des métaux,
c ’eft-à-dire pour les féparer l’un de l’autre. L’autre
fe nomme eau-forte à couler, parce qu’elle
iFa d’effet qu ’ a lita n t qu’on l’ a fait couler, ou
que du moins on la balance fur la planche.
yoye1 l’article Grayure à Veau-forte.
ËBARBER. (v. a â . ) Enlever, à l’aide de l’ inf-
trument nommé ébarbeir, les rudefles qui reftent
au bord des tailles faites au burin ou à la pointe
feche.
ËBARBOIR. Infiniment d’ un très-bon acier
à l’ufage des graveurs fur cuivré. Il leur fort â
ôter les rebarbes , c’eft-à-dire la forte de barbe
ou de morfil qui refte au bord des tailles après
qu’elles ont été ouvertes par le burin ou la pointe
féche. La lame de Vébarboir eft quarrée, elle
doit être aiguifée bien tranchante & fans qu’il
y refte aucun morfil. On appelle plus ordinairement
grartoir Vébarboir dont la lame eft triangulaire
*. mais cette différence dans la forme n’en
change pas l’ufage & dépend du .choix de l’ ar-
tifte.
Cet infiniment fous fa forme quarrée ou triangulaire
, devient quelque fois grattoir : c’efl-à-
dire qu’ il fert à gratter & enlever les travaux
que l’artifte fe repent d’avoir faits & qu’ il veut
enlever : le tranchant eft tenu parallèlement, à
la planche quand on veutébarher , & diagona-
lemént quand on veut gratter.
ÉBAUCHE, (fubft. fem.) C ’eft ainfi qu’ on
appelle le premier travail dont on couvre le fond
fur lequel on veut peindre. On fait auffi des ébauches
tes ouvrages de fculpture ik de gravure.
Voyez à cet égard les art .fculpture , gravure.
Chaque artifte peut avoir une manière particulière
débaucher. Il ne fera donc parlé ici de
cette opération qu’en faveur des commençans , J
ou des perfonnes q u i, fans profeffer F art, veu- I
lent fe faire une idée de fes procédés.
Comme la peinture à l’huile fe fait ordinaire- |
ment fur des toiles imprimées , ou fur des murs
dont le fond eftb run, on commence à ébaucher en
: traçant le contour des figures & des draperie»
avec un crayon fait de quelque pierre blanche
& tendre, qui puifie s’effacer aifément avec un
linge , ou avec une éponge un peu humeélèe
d’eau. On recherche enfuite les mêmes contour»
avec une teinte qui tienne des couleurs propres
à chaque chofe: par exemple, pour les carnations
on fe fert de laque, où l ’on a mis un peu de terre
d’ombre , ou de quelqu’ autre couleur qui ferve
à l’union, qui féche promptement & qui ne foie
pas malfaifante. On recherche particuliérement
les contours des draperies avec une de leurs teintes
; enfuite on en remplit le vuide avec les au-
tres couieurs-pour faire les jours & les ombres^
& enfin on fait le fond du tableau : c’eft ce qu’on,
appelle proprement ébaucher. Il faut îaiffér fe-
cher cette ébauche, après quoi on peut finir avec
les mêmes teintes ou plus claires ou plus fortes.'
On commence par le haut du tableau , de la gauche
à la droite, comme lorfqu’on écrit. Si la toile
eft fort grande , on la tient roulée ou bien l’on
s’échafaude fi elle eft montée fur chaïfis.
On peut ici faire une obfervation qui regarde
l ’emploi de certaines couleurs à l’huîle : c ’eft:
qu’on ébauche avec des couleurs communes ,
pour ménager celles qui font d’ un trop grand
prix. Par exemple, quand on veut finir une draperie
avec de la laque fine , on en fait Fébauche
avec de îâ laque commune. De même une draperie
qu’on veut finir avec le plus bel outremer
, s’ébauche avec du plus commun. Enfin , aa
lieu d’outre-mer dans la première teinte d’ombres,
& même dans les demirteintes, on oeuc
fe fervir, pour ébaucher, de charbon de faille,
qui eft un peu bleuâtre*, ou de noir d’ os , & l’on
termine- avec l’outre-mer : mais, cette pratique
rend les éteintes moins fraîches.
Cette ébauche dû tableau ne fert que pour cou»
vrir la toile avec les couleurs, & pour en faire
voir l’ effet ; mais il faut qu’elle foit faite proprement
, & tâcher que toutes les . couleurs foienc
auffi bien placées qu’ il eft poffible. Pour cet effet
, il faut que le deffin foit bien arrêté avant
que de commencer le tableau : car fi , en finif-
fan t , on met du brun fur du ç la ir , ou du rouge
fur dq. bleu,ou des couleurs fort différentes Fune
fur l’autre., les dernières couleurs perdront tou»
jours de leur éclat en fe féchant. Lcrfqu’on veut
faire de ces changemens. il.-faut repeindre à plu»
Q s s ' j