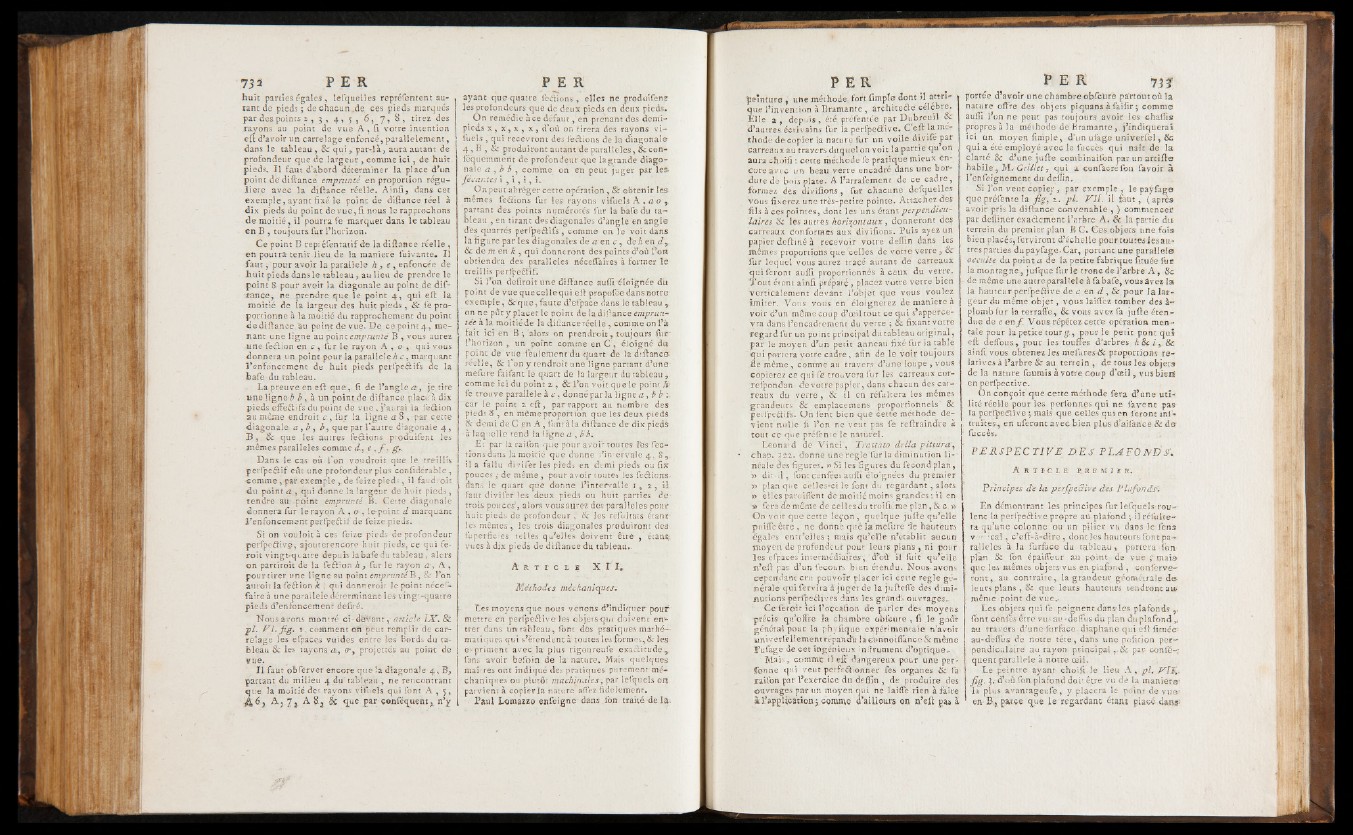
huit parties égales , lesquelles représentent autant
de pieds; dechacun.de ces pieds marqués
par des.points a , 3 , 4 , 5 , 6, 7 , 8., tirez des
rayons au point de vue A , ü vôtre intention
eft d’avoir un carrelage enfoncé, parallèlement,
dans le tableau , 8c qui ,. par-là, aura autant de
profondeur que de largeur , comme ici, de huit,
pieds. Il faut d’abord déterminer la place d’un
point de' di flan ce empmnté en proportion régulière
avec la diftance réelle. Ainfi* dans cet
exemple, ayant fixé le point de diftance réel à
dix pieds du point de vue, fi nous le rapprochons
de moitiéil pourra fe marquer dans le tableau
en B , toujours fur l’horizon.
Ce point B représentatif de la diftance réelle ,
en pourra tenir lieu de la maniéré luivante. Il
faut, pour avoir la parallèle h y e , enfoncée de
huit pieds dans le tableauau lieu de prendre le
point 8 pour avoir la diagonale au point de diftance,
ne prendre que.le point 4, qui eft la
moitié de la largeur des huit pieds, & fe proportionne
à la moitié du rapprochement du point
de diftance. âu point de vue. De ce point 4, menant
une ligne au point emprunté B , vous aurez
Mne^feélion en c , fur le rayon A , &■ , qui-vous
donnera un point pour la parallèle h c , marquant
l ’enfoncement de huit pieds perfpeélifs de la
bafe du tableau.
La preuve en eft que, fi de l’angle à , je tire
uneiigne-ô b , à un poinjLde diftance places dix
pieds effectifs du point de vue , j’aurai la feélion
âu même endroit c., fur la ligne a B , -par cette
diagonale: a , b , que par l’autre diagonale 4,
B , 8c que. les autres fe étions produifent les
mêmes parallèles comme <£, e , f . g..
Dans le cas ou l’on von droit que le treillis
perfpeélif eût une profondeur plus confidérable ,
comme, par exemple de feize pieds, il faudrait
du point a , qui donne .la largeur de huit pieds ,
tendre au point emprunté B. Cette diagonale
donnera fur le rayon A , <*, le-point d marquant
J’enfoncementperfpeélif de feize pieds.
Si on vouloit à ces feize pieds de profondeur
perfpeéfivé, ajouterencore huit pieds, ce qui fe-
roit vingt-quatre depuis la bafe du tableau, alors
on partiroit de la fèélion h * fur le rayon <2-, A ,
pour tirer une ligne au point emprunté B, &: l’on
au roi t la feélion k , qui donneroir le point nécef—
faire aune parallèle déterminant les vingt-quatre
pieds d’enfoncement defiré.
Nous avons montré ci-déh/anr, article L5 T. &
vl. V L fig. r. comment on pëut remplir de carrelage
les efpaces vuides entre les bords du tableau
8c les rayons æ, projettes au point de
vue.
Il faut obférver encore que la diagonale 4, B,
partant du milieu 4 du' tableau , ne rencontrant
que la moitié dés rayons vifuels qui font A , 5 ,
'4 63 A 5 7 a. A 8 a ét que par conféquent y n’y
ayant que quatre levionselles ne produifent
les profondeurs que de deux pieds en deux pieds.
On remédie à ce défaut, en prenant des demi-
pieds x, x ,x , x , d’où on tirera des rayons vi-
fuels , qui recevront des feélions de la diagonale
4, B , & produiront autant de parallèles, &con-
féqueinmerit. de profondeur que la grande diagonale
a ., b b , comme on en peut juger par les-
fé e antes i , i , i , i„
On peut abréger cette operation, 8c obtenir les
mêmes feélions fur les rayons vifuels A « a 0 ,
partant des points numérotés fur la bafe du tableau
, en tirant dés diagonales d’angle en angle
dés quarrés perfpeélifs, comme on le voit dans
la figure par les diagonales de a en c , de h en d'r
8c de m en k , qui donneront des points d’où l’on
obtiendra des parallèles néceflaires à former le
treillis perfpeélif
Si l’on defiroit une diftance aufii éloignée du
point de vue que celle qui eft propofée dans notre
exemple, & que, faute d’efpace dans le tableau r
on ne pût y placer le point de la diftance empruntée
à la moitiéde la difianceTéelle , comme on l’à
fait ici en B ; alors on prendroit, toujours fuir
l’horizon, un point comme en C , éloigné dii
point de vue feulement du quart de la diftance:
reelîe, & 1 on y tendroit une ligne partant d’une
mefure faifant le qwart de la largeur du tableau ,
comme ici du point z , 8t l’on voit quele point h-
fe trouve parallèle à c, donné par la lignes, b b
car le point 2 eft, par rapport au nombre des
pieds 8 , en même proportion que les deux-pieds
ik demi déC en A , font à la diftance de dix pieds
à laquelle tend la ligne a , b b.
Et par la raifon que pour avoir toutes Tes fec-
tionsdans la moitié que donne fin èrvafle 4, 8
il a fallu di/ifer les pieds en demi pieds ou fix
pouces ,-de même , pour avoir toutes les feélions-
dans le quart que donne l’intervalle 1 , 2, il
faut divifer les deux pieds ou huit parties de-
trois pouces', alors vous aurez des parallèles pour
huit pieds de profondeur , 8c les téfultats étant
les mêmes; les trois diagonales produiront des
fuperficies. telles qu’elles doivent être , étan.%
vues à dix pieds de diftance du tableau..
A' R "T i c l e X .P I..
Méthodes, mèchaniques:.
Les moyens que nous venons d’indiquer pour
mettre en perfpeéli vêles objersqui doivent en*”
trer dans un rabîeau, font dès pratiques mathématiques
qui s’étendent à toutes les formes, & les
expriment avec la plus rigoureufe .exaélitude
fans avoir befoin de la nature. Mais quelques
maires ont indiqué des pratiques purement’mé-
chaniqnes ou plutôt machinales-, par lefquels on
parvient à copier la nature afiez fidèlement.
Paul Lomazzo enfeigne dans fon. traité de la.
peinture j une méthode, fort {impie1 dont il attaque
l’invention à Bramante , architeélé célébré.
Elle a, depuis, été préfentée par Dubreuil &
d’autres écrivains fur la perfpeélîve. C’eft lamer
thodé de copier la nature fur un voile divife par
carreaux au travers duquel on voit la partie qu on
aura choifi : cette méthode fe pratique mieux encore
avec un beau verre encadré dans une bordure
de bois plate. A l’arrafement de ce cadre,
formez des divifions, fur chacune defquelles
vous fixerez une très-petite pointe. Attachez des
fils à ces pointes, dont les uns étant perpendiculaires
8c les autres horizontaux , donneront des
carreaux Conformes aux divifions. Puis ayez un
papier deftiné à recevoir votre deftin dans les
memes proportions que celles de votre verre , &
fur lequel vous aurez tracé autant de carreaux
qui feront aufii proportionnés à ceux du verre.
Tout étant ainfi préparé, placez votre verre bien
verticalement devant l’objet que vous voulez
imiter. Vous vous eh éloignerez de maniéré à
voir d’un mêmecoup d’oeil tout ce qui s’apperce-
vra dans l’encadrement du verre ; 8c fixant votre
regard fur un point principal du tableau original,
par le moyen d’un petit anneau fixé fur la table
qui portera votre cadre, afin de le voir toujours
fie même, comme au travers d’une loupe ,vous
copierez ce qui fe trouvera fur les carreaux cor-
refpondan de votre papier, dans chacun des carreaux
du verre , & il en réfuItéra les mêmes
grandeurs 8c emplacemens proportionnels &
peifpedifs. Oh fent bien que cette méthode devient
nulle fi l’on ne veut pas fe reftraindre à
tout ce que préfente le naturel.
Leonard de Vinci, Trattato délia pittura^.
chap. 322. donne une regle'fur la diminution li-
néale des figures. » Si les figures du fécond plan,
» dit .1, font cenfëés aufii éloignées du premier
» plan que celles-ci le font du regardant, alors
» elles paroiffent de moitié moins grandes : il en
» fera de mênle de celles du troifieme plan, &c. »
On voit que Cette leçon , quelque jufte qu’elle
puiffè être , ne donné qué la mefure de hauteurs
égales entr’elles; mais qu’elle n’établit aucun
moyen de profondeur pour leurs plans , ni pour
les efpaces intermédiaires-, d?cù il fuit qu’êile
n’eil pas d’un fecour^ b-en étendu. Nous-avons
cependant cru pouvoir placer ici cette réglé générale
qui fervira à juger de la juflefle des diminutions
perfpeélives dans les grands ouvragés^
Ce feroit ici l’occâfion de parler des moyens
précis qu’offre la chambre obfeure , fi le goût
général pour la phvfique expérimentale n’avoit
wniverlèllement répandu la cônnoiflance & même
l’uiage de cet ingénieux înfirument d’ogtique.-
Mais, comme il eft dangereux pour une per-
fon ne qui veut perfeélionner fes organes 8c fa
raifon par l’exercice du deflin , de produire dés
ouvrages par un moyen qui ne îaiffe rien à faire
à l’application 5, comme a ailleurs on n’eft pas àportée
d’avoir une chambre obfc'urè partout où la
nature offre des objets piquans àfaifir; comme
aufii l’on ne peut pas toujours avoir les chafiis
propres à la méthode de Bramante, j’indiquerai
ici un moyen fimple, d’un ufage univerfel, &
qui a été. employé avec le fuceès qui naît de la
clarté 8c d’une jufte combinailon par un artifte
habile , M. Grillet7 qui a eonfacréfon favoir à
l’enfeignement du defiin.
Si l’on veut copier, par exemple , le paÿfage
que préfente la fig , 2. p l. V i l . il faut, (après
avoir pris la diftance convenable , ) commencée
par defiînet exadementl’arbre A. 8c la partie du
terrein du premier plan B C. Ces. objets une fois
bien placés, ferviront d’échelle pour routes les autres
parties du payfage. Car, portant une parallèle
occulte du point a de la petite fabrique fituée fuc
la montagne, jufque furle trône de l’arbre A , 8c
de même une autre parallèle àfabafe, vousâvezl»
la hauteur perfpeélîve de c en d , 8c pour la largeur
du même o b je t, vous laifi’ez tomber des à"
plomb fur la terraffe, & vous avez fa jufte étendue
de e en f . Vous répétez cett'e opération men tale
pour la petite tour g., pour le petit pont qui
eft défions-,, pour les touffes d’arbres h 8c i y &
ainfi vous obtenez les me fur es & proportions relatives
à l’arbre & au terrein , de tous les objets
de la nature fournis à votre coup d’oeil , vus bien!
en perfpective.
On conçoit que cette méthode fera d’ une uti<
lîté réelle pour les perfonnes qui ne favent pas-
la perfpeélîve ; mais que celles qui en feront inf-
, truites-, en uferont avec bien plus d-’&ifance & do
■ fuccès,
' P E R S P E C T I V E D E S P L A F O N D # *
A r t i c l e p r e m i e r .
Principes de la perspective des Plafondsv
En démontrant les principes fur lefquels-rouble
ne la perfpeélîve propre aù plafond ; il réfulte-
ra qu’une colonne ou un pilier vu dans le fens
v .'• -ca l, c’eft-à-dire , dont les hauteurs font pa-^
ralleles à-la furface du tableau , portera lbn
plan & fon épaifleur au point de vue mais
' que les mêmes objets-vus en plafond , conferve-
ront,, au contraite, la grandeur géométrale do-
leurs plans , & que leurs hauteurs tendront au*
> même point de vue,-
Les objets qui fe peignent dan s; les plafonds
font cènfés être vus au-deflus du plan du plafond,,
au travers d’une furface diaphane qui eft fituéo
au-dèflus de notre tête, dans une pofition per--
pendiculaire au rayon principal pat- conlé-7.
quent parallèle à nôtre oeil.
Le peintre ayant choifi.le Heu A , pU VIE..
: f g . 3.; d’où fon plafond doit être vu de la maniéré-
la plus avantageufe, y placera le po'in.t de vuo^
en parce que le regardant étant placé dans;