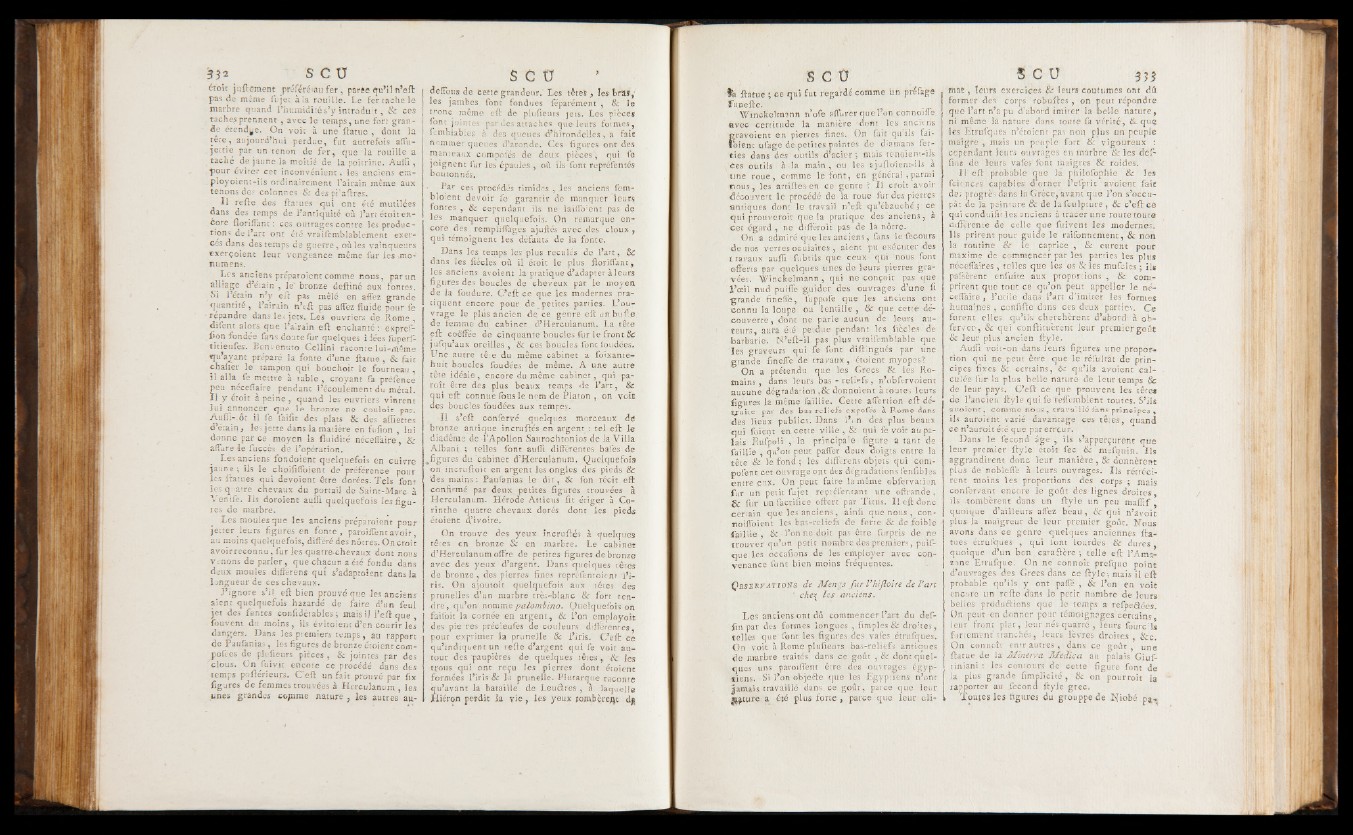
3 3 2 S C Ü
étoit juflement préféré ;au fer , parée qu’ il n’eft
pas de même fujec à ia rouille. Le fer tache le
marbre quand l’humidité s’y introduit, 8c ces
tache^ prennent , avec le temps, une fort grande
étendye. On voit à une ftatue , dont la
tê te , aujourd’ hui perdue, fut autrefois aflu-
jectie par un tenon de fe r , que la rouille a
tache de jaune la moitié de la poitrine. A u lli,
î 50tir éviter cet inconvénient, les anciens em-
ployoient-ils ordinairement l’airain même aux
tenons des colonnes & des pi’aftres.
I l relie des liâmes qui ont été mutilées
dans des temps de l’antiquité où l ’art étoitencore
floriflant : ces outrages contre lès productions
de l'art ont été vraifemblablcment exercés
dans des temps de guerre, où les vainqueurs
lexerçoienc leur vengeance même fur les ,mo:
numens.
Les anciens préparoient comme nous, par un
alliage d’étain , le" bronze delliné aux fontes.
Si l’étain n’y e il pas mêlé en alfez grande
quantité , l’airain n’eil pas allez fluide pour fe
•répandre dans les jets. Les ouvriers de Rome ,
difent alors que l’airain e ll enchanté : expref-
flon fondée fans doute fur quelques idées luperl-
titieufes. Eenvenuto Geîlini raconte lui-nïeme
qu’ayant préparé la fonte d’une ftatue, & fait
chafier le tampon qui bouchoit le fourneau ,
il alla le mettre à table ,, croyant fa préfènee
peu néceliaire pendant J’écoulement du métal.
I l y eroit a peine , quand les ouvriers vinrent
lu i annoncer que le bronze ne couloit -pas.
Aufli-;ot il le l’aifit des plats & des affiettes
d’étain les jette dans la matière en fiifton , lui
donne par ce moyen la fluidité néceliaire, &
allure 4e fiiccès de l ’opération.
Les anciens fondoient quelquefois en cuivre
■ jaune ; ils le choifidbient de préférence pour
les drames qui dévoient être dorées. Tels font
les q atre chevaux du portail de Saint-Marc- à
Venife. Ils doroient aufli quelquefois les figures
de marbre.
Les moulesque les anciens préparoient pour
jetter leurs figures en fonte, paroiffentavoir
au moins quelquefois, différé des nôtres. On croit
avoir reconnu, fur les quatre-chevaux dont nous
venons de parler, que chacun a été fondu dans
deux moules diffërens qui s’adaptoient dans la
longueur de ces chevaux.
J’ ignore s’il eft bien prouvé que -les anciens
aient quelquefois hazardé de faire d’un feul
jet des fentes confidérables ; mais ij i’eft que ,
fouvent du moins, ils évitoient d’en courir les
dangers. Dans les premiers temps, au rapport
de Paufanias, les figures de bronze étoient composes
de plu fleurs pièces , & jointes par des
'clous. On fuivit encore ce procédé dans des
temps poflérieurs. C'eft un fait prouvé par fix
figures de femmes trouvées à Herculanum les
unes grandes cojnme nature , les autres aus
c ü délions de cette grandeur. Les têtefe , les bras,-
les jambes font fondues féparément , 8c le
tronc même eft de plufieurs jets. Les pièces
font .jointes par des attaches que leurs formes,
femblabies à des queues d’hirondelles, a fait
nommer queues d’aronde. Ces figures ont des
manteaux compofés de deux pièces", qui fe
joignent fur les épaules , où ils font repréfentés
boutonnés.
• Par ces procédés timides , les anciens fetn-
bloient devoir fe garantir de manquer leurs
fontes , 8c cependant ils ne laiflo:ent pas de
lès manquer quelquefois. On remarque encore
des rempliflages ajuftés avec des d o u x ,
qui témoignent les défauts de la fonte.
Dans les temps les plus reculés de l’art, Sc
dans les fiècles où il étoit le plus florillant,
les anciens avoient la pratique d’adaprer à leurs
, figures des boucles de cheveux par le moyen
de la foudure. C’eft ce que les modernes pratiquent
encore pour de petites parties. L’ouvrage
le plus ancien de ce genre eft un bufle
de femme du cabinet d’Herculanum. La tête
eft coëffée de cinquante boucles fur le front &
jufqu’aux oreilles, & ces boucles-font foudées.
Une autre tête du même cabinet a foixante-
huit boucles foudées de même. A une autre
tête idéale, encore du même cabinet, qui pa-
roît être des plus beaux temps de l’ar t, &
qui eft connue fous le nom de Platon , on voit
des boucles foudées aux tempes.
I l s’eft confervé quelques morceaux dé
bronze antique incruftés en argent : tel eft le
diadème de l’Apollon Saurochtonios de la Villa
Albani ; telles font aulli différentes baies de
^figures du cabinet d’Herculanum. Quelquefois
on incruftoic en argent les ongles des pieds 8c
'des mains: Paufanias le d i t , & fon récit eft
confirmé par deux, petites figures trouvées à
Herculanum. Hérode Atticus fit ériger à Corinthe
quatre chevaux dorés dont les pieds
étoient d’ ivoire.
On trouve des yeux incruftés , à quelques
têtes en bronze Sc en marbre. Le cabinet
d’Herculanum offre de petites figures de bronze
avec des yeux d’argent. Dans quelques t'êtes
de bronze , des pierres fines repréfentoienr l’iris.
On ajoutoit quelquefois aux têtes des
prunelles d’un marbré très-blanc 8c fort tendre,
qu’on n o m m e Q u e l q u e f o i s on
faifoit la cornée en argent, 8c l’o.n employoit
des pie res précieufes de couleurs différentes,
pour exprimer la prunelle & l’ iris. C’eft ce
qu’ indiquent un refte d’argent qui fe voit autour
des paupières de quelques têtes , 8c les
t^ous qui ont reçu les pierres dont étoient
formées l’ iris & la prunelle. Plutarque raconte
qu’avant la bataille de Leuélres , à laquelle
Hiéron perdit la y i e , les yeux tombèrent d$
S C O
% ftatue ; ce qui fut regardé comme Un préfage
fiinefte.
Winckelmlnn n’ofe aflurer que l’ on connoifie.
èvec certitude la manière 'dont les anciens
eravoient en pierres fines. On fait qu’ ils fai-
foi ent ufage de petites pointes de d s aman s ferries
dans des outils d’acier : mais tenoient-ils
, 6es outils à la main, ou les ajufto'ient-ils a
une roue , comme le font, en généra) , parmi
nous, les articles-en ce genre ? II croit avoir
découvert le procédé de la roue fur des pierres
antiques dont le travail n’e,ft qu’ébauché, ce
qui prouveroit que la pratique des anciens, à
cet égard , ne differoit pas de la nôtre.
On a admiré que les anciens, fans le fecours
de nos verres oculaires, aient pu exécuter des
travaux aufli fubtils.que ceux qui nous font
offerts par quelques unes de leurs pierres gra-
. vées. Winckelmann, qui ne conçoit pas que
l ’oeil nud puifle guider des ouvrages d’une fi
grande finefle, tuppole que les anciens ont
connu la loupe ou lentille , 8c que cette découverte
, dont ne parle aucun de leurs auteurs,
aura été petdue pendant les fiècles de
barbarie. N’eft-il pas plus vraifemblabié que
les graveurs qui fe font diftingués par une
grande finefle de travaux, étoient myopes? .
On a prétendu que les Grecs & les Romains
, dans leurs bas - reliefs , «’obiervoient
aucune dégradation , & dor.noient à routes leurs
figures la meme faillie. Cette a (le mon eft détruite
par des bas reliefs expofés à Rome dans
des lieux publics. Dans lVn des plus beaux
qui foietit en cette ville , 8c qui fe voit au palais
Rüfpoli , la principal figure a tant de
faillie , qu’on peut pafler deux doigts entre la
tête & le fond ; les diffère iis objets qui çom-
pofent cet ouvrage ont des dégradations lenfibles
entre eux. On peut faire la même obfervatiqn
fur un petit fujet repréfentant une offrande ,
Sc fur un fa cri fi ce offert par Titus. Il eft donc
certain que les anciens, ainli que nous , con-
noifloient les bas-reliefs de forte 8c de foible
faillie , & l’on ne doit pas être furpris de ne
trouver qu’ un petit nombre des premiers, puisque
lès occafions de les employer avec convenance
font bien moins fréquentes.
Observations de Men°s fur Vhifloire de l ’art
' che\ les anciens.
Les anciens ont dû commencer l ’art du def-
fin par des formes longues , Amples & droites,
telles que font les figures des vafes étrufques.
On voit à Rome plufieurs bas-reliefs antiques
de marbre traités dans ce goût , 8c dont quelques
uns. paroi fient être des ouvrages égyptiens.
Si l’on objeéle que les Egyptiens n’onr
jamais, travaillé dans.ee goût, parce que leur
nature a été plus forte , parce que leur cli-
5 C U 333
mat, leurs exercices & leurs coutumes ont dû
former des corps robuftes, on peut répondre
que l ’art n’ a pu d'abord imiter la belle nature,
ni même la nature dans toute fa vérité, & que.
les Etrufques n’étoient pas non plus un peuple
maigre , mais un peuple fort & vigoureux :
cependant leurs ouvrages en marbre &c les définis
de leurs vafes font maigres & roides.
Il eft probable que la philofophie 8c les
Icicnccs capables d orner l’ cfprit avoient fait
dej progrès dans la Grèce, avant que l ’on s’occupât
de la peinture & de la fculpture, & c’eft cê
qui conduifit les anciens à tracer une route toute
différente de celle que fuivent les modernes*
Ils prirent pour guide le rationnement, & non
la routine & le caprice , Sc eurent pour
maxime de commencer par les parties les plus
néceflaires , telles que les os & les mufcles ; ils
palsèrent enluite aux proportions , & comprirent
que tout ce qu’on peut appeller le né-
ceflaire, l’ utile dans- l’ art d’imiter les formes
humaines , ccnfifte dans ces deux parties. Ce
furent elles qu’ ils cherchèrent d’abord à ob-
fer/er-, & qui conflituèrent leur premier goût
& leur plus ancien ftylê.
Aufli voit-on dans leurs figures une proportion
qui ne peut être que le réfui fat de principes
fixes 8c certains, 8c qu’ ils avoient calculée
fur la plus belle nature de leur temps &
de leur pays. C’eft ce que prouvent les têtes
de l ’ancien ftyle qui fe Teffemblent toutes. S’ils
avoient, comme nous, travaillé fans principes ,
ils auroient varié davantage ces têtes, quand
ce n’auroit été que par erreur.
Dans le fécond âge , ils s’apperçurent que
leur premier ftyle étoit fec 8c mefquin. Us
aggrandirent donc leur manière , 8c donnèrent
plus de noblefle à leurs ouvrages. Us rétrécirent
moins les proportions des corps ; mais
confervant encore le goût des lignes droites
ils -tombèrent dans un ftyle un peu maflif ,
quoique d’ailleurs a fiez beaii, & qui n’avoït
plus la maigreur de leur premier goût. Nous
avons dans ce genre quelques anciennes fia-
tues étrufques , qui font lourdes 8c dures
quoique d’ un ben caraftère ; telle eft l’Amazone
Errufque.1 On ne connoic prefque point
d’ouvrages des Grecs dans ce ftyle-, mais il eft
probable qu’ ils y ont pafle , 8c l’on en voit
encore un refte dans le petit nombre de leurs
belles produirions que le temps a refpeâées.
On peut -eii donner pour témoignages certains
leur front plat, leur nés quarré , leurs fourc'ls
fortement tranchés, leurs lèvres droites, 8cc.
On connoîc enrr autres , dans ce goût , une
ftatue de la Minerva Medica au palais Giuf-
tiniani : les contours de cette figure font de
ia plus grande Implicite, & on pourroit la
rapporter au fécond ftyle grec.
Toutes les figures du grouppe de JSfiobé pa