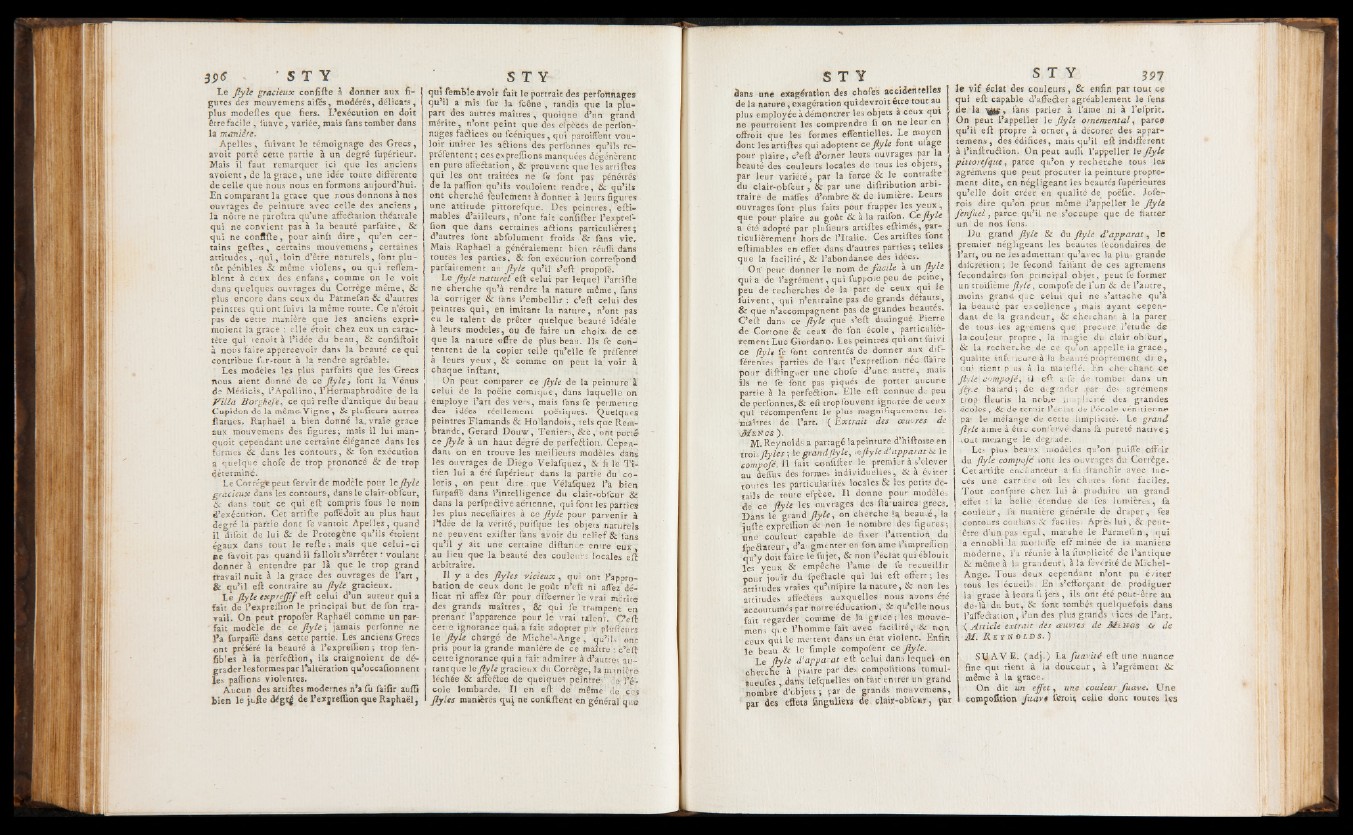
Le flyle gracieux confîfte à donner aux fi- l
gures des mouvemens aifés, modérés, délicats,
plus modeftes que fiers. L’exécution en doit
être facile , luave, variée, mais fans tomber dans
la manière.
Apelles , fuivant le témoignage des Grecs,
avoic porté cette partie à un degré lupérieur.
Mais il faut remarquer ici que les anciens
»voient, de la g ta c e , une idée toute différente
de celle que nous nous en formons aujourd’hui.
En comparant la grâce que nous donnons à nos
ouvrages de peinture avec celle des anciens,
la nôtre ne paroîtra qu’une affeélation théâtrale
qui ne convient pas à la beauté parfaite, &
qui ne confïfte, pour ainfi d ire , qu’ en certains
g e fte s , certains mouvemens, certaines
attitudes, q u i, loin d’être naturels, font plutôt
pénibles & même violens, ou qui reffem-
blent à ceux des enfans, comme on le voit
dans quelques ouvrages du Çorrège même, &
plus encore dans ceux du Parmefan & d’autres
peintres qui ont fuivi la même route. Ce n’étoit .
pas de cette mahière que les anciens ex primo
ient la grâce *. elle étoit chez eux un caractère
qui tenoit à l ’ idée du beau, & confiftoit
à nous faire appercevoir dans la beauté ce qui
contribue fur-tout à la rendre agréable.
Les modèles les plus parfaits que les Grecs
nous aient donné de ce fly le , font la Vénus
de Médicis, l’Apollino, l ’Hermaphrodite de la
P illa Borghefe, ce qui refte d’antique du beau
Cupidon de la même,Vigne , & plufieurs autres
fiatues, Raphaël a bien donné la ,vra ie grâce
aux mouvemens des figures; mais il lui man-
quoit cependant une certaine élégance dans les
formes & dans les contours, & fon exécution
a quelque chofe de trop prononcé & de trop
détermine.
Le Cortège peut fervirde modèle pour le flyle
gracieux dans les contours, dans le clair-obfcur, i
& dans tout ce qui eft compris fous le nom
d’exécution. Cet artifte poffédoit au plus haut ,
degré la partie dont fe vantoit Apelles, quand ,
i l difoit de lui & de Protogène qu’ils étoient
égaux dans tout le refte; mais que ce lu i-c i
ne favoit pas quand il falloit s’arrêter : voulant
donner à entendre par là que le trop grand
travail nuit à la grâce des ouvrages de l’a r t ,
& qu’ il eft contraire au flyle gracieux.
Le fly le expreffif eft celui d’un auteur qui a
fait de l’ expreffion le principal but de fon travail.
On peut propofer Raphaël comme un parfait
modèle de ce flyle ; jamais perfonne ne
l ’a furpaffé dans cette partie. Les anciens Grecs
ont préféré la beauté à l’ exprelEen ; trop fen-
fibîes à la perfe&ion, ils craignoient de dégrader
les formes par ^altération qu’occalionnent j
les pallions violentes.
Aucun des artiftes modernes n’afu faifir auffi
bien le jufte dégt| de l’exjreffion que Raphaël, i
qui femble avoir fait le portrait des perfoflnages
qu’ il a mis fur la fcêne , tandis que la plu-
Pa^c. des autres maîtres , quoique d’ un grand
mérité, n’ont peint que des eî'pcccs de perfon-
nages faélices ou fcéniques, qui paroiffent vouloir
imiter les aélions des perfonnes qu’ ils rc-
prefentent ; cesexprelïions manquées dégénèrent
en pure afteélation, & prouvent que les artiftes
qui les ont traitées ne fe font pas pénétrés
de la paffion qu’ ils vo.uloient rendre, & qu’ ils
ont cherché feulement à donner à leurs figures
une attitude pittorefque. Des peintres, 'efti-
mables d’ailleurs, n’ont fait confifter l’exprel-
fion que dans certaines aélions particulières;
d’autres font abfolument froids & fans vie.
Mais Raphaël a généralement bien réufli dans
toutes les parties, & fon exécution correfpond
parfaitement au flyle qu’ il s’eft propofé.
Le flyle naturel eft celui par lequel l’arrifte
ne cherche qu’ à rendre la nature même, fans
la corriger & fans l ’embellir : c’eft celui des
peintres q u i, en imitant la nature, n’ont pas
eu le talent de prêter quelque beauté idéale
a leurs modèles, ou de faire un choix, de ce
que la nature offre de plus beau. Ils fe contentent
de la copier telle qu’ elle fe préfentef
à leurs y e u x , & comme on peut la voir à
chaque inftant.
On peut comparer ce flyle de la peinture à
celui de la poëfie comique, dans laquelle on
employé l’art des vers, mais fans fe permettre
des idées réellement poétiques. Quelques
peintres Flamands & Hollandois, tels que Rembrandt,
Gérard Douw, Teniers, & c , ont porte
ce flyle à un haut degré de perfe&ion. Cependant
on en trouve les meilleurs modèles dahs
les ouvrages de Diego Velafquez, & fi le T itien
lui a été fupérieur dans la partie du coloris
, on peut dire . que Velafquez l’a bien
furpaffé dans l’intelligence du clair-obfcur &
dans la perfpeélive aérienne, qui font les parties
■ les plus néceffaires à ce flyle pour parvenir à
l’Idée de la vérité, puifque les objets naturels
ne peuvent exifler fans avoir du relief & fans
qu’ il y ait une certaine diftanCe entré eux
au lieu que la beauté des couleurs locales eft
arbitraire.
Il y a des fiyles vicieux , qui ont l’approbation
de ceux dont le goût n’eft ni affez délicat
ni affez fûr pour dïfcernér le vrai mérité
des grands maîtres, & qui fe trompent en
prenant l’apparence pouf le vrai talent. C’ eft
c ev e ignorance qui» a fait adopter p^r pkifieurs
le flyle chargé de Michel-Ange, qu’ ils ont
pris pour la grande manière de ce maître : c’eft
cette ignorance qui a fait admirer à d’autrés autant
que le flyle gracieux du Corrège, la minière-
léchée & affeétee de quelques peïntreV : dej l^é-
cole lombarde. I l en eft de même de ces
fiyles manières qu| ne confiftent en général que
dans une exagération des chofes accidentelles
de la nature, exagération quidevroit être tout au
plus employée à démontrer les objets à ceux qui
ne pourroient les comprendre fi on ne leur en
offroit que les formes effentielles. Le moyen
dont les artiftes qui adoptent ce flyle font uiage
pour plaire, c’eft d’orner leurs ouvrages par la
beauté des couleurs locales de tous les objets,
par leur variété, par la force & le contrafte
du clair-obfcur, & par une diftribution arbitraire
de maffes d’ombre & de lumière. Leurs
ouvrages font plus faits pour frapper les y eu x ,
que pour plaire au goût & à la raifon. Ce flyle a été adopté par plufieurs artiftes eftimés, particulièrement
hors de l’Italie. Ces artiftes font
eftimables en effet dans d’autres parties ; telles
que la facilité, & l’abondance des idées.
On' peut donner le .nom de facile a un flyle
qui a de l’agrément, qui fuppoie peu de peinei,
peu de recherches de la part de ceux qui le
linvenc, qui n’entraîne pas de grands défauts,
& qiie n’accompagnent pas de grandes beautés.
C ’eft dans ce flyle que s’eft dntingué Pierre
de Cortone & ceux de fon école , particulie--
rement Luc Giordano» Les peintres qui ont luivi
ce flyle fe font contentés de donner aux différentes
partiés de l’art l ’expreflion nec. flaire
pour diftinguer une chofe d’une autre, mais
ils ne fe font pas piqués de porter aucune
partie à la perfeéiion. Elle eft connue de peu
de perfonnes, & eft trop fou vent ignorée de ceux
qui récompenfent le plus magnifiquement ies
maîtres de ; l’art. ( Extrait des oeuvres de
JtéExrGG J.-, ' ' v - . ' : ■ ' ■' n
M. Reynolds a partagé lapeinture d’hiftoice en
trois fiyles ; 1 e grandflyle, flyle d’ apparat le
compofé. I l fait confifter le premier à s’ e-lever
au defliis des forme* individuelles, & à éviter
toutes les particularités locales & les petits details
de toute efpèee. I l donne pour modèles
de ce flyle les ouvrages des fta'uaires grecs.
Dans le grand fly le , on cherche la beau,«, la
iufte exprelfion 6c non le nombre des figures -,
une couleur capable de fixer l’ attention du
fpeélateur, d’a: gmtnter en fon a me l’impreffion
qu’ y doit faire le lujet, 8c non l’éclat qui éblouit
les yeux & empêche l ’ame de le recueillir
pour jouir du fpeélacle qui lui eft offert; les
attitudes vraies qu’ mi'pire la nature, & non les
attitudes affëélées auxquelles nous avons été
accoutumes par notrèeduvation , St qu’elle nous
fait regarder comme de la gr-ioë» les mouvemens
que l’homme fait avec facilité,'St non
ceux qui le mettent dans un état violent. Enfin
le beau & le fimple compofent ce flyle.
Le flyle d'apparat eft celui dans lequel on
cherche à plaire par de* compétitions tumul-
tueufes ^dans lefquelles oh fait entrer un grand
nombre d'objets ; par de grands mouvemens,
’ par des effets fingulters de daft-obicur, par
le v if éclat des couleurs, & enfin par tout ce
qui eft capable d’affeéter agréablement le fens
de la , fans parler à l’ame ni à l ’elpric.
On peut l’appeller le flyle ornemental, parce
qu’ il eft propre à orner, à décorer des appartement
, des édifices, mais qu’ il eft indifférent
à l’ inftruélion. On peut aufli l ’appeller 1 e flyle
pittorefque, parce qu’on y recherche tous les
agrémens que peut procurer la peinture proprement
dite, en négligeant les beautés fuperieures
qu’elle doit créer en qualité de poëfie. Jofe-
rois dire qu’on peut même l’appeller le flyle
fenfue l, parce qu’ il ne s’occupe que de flatter
un de nos fens.
Du grand flyle & du flyle d’apparat, le
premier négligeant les beautés iècondaires de
l’art, ou ne ies admettant qu’avec la plu> grande
difcrétion ; le fécond fail’ant de ces agrémens
fecondaires fon principal ob jet, peut fe former
un troifième flyle , compofede l’ un & de l’autre,
moins grand que celui qui ne s’attache qu’à
la beauté par excellence , mais ayant cependant
de la grandeur, & cherchant à la parer
de tous- les agremens que procure l’étude de
la couleur propre, la magie du clair obicur,
& la recherche de ce qu’on appelle la grâ ce ,
qualiLté inferieure à la beauté proprement di e.,
qui tient p: us à !la maîefté. En che- chant ce
flyle compofé, ii eft a fe de tomber dans un
fty-‘ bacard ; de a ,g >ader .par des agrémens
trop fleuris la nob±e lHïj pli cité des grandes
écoles, & de teru ir m ciat de l’école vén tienne
pa> :le mélange d:e ce tte Simplicité. Le grand
flyle aime à être con'èrvé dans fa pureté native;
tout meiange le dégradé.
Le* plus bea-?x modèles qu’on puifle offrir
du flyle compofé iom les ouvrages du Corrège.
Cetartille enchanteur a fu franchir avec luc-
cès une carrière où les chutes font faciles.
Tout co n (pire chez lui à produire un grand
effet : la belle étendue de fes lumières, fa
couleur, fa manière générale de draper, fes
contours coulâns & faciles. Apre* lu i , & peut-
être d’un pas é g a l, marahe le Parmelln , qui
a ennobli la moiltffe eft minée de la manière
moderne, l’a réunie a la {implicite de l’antique
& même à la grandeur’, à là féverité de Michel-
Ange. Tous deux cependant n’ont pu évirer
tous les écueils. En s’efforçant de prodiguer
la grâce à leurs fi jets , ils ont été peut-être au
de-là du but, & font tombés quelquefois dans
l’ affeclation, l’ un des plus grands vices de l’art.
Article extrait des oeuvres de M l if g s G- de
M. R e y n o l d s . ]
SD A V E . (adj.) La fuavité eft une nuance
fine qui tient à la douceur, à l’agrément &
même à la grâce.
On dit un effet, une couleur fuave. Une
eompoficion fuave feroit celle dont toutes les