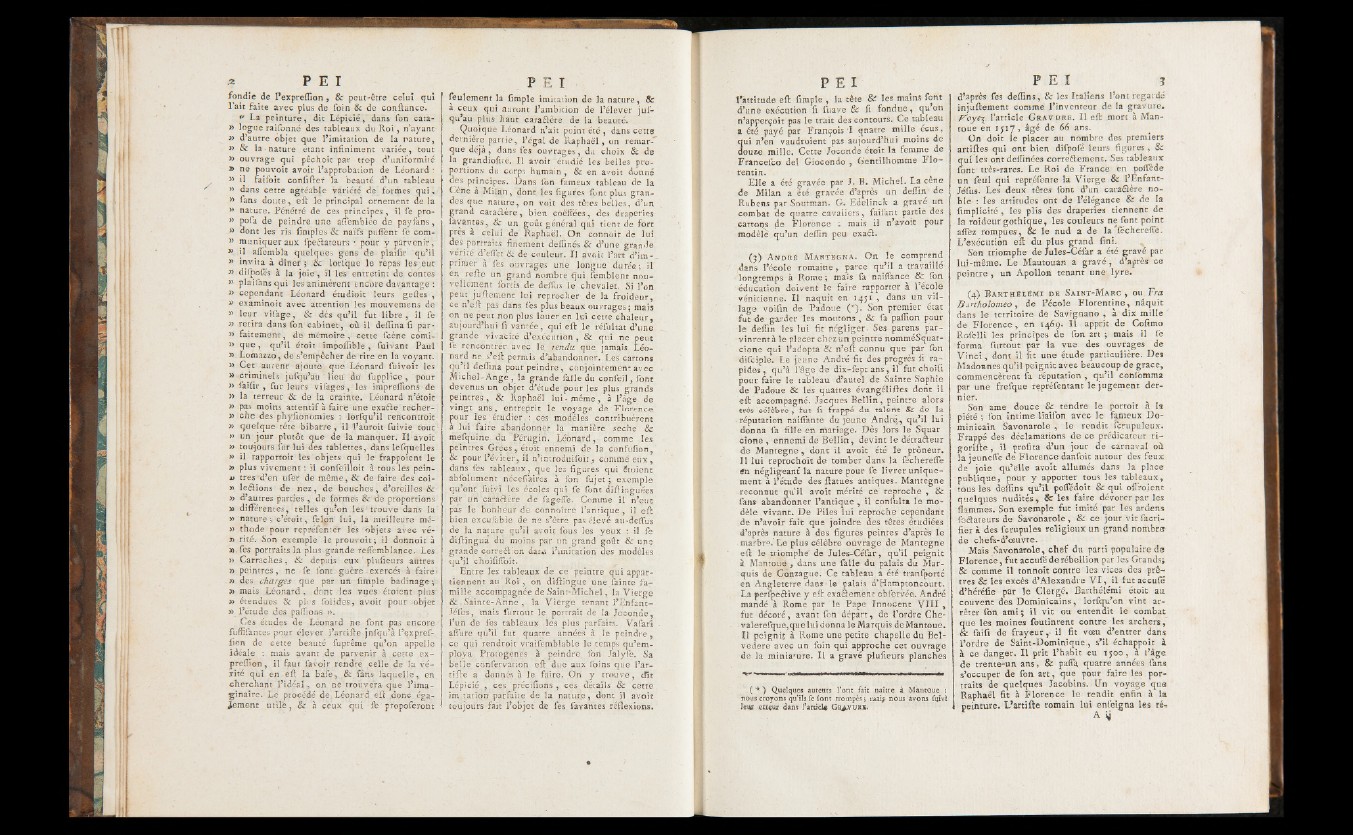
fondîe de l ’expreflion, & peut-être celui qui
1 ait faite avec plus de foin 8c de confiance*
v La peinture, dit Lépicié, dans fon cata-
» logue raifonné des tableaux du R o i, n’ayant 1
» d’autre objet que l’ imitation de la nature,
» & la ' nature étant infiniment variée, tout 1
» ouvrage qui pêchoit par trop d’uniformité
» né pouvoit avoir l’approbation de Léonard :
33 il faifbit confifier la beauté d’ un tableau
» dans cette agréable variété de formes q u i,
33 fans doute, eft le principal ornement de.la
» nature. Pénétré de ces principes, il fe pro-
» pofa de peindre une affemblée de payfans,
» dont les ris fimples & naïfs puffent fe com-
» muniquer aux fpeclateurs • pour y parvenir,
» il aflembla quelques gens de plaifir qu’ il
» invita à dîner; 8c lorlque le repas les.eut
» difpofés à la jo ie , il les entretint de contes
» plailansqui les animèrent encore davantage :
» cependant Léonard étudioit leurs geftes ,
» examinoit avec attention les mouvemens de
» leur vifage, & dès qu’ il fut lib re , il fe
» retira dans fon cabinet, où il deflina fi par-
33 faitement, de mémoire , cette fcène comi-
» q u e , qu’ il étoit impofîïble , fuivant Paul 1
» Lomazzo, de s’empêcher de rire en la voyant.
» Cet autenr ajoute que Léonard fuivoit les I
» criminels jufqü’ au lieu du fupplice, pour
» faifir , fur leurs vifages, les impreflions de
» la terreur 8c de la crainte. Léonàrd n’étoit
» pas moins attentif à faire une exaéte recher-
» che des phyfionomies : lorfqu’ il rencontrôit
» quelque tête bibarre , il l’auroit fuivie tout
» un jour plutôt que de la manquer. I l avoit
» toujours fur lui des tablettes, dans lefquelles
» il rapportoit les objets qui le 1 frappoient le
» plus vivement : il confeilloit à tous lès peinai
tres*d’en ufèr de même, 8c de faire des col-
» le&ions de nez, de bouches^ d’oreilles &
» d’autres parties , de formes & de proportions
» différentes, telles qu-on lé s ; trouve dans la
» nature-, c’étqit, felpn lu i, là meilleure mé-
s) thode pour reprëfefitèr les objets avec vé-
» rite. Son exemple le prou voit ; il donnoit à
».fes portraits la plus grande reffemblance. Les
» Carraches, & depuis eux .plufieurs antres
» peintres, ne fe font guère exercés à faire•
» des charges que par un fimple badinage ;
» mais Léonard, dont les vues étoïent plus
» étendues & plus folides, avoir pour objet
» l’étude des paflîons ». •
Ces études de Léonard ne font pas encore '
fuffifantes pour élever l’artifie jnfqu’à l’qxpref-
fion de cette beauté fuprême qu’on appelle
idéale : mais avant de parvenir à .cette ex-
prefiïon, il faut lavoir rendre celle de la vérité
qui en efi la baie, &, fans laquelle , en
cherchant l’ id é al, on né trouvera- que l’ imaginaire.
Lé procédé de... Léonard .eft dpnc également
u tile , & à ceux qui ffe propoferont *
feulement la fimple imitation de la nature, &
a ceux qui auront l ’ambition de l’élever juf-
qu’au plus haut caraélère de la beauté.
Quoique Léonard n’ait point été , dans cette
dernière partie, l ’égal de Raphaël, on remar-T
que déjà, dans fes ouvrages, du choix 8c de
la grandiofité. Il avoit “étudié les belles proportions
du corps humain , & en avoit donné
des principes. Dans fon fameux tableau de la
Cène à Milan, dont les figures font plus grandes
que nature, on voit des têtes belles, d’ un
grand caraélère, bien çoëftées, des draperies
lavantes, & un goût général qui tient de fort
près à celui de Raphaël. On connoif de lui
dps portraits finement dëffinés 8c d’une grande
vérité, d’effet & de couleur. Il avoit l’ art d’ im-_
primer à fes ouvrages une longue durée; il
en refie un grand nombre (jui femblent nouvellement
forcis de deffus le chevalet. Si l’on
peut jufiemenc lui reprocher de la froideur,
ce n efi pas dans fes plus beaux ouvrages; mais
on ne peut non plus louer en lui cette chaleur,
aujourd’hui fi vantée, qui eft le réfultat d’une
grande vivacité d’ exécution, & qui ne peut
| lé rencontrer avec 1 tendu que jamais Léonard
ne .s‘*eft permis d’abandonner. Lés cartons
qu’ il deflina pour peindre, conjointement avec
Michel-Ange , la grande faile du confeil, font
devenus un objet d’étude pour les plus grands
peintres, 8c Raphaël lui* même, à l’âge de
vingt ans, entreprit le voyage de Florence
pour les ' é t u d ie r c e s modèles contribuèrent
a lui faire abandonner la manière seche 8ç
mefquine, dp Pérugin. Leonard, comme les
peintres Grecs , étoit ennemi de la confufion,
& pour l’éviter, il n’întroduifoit, comme eux ,
dans fes tableaux, que les figures qui ëroient
abfolument néceffaires à fon fujet ; exemple
qu’ont fuivi les écoles qui fe font diftinguées
par un caraélère de fageffe. Comme il n’eut
| pas le bonheur de connoître l’antique, il efi
bien excuiâble de ne s’être pas élevé au-deffus
de la nature qu’il avoit fous les yeux : il fe
diftingua du moins par un grand goût & une
grande correélion darws l’imitation des modèles
qu’il choififfoit.
Entre les tableaux de ce peintre qui appartiennent
au Roi , on diftingue une fainte famille
accompagnée de Saint-Michel, la Vierge
& . Sainte-Anne , la Vierge tenant l ’Enfant-
Jéfus, mais furtout le portrait de la Joconde,
l ’un de fes tableaux les plus parfaits. Vafarî
affure qu’il fut quatre années à le peindre,
ce qui rendrait vraifemblable le temps qu’employa
Protogenes à peindre fon Jalyfe. Sa
belle cônfervanôn eft due aux foins que l’artifie
a donnés à le faire- Oh y trouve, dît
Lépicié , ces précifîons , ces détails & cette
imitation parfaite de la nature :, dont il avoit
! toujours fait l’ objet de fes fayantes réflexions.
l ’attitude eft fimple , la tête & les mains font
d’une exécution fi fuave & fi fondue, qu on
n’apperçoit pas le trait des contours. Ce tableau
a été payé par François‘I qnatre mille ecus,
qui n’en vaudraient pas aujourd’hui moins dé
aouze mille. Cette Joconde étoit la femme de
Francefoo del Giocondo , Gentilhomme F lo rentin.
Elle a été gravée par J. B. Michel. La cene
de Milan a été gravée d’après un deflin ■ de
Rubens par Soutman. G. Edelinck a grave un
combat de quatre cavaliers, failant partie des
cartoqs de Florence : mais il n’avoit pour
modèle qu’un defïïn peu exaél.
(3) A ndré Màntëgna. On le comprend
.dans l’école romaine , parce qu’ il a travaille^
longtemps à Romé; mais fa naiffance & fon
éducation doivent le faire rapporter à l ’école
vénitienne. II naquît en 1451 , dans un v illage
voifin de Padoue (*). Son premier état
fut de garder les moutons, & fa paflion pour
le deflin les lui fit négliger. Ses parens par-
vinrentàle placer chez un peintre nomméSqnar-
cione qui l’adopta 8c n’eft connu que par fon
difciple. Le jeune André fit des progrès fi rapides,
qu’ à l ’âge de dix-fepcans, il fut choifi
pour faire le tableau d’autel de Sainte Sophie
de Padoue & lés quatres évangéliftes dont il
eft accompagné. Jacques B eîlîn, peintre alors
très-célèbre, fut fi frappé du talent & de la
réputation naiffante du jeune André,., qu’ il lui
donna fa fille en mariage. Dès lors le Squar
clone , ennemi dé B e llin , devint le détracteur
de Mantegne, dont il avoit été le prôneur.
I l lui reprochoit de tomber dans la féchereffe
en négligeant la nature pour fe livrer uniquement
a l’étude des ftatues antiques. Mantegne
reconnut qu’il avoit mérité ce reproche , &
fans abandonner l’ antique , il confulta le modèle
vivant. De Piles lui reproche cependant
de n’avoir fait que joindre des têtes étudiées
d’après nature à des figures peintes d’après le
marbra. Le plus célèbre ouvrage de Mantegne
eft le triomphe'de Jules-Céfar, qu’il peignit
à. Mantouë. dans une (aile du palais du Marquis
de Gonzague. Ce tableau a été tranfporté
en Angleterre dans 1® palais d’Kamptoncourt. :
La perfpeélîve y eft exactement cbfervée. André
mandé à Rome par le Pape Innocent V I I I ,
fut décoré, avant fon départ, de l’ordre Ché-:
valerefque,que lui donna le Marquis de Mantoue.
Il peignit à Rome une petite chapelle du Bel-
vedere avec un foin qui approche cet ouvrage
de la miniature. Il a grayé plufieurs planches
( * ”) Quelques auteurs l’ont fait naître à Mantoue :
nous croyons qu’ils fe foait trompés ; ruai; nous avons fuivl
leitf erreur dans l’artick GàMVKS*
d’ après Tes deflins, & les Italiens l’ont regardé
injuftement comme l ’ inventeur de la gravure.
J^oye^ l’article Gravure. I l eft mort à Mantoue
en 1517 j âgé de 66 ans.
On doit le placer au nombre des premiers
artiftes qui ont bien difpofe leurs figures, &
qui les ont deflïnées correctement. Ses tableaux
font très-rares. Le Roi de France en poffède
un feul qui repréfente la Vierge & l’Enfant-
Jéfus. Les deux têtes font d’un caraélère noble
: les attitudes ont de l ’élégance & de la
(implicite , les plis des draperies tiennent de
la roideur gothique, les couleurs ne font point
affez rompues, & le nud a de la fechereffe.
L’exécution eft du plus grand fini.
Son triomphe de Jules-Céfar a été gravé par
lui-même. Le Mautouan a g ra v é , d’après ce
peintre, un Apollon tenant une lyre.
(4) Barthêiémi de Saint-Marc , ou Fra
Bjrtholomeoy de l’école Florentine, nâquit
dans lé territoire de Savignano , à dix mille
de F lo rence, en 1469. I l apprit de Cofimo
Rofelli les principes oe fon. art ; mais il fe
forma furtout par la vue des ouvrages de
V in c i , dont il fit une étude particulière. Des
Madonnes qu’ il peignit avec beaucoup de grâce,
commencèrent fa réputation , qu’ il conlomma
par une frefque repréfentant le jugement dernier.
Son ame douce & tendre le portoit à la
piété ; fon intimé lîaifon avec le fameux Dominicain
Savonarole ; le rendit forupuleux.
Frappé des déclamations de ce prédicateur r i-
g o r ifte , il profita d’un jour de carnaval où
la jeuneffe de Florence danfoit autour des feux
de joie qu’ elle avoit allumés dans la place
publique, pour y apporter tous les tableaux,
tous les deflins qu’ i l poffédoit & qui offroient
quelques nudités, & les faire dévorer par les
flammes. Son exemple fut imité par les ardens
fedateurs de Savonarole, 8c ce jour vit facri-
fier à des fcrupules religieux un grand nombre
de chefs-d’oeuvre.
Mais Savonarole, che f du parti populaire de
Florence , fut accufé de rébellion par les Grands;
& comme il tonnoit contre les vices des prêtres
& les excès d’Alexandre V I , il fut accufé
d’héréfie par le Clergé. Barthéîémi étoit au
couvent des Dominicains, lorfqu’on vint arrêter
fon ami; il v it ou entendit le combat
que les moines fournirent contre les archers,
8c faifi de frayeur ,• il fit voeu d’ entrer dans
l’ordre de Saint-Dominique., s’ il échappoic à
à ce danger. I l prit l’ habit eu 1500, a l’âge
de trente-un ans, & paffa quatre années fans
s’occuper de fon a r t, que pour faire les portraits
de quelques Jacobins. Un voyage que
Raphaël fit à Florence le rendit enfin à la
peiature. L’artifte romain lui enfeigna les ré-»