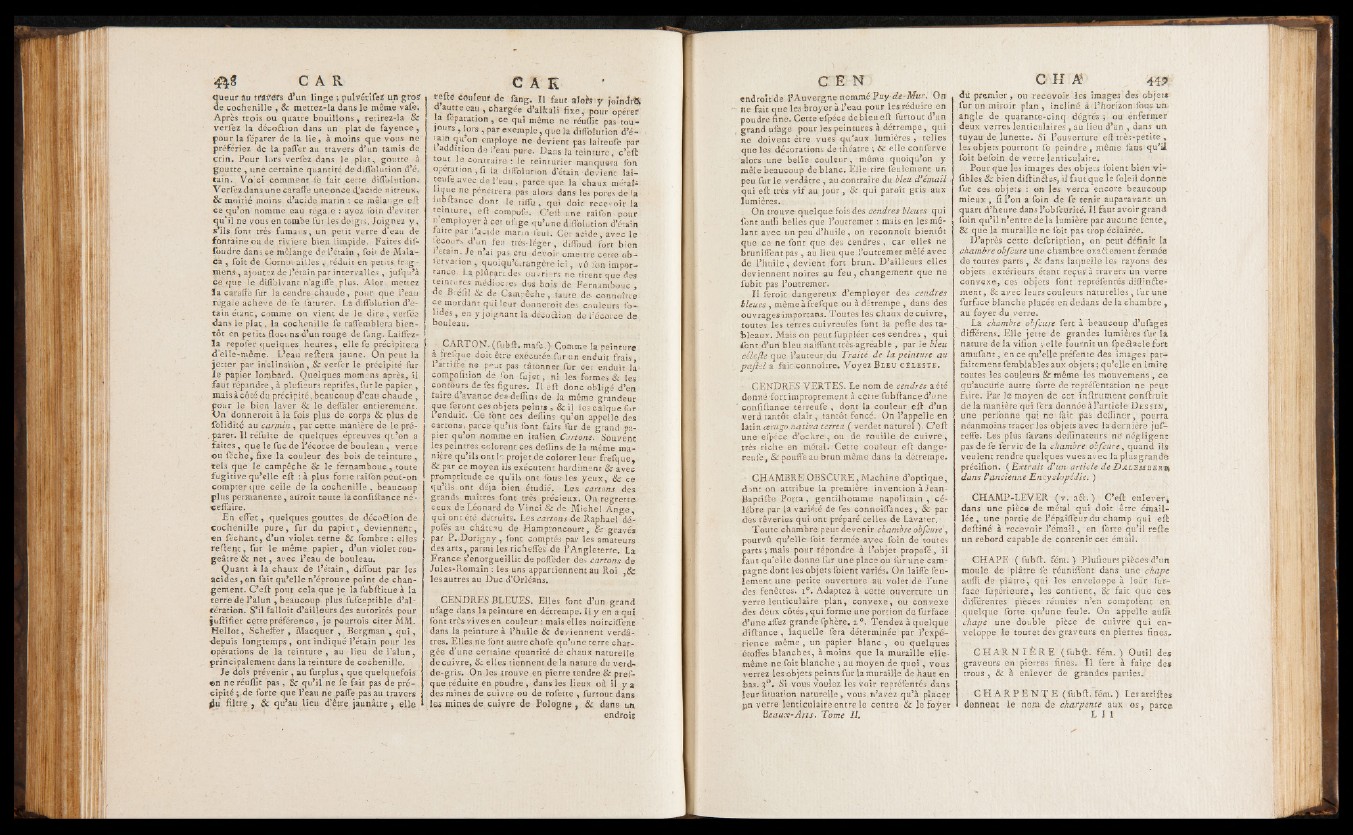
C A R
Cueur au tt'âv’éfs d’ un linge *, pulvérîfetf un gros?
de cochenille , & mettez-la dans le même vafe.
Après trois ou quatre bouillons, retirez-la &
verfez la décoélion dans un plat de fayence,
pour la féparer de la lie , à moins que vous ne
préfériez de la pafler au travers d'un tamis de
crin. Pour lors verlèz dans le plat, goutte à
goutte une certaine quantité de diffolution d’é.
tain. Vo ci comment fe fait cette diffolution.
Verfez dans une caraffe une once diacide nitreux,
& moitié moins d’acide marin : ce mélange eft
ce qu’on nomme, eau régate : ayez foin d’éviter
qu’ il ne vous en tombe lui les doigts. Joignez y ,
s’ ils font très fuma ns, un petit verre d’eau de
fontaine ou de rivière bien limpide. Faites dif-
loudre dans ce mélange de l’étain , foie de Maîa-
ca , foie de Cornouailles ,; réduit en petits frag-
mens , ajoutez de l’étain par intervalles , jufqu’à
ce que le diffoîvant n’agiffe plus. Alor mettez
la caraffe fur la cendre chaude, pour que l’ eau
régale achevé de fe faturer. La diffolution d’e-
tain étant, comme on vient de le d ire , verfée
dans le p la t, la cochenille fe raffemblera bientôt
en petits flocons d’un rouge de fang. Laiffez-
la repo 1er quelques heures, elle fe précipitera
d’elle-même. L’eau refiera jaune. On peut la
jet ter par inclinaifon, & verfer le précipité fur
le papier lombard. Quelques momens après, il
faut répandre, à pLufisurs reprifes, fur le papier ,
mais à côté du précipité, beaucoup d’eau chaude,
pour le bien laver 8c le deffaler entièrement.
On' donneroit à la fois plus de corps & plus de
foliditç au c a r m i n , par cette manière de le préparer.
Il réfulte de quelques épreuves qu’ on a
faites, que le fuc de l'éçorce de bouleau , verte
ou féche, fixe la couleur des bois de teinture,
tels qu.e le campêche & le fernambouc, toute
fugitive qu’ elle efi : à plus forte raifon peut-on
compter que celle de la cochenille , beaucoup
plus permanente, auroit toute laconfiftance né-
«effaire.
En e ffe t, quelques gouttes de décoétion de
cochenille pure, fur dai papier, deviennent,
en féchanc, d’un violet terne & fombre : elles
refient, fur le même papier, d’ un violet rougeâtre
& n e t, avec l’eau de bouleau.
Quant à là chaux de l’étain, diflout par les
acides, on fait qu’elle n’éprouve point de changement.
C’e fl pour cela que je la fubfiitue à la
terre de l’alun , beaucoup plus fufceptible d’altération.
S’il falloit d’ailleurs des autorités pour
juftifier cptte préférence , je pourrois citer MM.
Hellot, Sçheffer , Macquer , Bergman., q u i,
depuis longtemps, ont indiqué l’étain pour les
opérations de la teinture , à11 fieu de l’alun,
principalement dans la teinture de cochenille.
Je dois prévenir , au furplus , que quelquefois
on neréuflit pas , & qu’ il ne fe fait pas de précipité
;d e forte que l’eau ne pàffe pas au travers ;
jju filtre , 8c qu’au lieu d’être jaunâtre, elle
C A R
reftô couleui* de fang. Il faut aîofcs y îoïndt/&
a autre eau , chargée'd’alkali fixe, pour opérer
la leparation, ce qui même ne réunit pas toujours
, lors , par exemple, que la diffolution d’é -
tain qu on employé ne devient pas laiteufe par
l addition de l’eau pure. Dans la teinture, c’efl:
tout ,le contraire : le teinturier manquera fon
operation , fi la diffolution d’étain devient lai—
jeufe avec de l ’feau , parce que la chaux métal-
îqiie ne pénétrera pas alors dans les pores de la
ubitance dont le riffu , qui doit recevoir la
teinture, eft compofe. G’eft une raifon-pour
n employer à cet ufage qu’ une diffolution d’étain
faite par l'acide marin leul. Cër acide, avec le
iecours d’un feu très-léger, diffoud fort bien
1 étam. Je n’ai pas cru devoir omettre cette ob-
l’ervation , quoiqu’éirangère i c i , vô ion importance.
La, pldp^rtdes ou vriers ne tirent que des
teintures médiocres des bois de Fernambouc ,
de Btéiil tic de Campêche, tau te de- connoître
ce mordant qui leur donneroit des couleurs fo-*
lidës, en y joignant la décoélion de l’écorce de
bouleau.
CARTON, (fubft. mafe.) Comme la peinture
â fi’elque doit être exécutée-fur un enduit frais,
l’ artifte, ne peut pas tâtonner fur ceç enduit la'
compofition dé fon fu je t, ni les formes & les
contours de fes figures. Il eft donc obligé d’en
taire d’avance des déifias de la même grandeur
que feront ces objets peints, & il les calque fur
l’enduit. Ce font ces deifins qu’on appelle des
cartons, parce qufils font faits fur de grand papier
qu’on nomme en italien Cartone. Souvent
les peintres colorent ces deifins de la même manière
qu’ ils ontlo projet de colorer leur frefque,
& par ce moyen ils exécutent hardiment & avec
promptitude ce qu’ils ont fous-les yeux, 8c ce
qu’ ils.ont déjà bien étudié. Les cartons des.
grands maîcrès font très précieux. On regrette-
ceux de Léonard de Vinci & de Michel A n g e ,
qui ont été détruits. Les cartons de Raphaël dé-
pofés au château de. Hamptoncourc, & gravés
par P. Do rigny, font comptés par les amateurs
des arts, parmi les richeffes de l ’Angleterre. La
France s’enorgueillit de pofféder des cartons de
Jules-Romain : les uns appartiennent au Roi ,8c
les autres au Duc d’Orléans..
CENDRES BLEUES. Elles font d’un grand
ufage dans la peinture en détrempe. Il y en a qui
font très vives en couleur : mais elles noirciffent
dans la peinture à l’huile & deviennent verdâtres.
Elles ne font autrechofe qu’une terre chargée
d’une certaine quantité de chaux naturelle
de cuivre, & elles tiennent de la nature du verd-
de-gris. On les .trouve en pierre tendre & pref-
que réduite en poudre , dans les lieux où il y a
des mines de cuivre ou de rofette , furtout dans
les mines de cuivre 4e Pologne, & dans un
endroit
C E N
endroit de l’Auvergne nommé Puyde-Mur. On
ne fait que les broyer à l’ eau pour les réduire en
poudre fine. Cette efpéce de bleu eft furtout d’ un
grand ufage pour les peintures à détrempe, qui
ne doivent être vues qu'aux lumières , telles
que les décorations de théâtre -, t ic elle conferve
alors une belle couleur, même quoiqu’on y
mêle beaucoup de blanc. Elle tire feulement un
peu fur le verdâtre , au contraire du bleu d’émail \
qui eft très v if au jou r, & qui paroît gris aux
lumières..
On trouve quelque fois des c e n d r e s b le u e s qui
font autfi belles que l’outremer : mais en les mêlant
avec un peu d’huile, on reconnoît bientôt
que ce ne font que des cendres , ear elles ne
bruniffent pas, au lieu que l’outremer mêlé avec
de l’huile , devient fort brun. D’ailleurs elles
deviennent noires au feu , changement que ne
fubit pas l’outremer.
Il feroit dangereux d’employer des c e n d r e s
b l e u e s , mêmeàfrefque ou à détrempe , dans des
ouvragesimportans. Toutes les chaux de cuivre,
toutes les terres cuivreufes font la pefte des ta- .
idéaux. Mais on peut ïuppiéer ces cendres , qui
font d’ un bleu naiffant très-agréable , par ie b l e u
c é l e j le que l’auteur,du T r a i t é d e l a p e i n t u r e a u
p a j l e l a fait connaître. Voyez B leu c éleste.
- CENDRES VERTES. Le nom de c e n d r e s a été
donné fort improprement à cette fubftance d’une
confiftance terreufe , dont la couleur eft d’ un
•verd tantôt c la ir , tantôt foncé. On l’appelle en
latin a e r iig o n a t i v a t e r r e a .( verdet naturel ). C’eft
une- efpéce d’ochre , ou de rouille de cu iv re ,
très riche en métal. Cette couleur eft dange-
reufe, 8c pouffe au brun même dans la détrempe.
CHAMBRE OBSCURE,Machine d’optique,
dont on attribue la première invention à Jean-
Bapcifte Porta , gentilhomme napolitain , célébré
par la variété de fes connoiffances, & par
des rêveries qui ont préparé.celles de Lavater.
Toute chambre peut devenir.chambre obfcure ,
pourvû qu’elle foit fermée avec foin de toutes
parts *> mais pour répondre à l’objet propofé, il
faut qu’elle donne fur une place ou fur une campagne
dont les objets foient variés. On laiffe feulement
une petite ouverture au volet de Tune
des fenêtres. i° . Adaptez à cette ouverture un
verre lenticulaire plan, convexe, ou convexe
des deux côtés, qui forme une portion de furface
d’ une affez grande fphère. z ° . Tendez à quelque
diftance , laquelle fera déterminée par l’expérience
même , un papier blanc , ou quelques
étoffes blanches, à moins que la muraille elle-
même ne foit blanche -, au moyen de q u o i, vous
verrez les objets peints fur la muraille de haut en
bas. 30. Si vous voulez les voir repréfentés dans
leur fituation naturelle, vous.n’avez qu’à placer
jin verre lenticulaire entre le centre 8c le foÿer
Beaux-Arts. Tome IL
C H A 44?
dû premier, ou recevoir les images des objet*
fur un miroir plan, incliné à l ’horizon fous un-
angle de quarante-cinq degrés ; ou enfermer
deux verres lenticulaires, au lieu d’ un , dans un
tuyau de lunette. Si l’ouverture eft très-petite ,
les objets pourront fe peindre, même fans qu'il
foit befoin de verre lenticulaire.
Pour que les images des objets foient bien v i-
fibles 8c bien diftinêtes, il faut que le foleil donne
fur ces objets : on les verra encore beaucoup
mieux, fi l’on a foin de fe tenir auparavant un
quart d’ heure dans l’obfcùrité. I ! faut avoir grand
foin qu’ il n’ entre de la lumière par aucune fente,
& que la muraille ne foit pas trop éclairée.
D’après ce tte , defcri.ption, on peut définir la
c h a m b r e o b f c u r e une chambre exaélement fermée
de toutes parts , & dans laquelle les rayons des
objets . extérieurs étant reçus à travers un verre
convexe, ces objets font repréfentés difttnéle-
ment, 8c avec leurs couleurs naturelles, fur une
furface blanche placée en dedans de la chambre ,
au foyer du verre.
La chambre obfcure fert à beaucoup d’uPages
differens. Elle jette de grandes lumières* fur la
nature de la vifion *, elle fournit un fpeâacle fort
amufant, en ce qu’elle préfente des images parfaitement
fembiables aux objets ; qu’elle en imite
toutes les couleurs & même les mouvemens , ce
qu’aucune autre forte de repréfentation ne peut
faire. Par le moyen de cet inftrument eon(truie
de la manière qui fera donnée à l’article D essin,
une perlbnne qui ne (ait pas deffiner, pourra
néanmoins tracer les objets avec la dernière juf-
teffe. Les plus ia van s deffinateurs ne négligent
pas defe iervir de la chambre obfcure, quand ils
veu lent rendre quelques v ues av ec la plus gran de
précifion. ( Extrait d’un article de D alember^
dans Vancienne Encyclopédie. )
CHAMPS-LEVER ( v . a é l . ) C’ eft enlever*
dans une pièce de métal qui doit être émaillé
e , une partie de l’épaiffeur du champ qui eft
deftine à recevoir l’émail, en forte qu’il refte
un rebord capable de contenir cet émail.
CHAPE ( fubft. fém. ) Plufieurs pièces d’ un
moule de plâtre fe réunifient dans une chape
aufli de plâtre, qui les enveloppe à leur fur-
face fupérieure, les contient, & fait que ces
différentes pièces réunies n’en eompofent en
quelque forte qu’une feule. On appelle aulïl
chape une double pièce de cuivre qui enveloppe
le touret des graveurs en pierres fines.
C H A R N I È R E (fubft. fém .) Outil des
graveurs en pierres fines. I l fert à faire des
trous , & à enlever de grandes parties.
C H A R P E N T E ( fubft. fém.) Lesartiftes
donnent le nom de c h a r p e n t e aux o s , parce