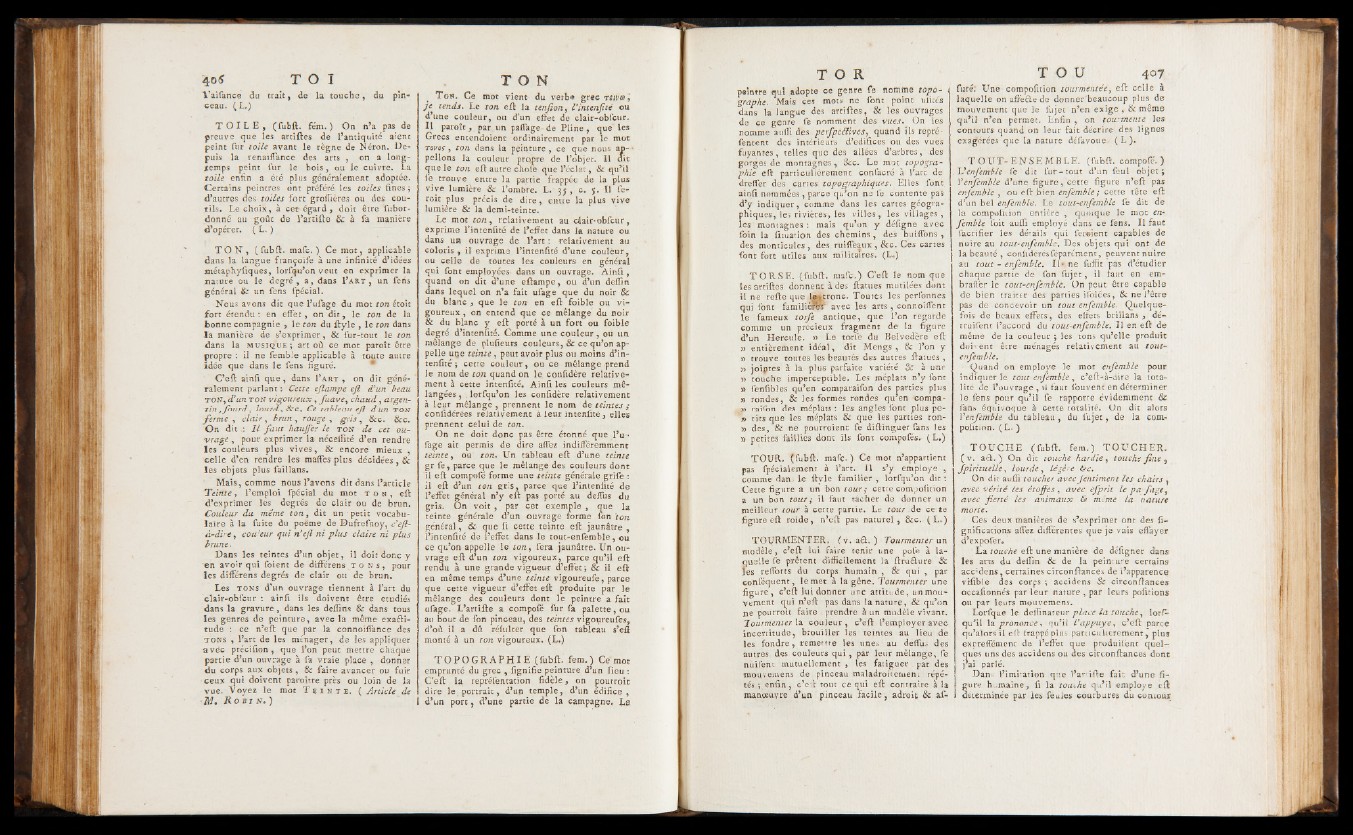
Vaifance du trait, de la touche, du pinceau.
( L.)
T O I L E , (fubft. fém. ) On n’ a pas de
preuve que les artiftes de l’antiquité aient
peint fur toile avant le règne de Néron. Depuis
la renaiffance des arts , on a longtemps
peint fur le bois , ou le cuivre. La
toile enfin a été plus généralement adoptée.
Certains peintres ont préféré les toiles fines;
d’autres des toiles fort groflières ou des coutils.
Le choix, à cet égard , doit être fubor-
donné au goût de l’artifte & à fa manière
d’opérer. ( L. )
T O N , ( fubft. mafc. ) Ce mot, applicable
dans la langue françoife à une infinité d’ idées
métaphyfiques, lorfqu’on veut en exprimer la
nature ou le degré , a , dans I’art , un fens
général 8c un fens fpécial.
Nous avons dit que l’ ufage du mot ton étoit
fort étendu : en e ffe t, on d it , le ton de la
bonne compagnie 3 le ton du ftyle , le ton dans
la manière de s’ exprimer, & fur-tout le ton
dans la m u s iq u e ; art où ce mot paroît être
propre : il ne femble applicable à toute autre
idée que dans le fens figuré.
C ’eft ainfi q u e , dans Part , on dit géné- ‘
râlement parlant 5 Cette ejlampe ejl d’un beau
TON, d’un t o n vigoureux, fuave, chaud, argentin
yfourd, lourdy 8cc. Ce tableau ejl diin t o n
ferme , clair , brun , rouge , g r is , & c . & c.
On dit v: II fa u t hauffer le ton de. cet ouvrage
, pour exprimer la néceflité d’en rendre
les couleurs plus v iv e s , & encore mieux ,
celle d’en rendre les maffes plus décidées, &
les objets plus faillans.
Mais, comme nous l ’avons dit dans l’ article
Teirtte, l’emploi fpécial du mot t o n , eft
d’exprimer les degrés de clair ou de brun.
Couleur du même ton , dit un • petit vocabulaire
à la fuite du poëme de Dufrefnoy, cefi-
à-dire, couleur qui n’ejl ni plus claire ni plus
brune-
Dans les teintes d’ un objet, il doit donc y
en avoir qui foient de différens t o n s , pour
les différens degrés de clair ou de brun.
Les t o n s d'un ouvrage tiennent à Part du
clair-obfcur : ainfi ils doivent être étudiés
dans la gravure, dans les deflins & dans tous
les genres de peinture, avec la même exactitude
: ce n’eft que par la connoiffance des
t o n s , l’art de les ménager, de les appliquer
a v e c précifion , que l’on peut mettre chaque
partie d’ un ouvrage à fa vraie place , donner
du corps aux objets , & faire avancer ou fuir
ceux qui doivent paroître près ou loin de la
vue. Voyez le mot T e i n t e . ( Article de *M• R obin, ) 1
Ton. Ce mot vient du verbe grec t eivaÿ
je tends. Le ton eft la tenfiony l ’intenfté ou
d une couleur, ou d’un effet de clair-obfcur.
I l paroît u par un paffage de P lin e , que les
Grecs entendoient ordinairement par le mot
rovos, ton dans la petqture, ce que nous ap- ■
pelions la couleur prcj^re de l ’objet. I l oit
que le ton eft autre choie que l’éclat, & qu’ il
fe trouve entre la partie frappée de la plus
vive lumière & l ’ombre. L. 25 , c. 5. Il fe-
roit plus précis de dire, entre la plus vive
lumière &: la demi-teinte.
Le mot ton y relativement au cüair-obfcur,
exprime Tintenfité de l’effet dans la nature ou
dans un ouvrage de l’art : relativement au
coloris , il exprime l’ intenfité d’une couleur,
ou celle de toutes les couleurs en générai
qui font employées^ dans un ouvrage. A in f i,
quand on dit d’une eftampe, ou d’ un deflin
dans lequel on n’a fait ufage que du noir &
du blanc > que le ton en eft foible ou vigoureux
, on entend que ce mélange du noir
& du blanc y eft porté à un fort ou foible
degré d’ intenfité. Comme une couleur, ou un
mélange de plufieurs couleurs, & ce qu’on appelle
uije teinte , peut avoir plus ou moins d’ intenfité
; cette couleur, ou ce mélange prend
le nom de ton quand on le confidère relativement
à cette intenfité. Ainfi les couleurs mélangées
, . lorfqu’on les confidère relativement
à leyr mélange , prennent le nom de teintes ;
confidérées relativement à leur intenfité, elles
prennent celui de ton.
On ne doit donc pas être étonné que l ’ u-
fage ait permis de dire affez indifféremment
teinte y ou ton. Un tableau eft d’une teinte
gr fe , parce que le mélange des couleurs dont
il eft compofé forme une teinte générale grife :
il eft d’un ton gris, parce que l’ intenfité de
l’effet général n’y eft pas porté au deffus du
gris. On voit , par cet exemple , que la
teinte générale d’ un ouvrage forme fon ’ton
général, &• que fi cette teinte eft jaunâtre ,
l’ intenfité de l’effet dans le tout-enfemble, ou
ce qu’on appelle le ton, fera jaunâtre. Un ouvrage
eft d’un ton vigoureux, parce qu’ il eft
rendu A une grande vigueur d’effet ; oc il eft
en même temps d’une teinte vigoureufe, parce
que cette vigueur d’effet eft produite par le
mélange des couleurs dont le peintre a fait
ufage. L’artifte a compofé fur fa palette, ou
au bout de fon pinceau, des teintes vigoureufes,
d’où il a dû réfulter que fon tableau s’eft
monté à un ton vigoureux. (L.)
T O P O G R A P H I E (fubft. fem.) Ce mot
emprunté du grec , fignifie peinture d’ un fieu :
C’eft la. repréfentation fidèle, on pourroit
dire le portrait, d’ un temple, d’un édifice,
1 d’ un port, d’une partie de la campagne. L&
paintre qui adopta ce genre fe nomme topo-
graphe. Mais ces mous ne font point ulicés
dans la langue des artiftes, & les ouvrages
de ce genre fe nomment des vues. On les
nomme auffi des perfpeéüvesy quand ils repré-
fentent des intérieurs d’edifices ou des vues
fuyantes, telles que des allées d’arbres, des
gorges de montagnes, &c. Le mot topographie
eft particulièrement confacré à l’ art de
dreffer des cartes topographiques. Elles font
ainfi nommées , parce qu’on ne le contente pas
d’y indiquer, comme dans les cartes géographiques,
les rivières, les v ille s , les villages,
les montagnes : mais qu’on y défigne avec
foin la fituation des chemins, des buiffons ,
des monticules , des ruiffeaux , & c . Ces cartes
font fort utiles aux militaires. (L.)
T O R S E , (fubft. mafc.) C’eft le nom que
les artiftes donnent à des ftatues mutilées dont
il ne refte que le»^tronc. Toutes les perfonnes
qui font familierll^ avec les arts , connoiffent
le fameux torfe antique, que l’on regarde
comme un précieux fragment de la figure
d’un Hercule. » Le torfe du Belvedère eft
» entièrement idéal, dit Mengs , & l’on y
» trouve toutes les beautés des autres ftatues ,
» jointes à la plus parfaite variété & à une
» touche imperceptible. Les méplats n’y font
» fenfibles qu’ en comparaifon des parties plus
» rondes, & les formes rondes qu’en compa-
„>> raifon des méplats : les angles font plus pe-
» tits que les méplats & que les parties ron-
» des, & ne pourroient fe diftinguer fans les
» petites faillies dont ils font compofés- ( L.)
TOUR. (fubft. mafc. ) Ce mot n’appartient
pas fpécialement à l’art, i l s’y employé ,
comme dam le ftvle familier , lorfqu’on dit'.
Cette figure a un bon tour , cette compofition
a un bon tour,* il faut tâcher de donner un
meilleur tour à cette partie. Le tour de ce-te
figure eft roide, n’eft pas naturel, & c . (L .)
TOyRMENTER. (v . aél. ) Tourmenter un
modèle, c’ efl lui faire tenir une pôle à laquelle
fe prêtent difficilement la ftruélure &
îes refforts du corps humain , & qui , par
conféquent, le met à la gêne. Tourmenter une
figure, c’eft lui donner une attitude, un mouvement
qui n’eft pas dans la nature, & qu’on
ne pourroit faire prendre à un modèle vivant.
Tourmenter la couleur , c’eft l’ employer avec
incertitude, brouiller les teintes au lieu de
les fondre, remettre les unes au deffus des
autres des couleurs q u i, par leur mélange, fe
nùifenc mutuellement , les fatiguer par des
mouvemens de pinceau maladroitement répétés
; enfin, c’eft tout ce qui eft contraire à la
manoeuvre d’un pinceau fa c ile , adroit 8c affuré:
Une compofition tourmentée, eft celle a
laquelle on affeéle de donner'beaucoup plus de
mouvement que le lu jet n’en exige , & même
qu’ il n’en permet. Enfin , on tourmente les
contours quand on leur fait décrire des lignes
exagérées que la nature défavoue ( L ).
T O U T -E N S E M B L E , (fubft. compofé.)
enfemble fe dit fur-tout d’un feul o bjet;
Ÿ enfemble d’une figure, cette figure n’ eft pas
enjemble , ou eft bien enfemble ; cette tête eft
d’un bel enfemble. Le tout-enfemble fe dit de
la compofition entière -, quoique le mot enfemble
l’oit -aulïi employé dans ce fens. Il faut
facrifier les dérails qui feraient capables de
nuire au tout-enfemble. Des objets qui ont de
la beauté , confidérésfépartment, peuvent nuire
au tout - enfemble. Il* ne fuffit pas d’étudier
chaque partie de fon fu je t, il faut en em-
brafl'er le tout-enfemble. On peut être capable
de bien traiter des parties ilblées, & ne l’être
pas de concevoir un tout enfemble. Quelquefois
de beaux effets, des effets brillans 3 dé-
truifent l’accord du tout-enfemble. Il en eft de
même de la couleur ; les tons qu’elle produit
doivent être ménagés relativement au tout-
enfemble.
Quand on employé le mot enfemble pour
indiquer le tout-enfemble, c'eft-à-dire la totalité
de l’ ouvrage , il faut fouvent en déterminer
le fens pour qu’il fe rapporte évidemment &
fan» équivoque à cette totalité. On dit alors
Venfemble du tableau, du fu je t, de la compofition.
(L. )
T O U C H E (fubft. fem.) T O U C H E R .
( v. act. ) On dit touche hardie, touche fine ,
Jpirituelle, lourde, Légère £?c.
On dit auffi toucher avec fentiment les chairs,
avec vérité les étoffes, avec efprit le pa fage y
avec fierté les animaux & même là nature
morte.
Ces deux manières de s’exprimer ont des lignifications
affez différentes que je vais effayer
d’expo-fer.
La touche eft une manière de déffgner dans
les arts du deffin & de la peinture certains
acc’dens, certaines circonftances de l’apparence
vrfible des corps ; accidens & circonftances
occafionnés par leur nature , par leurs polirions
ou par leurs mouvemens.
Lorfque le defiinateur place la touche y lorsqu'il
la prononce y qu’il l ’appuyé y c’eft parce
qu’aïorîfil eft frappé plus particulièrement, plus
excreffément de l’effet que produifent quelques
uns des accidens ou des circonftances dont
j’ai parlé.
Dam; l’ imirarion que l’ar-ifte fait d’une figure
humaine, fi la touche qu’ il employé eft
I déterminée par les feules courbures du contour