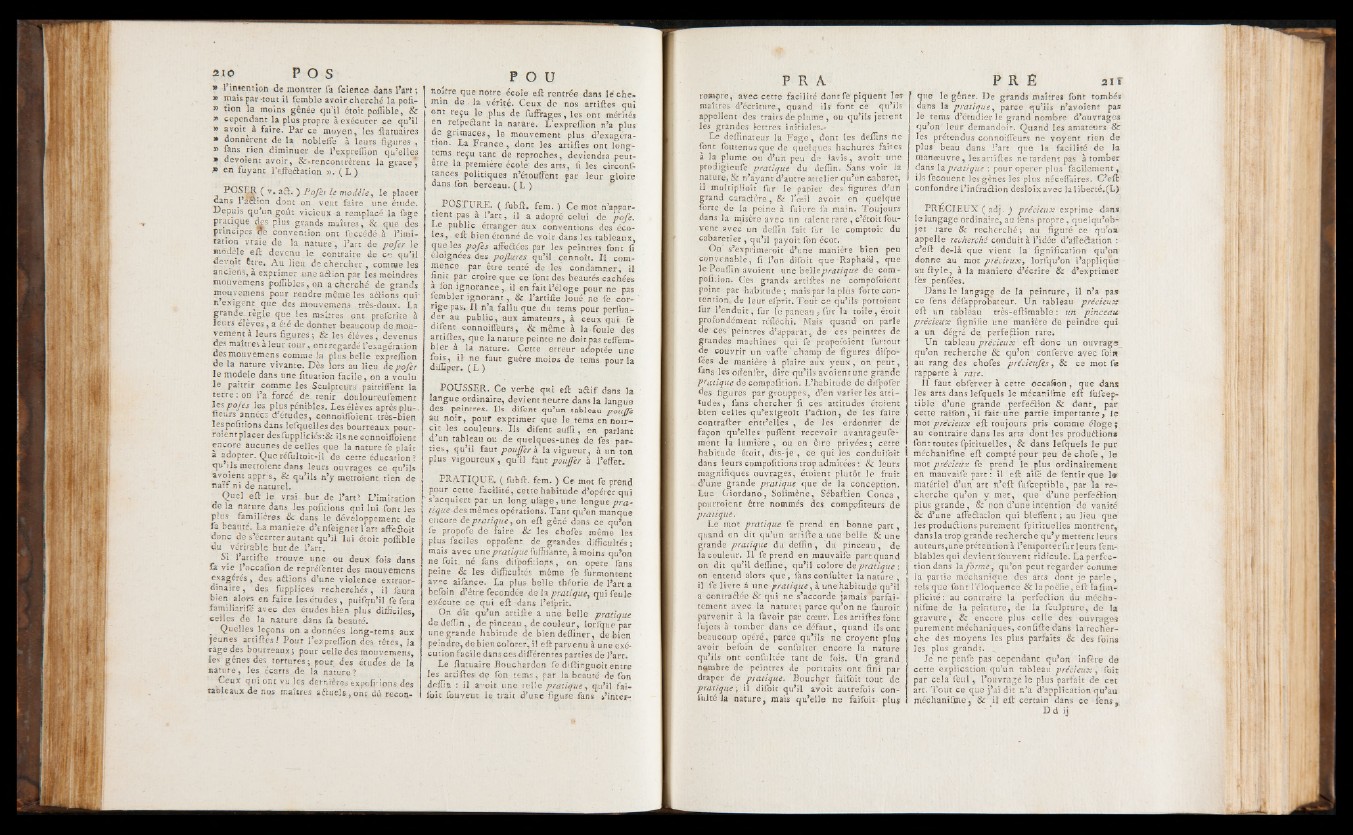
210 P O S
» l’ intention de montrer fa fcience dans l’ art ;
* mais par-tout il femhle avoir cherché la pofi-
» tion la moins gênée qu’il étoit poflible, &
* cependant la plus propre à exécuter ce qu’ il
» avoit a faire. Par ce moyen, les flatuairés
* donnèrent de la noblefle à leurs figaires ,
» fans rien diminuer de l’expreftion qu’elles
* dévoient avoir, &»rencontrèrent la grâce*
* en fuyant l’eftêCtation », ( L )
PDSER ( v. aCt. ) Pofei le modèle, le placer
dans l’action dont on veut faire une étude.
Depuis qu’ un goût vicieux a remplacé la fage
pratique des plus grands maîtres, & que-des
principes oe convention ont fuccédé à l’ imitation
vraie de la nature, l ’art de pofer le
modèle eft devenu le contraire de ce qu’i l_
devqit être. Au lieu de chercher , comme les
anciens, a exprimer une aétion par les moindres
mouvemens poflibles, on a cherché de grands
mouvemens pour rendre même les allions qui'
n exigent que des mouvemens très-doux. La
grande-réglé que les maîtres ont prefcrîte à
leurs eleyes, a été de donner beaucoup de,mouvement
à leurs figures; & les élèves, devenus
des maîtres à leur tour, ont regardé l’ex agération
des mouvemens comme la plus belle expreflïon
de la nature vivante. Dès lors au lieu de pofer
le modèle dans une fituation fac ile, on a voulu
le pattrir comme les Sculpteurs paitriflent la
terre : on l’a forcé de. tenir douloureuiement
le s pojes les plus pénibles. Les élèves après plu-,
fieurs années .d’études, connoiffoient très—bien
lespofitions dans lefquelles des bourreaux pour- ,
roient placer des fuppli,ciés:& ils ne connoiffoient
encore aucunes de celles que la nature fe plaît
a adopter. Que refultoit-il de cette éducation ?
qu ils mettoient dans leurs ouvrages ce qu’ ils
s o ie n t appr s , & qu’ ils n’y metroient rien de
naïf ni de naturel.
Quel eft le vrai but de l’ art? L’imitation
de la nature dans les polirions qui lui font les
plus familières & dans le développement de
fa beauté. La maniéré d’ enfeigner l’art aft'eRoit
donc de s’écarter autant qu’ il lui étoit poflible
du véritable but de l’art.
Si l’artifte trouve une ou deux fois dans
& vie 1 occafion de repréfenter des mouvemens
exagérés, des aâions d’une violence extraordinaire
, des fuppliçes recherchés, il faura
bien alors en faire les études, puifqu’ il fefera
familiarifé avec des études bien plus'difficiles,
celles de la nature dans fa beauté.
Quelles leçons on a données long-tems aux
jeunes artiftes 1 Pour Texpreflion des têtes, la
rage des bourreaux; pour celle des mo uvemens,
les genes des^ tortures ; pour des études de la
nature, les écarts de la nature?
Ceux qui ont vu les dernières expofuions des
tableaux de nos maîtres aû uels , ont dû recou-
P O U
noitre que notre école eft rentrée dans le chemin
de . la vérité. Ceux do nos artiftes qui
ont reçu le plus de fuffrages, les ont mérités
en relpeClant la nature. L’expreflion n’a plus
de grimaces, le mouvement plus d’exagération.
La France, dont les artiftes ont long-
tems reçu tant de reproches, deviendra peut-
etre la première école des arts, fi les circonl-
tances^ politiques n’étouffent par leur gloire
dans l’on berceau. ( L )
. -POSTURE. ( fubft. fem. ) Ce mot n’appartient
pas a l’a r t, il a adopté celui de pofe.
Le public étranger aux conventions des école
s, eft bien étonné de voir dans les tableaux,
que les pofes affeCtées par les peintres font fi
éloignées des pojlures qu’ il connoît. I l commence
par être tenté de les condamner, il
finit par croire que ce font des beautés cachées
a fon ignorance,, il en fait l’éloge pour ne pas
fembler ignorant, & l ’artifte loué ne fe cor- '
rige pas. Il n’a fallu que du teihs pour perfua-
der au public, aux amateurs, à ceux qui fe
difent connoifleurs, & même à la foule des
artiftes, que la nature peinte ne doit pas reffem-
bler à la nature. Cette erreur adoptée une
fo is , il ne faut guère moins de tems pour la
diflïper. ( L )
POUSSER. Ce verbe qui eft aClif dans la
langue ordinaire, devient neutre dans la langue
des peintres. Ils difent qu’ un tableau pouffe
au noir, pour exprimer que le tems en noircit
les couleurs. Ils difent aufii, en parlant
d’ un tableau ou de quelques-unes de fes parties
, qu’ il faut poujfer à la vigueur, à un ton
plus vigoureux, qu’il faut poujfer à l’ effet.
PRATIQUE. ( fubft. fem. ) Ce mot fe prend
pour cette facilité, cette habitude d’opérer qui
s acquiert par un long ufage, une longue pratique
àcs mêmes opérations. Tant qu’on manque
encore de pratique, on eft gêné dans ce qu’on
fe propofe de Faire & les chofes même les
plus faciles oppofent de grandes difficultés ;
niais avec une pratique fuffilante, à moins q u’on
ne foit. né fans diipolùiops, on opéré fans
peine & les difficultés même fe furmontent
avec aifançe. La plus- belle théorie de l’art a
befoin d’être fécondée delà pratique, qui feule
exécute ce qui eft dans l’ elprir.
On dk qu’un artifte a une belle pratique
de deflin , de pinceau , de couleur, lorfque par
une grande habitude de biendefliner, de bien
peindre, de bien colorer, il eft parvenu à une exécution
facile dans ces différentes parties de l’art.
Le ftatuaire Bouchardon fe diftinguoit entre
les artiftes de fon tems, far la beauté de fon
deflin : il avoit une relie pratique, qu’ il fai-
foi t fouveut le trait d’une figure fans s’ intei?-
P R A
rompre, avec cette facilité dontfe piquent les
maîtres d’écriture, quand ils font ce qu’ ils
appellent des traits de plume , ou qu’ ils jettent
les grandes lettrés, initiales.- -
Le deflïnateur la F a g e , dont les deflïns ne
font foutenus que de quelques hachures faites
à la plume ou d’ un peu de lavis, avoit une.
prodigieufe pratique du deflin. Sans voir la
nature, & n’ayant d’autre attelier qu’un cabaret,
il mulciplioit fur le papier des figures d-’ un
grand cara&cre, & l’oeil avoit en quelque
forte de la peine à fuivre fa main. Toujours
dans la misère avec un talent rare , c’étoit fou-
vent avec un deflin fait fur le comptoir du
cabaretier , qu’ il payoitfon écot.
On s’exprimeroit d’une manière bien peu
convenable, fi l ’on difoit que-Raphaël, que
le Pouflin avoient une bellepratique de com-
poliJon. Ces grands artiftes ne compofoient
po^nt par habitude; mais par la plus forte contention.,
de leur efprit. Tout ce qu’ ils portoient
lur l’enduit, fur le pan eau , fur la toile, étoit.
profondément réfléchi. Mais quand on parle
de ces peintres d’apparat, de ces peintres de
grandes machines qui fe proposaient furtout
de couvrir un vafte'champ de figures difpo-
fées de manière à plaire aux yeu x, on peut,
fans les oifenfer, dire qu’ ils avoient une grande
Pratique de compofition. L’habitude de difpofer
d‘es figures par grouppes, d’en varier les attitudes,
fans chercher fi ces attitudes éroient
bien celles qu’exigeoit l’aCtion, de les faire
contrafter entr’elles , de les ordonner de
façon qu’elles puffent recevoir avantageufe-
ment la lumière , ou en être privées ; cette
habitude étoit, dis-je , ce qui les conduifoit
dans leurs compofitions trop admirées : & leurs
magnifiques ouvrages, étoient plutôt le fruit
d’une grande pratique que de la conception.
Luc Giordano, Solimène, Sébaftien Conca ,
pourroient être nommés des comppfiteurs de
pratique.
Le mot pratique fe prend en bonne part,
quand on dit qu’ un arrifte a une belle & une
grande pratique du deflin, du pinceau, de
la couleur. Il fe prend en mauvaife part quand
on dit qu’ il defïïne, qu’ il colore àepratique :
on entend alors que, fans confulter la nature
il fe livre à une pratique, à une habitude qu’ il
a contrariée & qui ne s’accorde jamais parfaitement
avec la nature; parce qu’on ne iauroit
parvenir à la favoir par coeur. Les artiftes font
fujets à tomber dans ce défaut, quand ils ont
beaucoup opéré., parce qu’ ils ne croyent plus
avoir befoin de confulter encore la nature
qu’ ils ont conlultée tant de fois. Un grand,
nombre de peintres de portraits ont fini par
draper de pratique. Boucher faifoit tout de
pratique ; il difoit qu’ il avoit autrefois consulté
la nature, mais qu’ elle ne faifoit plus
P RE air
que le gêner. De grands maître* font tombés
dans la pratique, parce qu’ ils n’avoient pas
le tems d’étudier le grand nombre d’ouvrages
qu’on leur demandoit. Quand les amateurs &
les prétendus connoifleurs ne voyent rien de
plus beau dans l’ art que la facilité de la
manoeuvre, les artiftes ne tardent pas à tomber
dans la pratique : pour operer plus facilement,
ils fecouent les gènes les plus néceffaires. C’eft:
confondre l’infraélion desloix avec la liber té. (L)
PRÉCIEUX ( adj. ; précieux exprime dans
le langage ordinaire, au fens propre, quelqu’ob-
jet rare & recherché; au figuré ce qu’on
appelle recherché conduit à l’idée d’affe&ation :
c’eft de-là que vient la lignification qu’on
donne au mot précieux, lorfqu’on l’applique
au fty le , à la maniéré d’écrire & d’exprimer
fes penfëes.
Dans le langage de la peinture, il n’a pas
ce fens défapprobateur. Un tableau précieux
eft un tableau très-eftimable : un pinceau.
précieiCx fignifie une manière de peindre qui
a un degré de perfection rare.
Un tableau précieux eft donc un ou v ra g e
qu’on recherche & qu’on conferve avec foin
au rang des chofes précieufe.s, & ce mot fs
rapporte à rare.
11 faut obferver à çette occafion , que dans
les arts dans lefquels le mécanifme eft lufcep-
tible d’une grande perfection & dont, par
cette raifon, il fait une partie importante, le
mot précieux eft toujours pris comme éloge ;
au contraire dans les arts dont les productions
font toutes fpirituelles, & dans lefquels le pur
l méchanifine eft compté pour peu de chofe , le
mot précieùx fe prend le plus ordinairement
en mauvaife part : il eft aifé de fentir que 1®
matériel d’ un art n’eft fufceptible, par la recherche
qu’ on v. met, que d’ une perfeétîon
plus grande , 8t non d’ une intention de vanité
& d’une affeâatîon qui bleffent ; au lieu que
les productions purement fpirituelles montrent,
dans la trop grande recherche qu’y mettent leurs
auteurs,une prétention à l’emporter fur leurs fem-
blablesqui devient louvent ridicule. La perfection
dans la forme, qu’on peut regarder comme
la partie méchanioue des arts dont je parle,
tels que font l ’éloquence & la poëfie, eft lafitn-
plicité: au contraire la perfection du mécha-
nifme de la peinture, de la fculpture, de la
gravure, & encore plus celle des ouvrages
purement méchaniques, confifte dans la recherche
des moyens les plus parfaits & des foins
les plus grand?. ~
Je ne penfe pas cependant qu’on infère de
cette explication qu’un tableau précieux, foit
par cela fe u l, l’ouvrage le plus parfait de cet
art. Tout ce que j’ ai dit n’ a d’application qu’au
méchanifine, & il eft certain dans ce fens r
D d ij