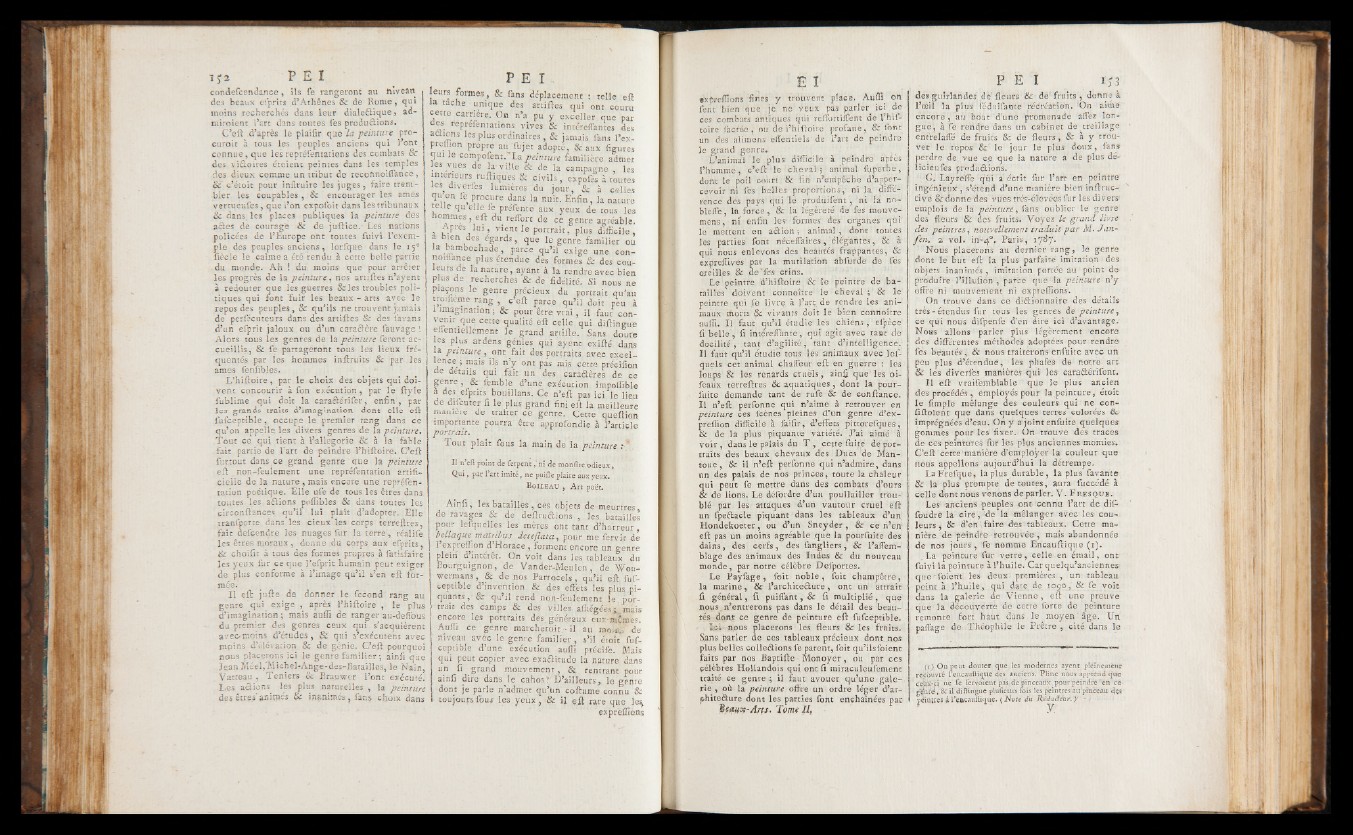
1 J2 P Ë I
condefcendance, ils fe rangeront au niveau
des beaux efprits d’Athènes & de Rome, qui
moins recherchés dans leur dialeétique* ad-
miroient l’ art dans toutes les productions.
C’eft .d’après le plaifir que la peinture procurait
à tous les peuples anciens qui l’ont
connue , que les repréfentations des combats &
des victoires étoienc peintes dans les temples
des dieux comme un tribut de recoftnoiflance,
8c c’étoit pour inflruire les ju g e s, faire trembler
les coupables , & encourager les âmes
vertueui.es, que l’on expofoit dans les tribunaux
& dans les places publiques la peinture des
aCtes de courage & de juftice,- Les nations
policées de l’Europe ont toutes fuivi l’exemple
des peuples anciens, lorfque dans le 15e
fiècje le calme a été rendu à cette belle partie
du monde. Ah ! du moins que pour arrêter
les progrès de la peinture, nos artiftes n’ayent
à redouter que les guerres & les troubles politiques
qui font ïuir les beaux - arts avec le
repos des peuples, & qu’ ils ne trouvent jamais
de perfecuteurs dans des artiftes & des la vans
d’ un efprit jaloux ou d’un caractère fauvage
Alors tous les genres de la peinture feront accueillis,
& fe partageront tous les lieux fréquentés
par les hommes inftruits & par -les
âmes fenfibles;
L’hiftoire, par le choix des objets qui doivent
concourir à fon exécution, par le ftyle
fublime qui doit la caraClérifer, enfin , par
les grands traits d’ imagination dont elle eft
fufcept-ible, occupe le premier rang dans ce
qu’on appelle les divers genres de la peinture.
Tout ce qui tient à l’allegorie & à la fable
fait partie de l’art de peindre l’hiftoire. C’eft
furtout dans ce grand genre que la peinture
eft non-feulement une repréfentation artificielle
de la nature, mais encore une repréfentation
poétique. Elle ufe de tous les êtres dans
toutes les aClions poflibles & dans toutes les
çirconftances qu’ il lui plaît d’adopter. Elie
tranfporte dans les cieux les corps terreftres,
fait defçendre les nuages fur la terre, réalife
les êtres moraux, donne du corps aux efprits,
8c choifit à tous des formes propres à fatisfaire
les yeux fur ce que Fefprit humain peut exiger
de plus conforme à l’ image qu’ il s’en eft formée.
Il eft jufte de donner le fécond rang au
genre qui exige , après l’hiftoire , le plus
d’ imagination ; mais auffi de ranger au-deffous
du premier des genres ceux qui s’acquièrent
avec*moins d’études, 8c qui s’exécutent avec
moins d’élévation 8c de génie. C’eft pourquoi
nous placerons ici le genre familier *, ainfi que
Jean Mëel/Michel-Ange*des-Batailles, le Nain,
Vatteau , Teniers & Brauwer l’ont exécuté.
Le s actions les plus naturelles , la peinture
des êtres'animés oc inanimés, fans choix dans
p e 1
leurs formes, & fans déplacement : telle eft
la tache unique des artiftes qui ont couru
cette carrière. On n’a pu y exceller que par
aes reprelentations vives & inte'reffantes des
actions les plus ordinaires , & jamais fans l’expo.“
1011 propre au fujet adopté, & aux figures
qui le compofent.’ L a peinture familière admet
es vues de la-ville & de la campagne les
inteneurs ruftiques & c iv ils , expofés à toutes
les, dtverfes lumières du jour, & à celles
qu on fe procure dans la nuit. Enfin, la nature
telle qu elle fe préfente aux yeux de tous les
hommes, eft du reffort de ce genre agréable.
, Apr* lu i , vient le portrait, plus difficile ,
a bien des égards, que le genre familier ou
la bâmbochade, parce qu’ il exige une con-
noillance plus étendue des formes & des couleurs
de la nature, ayant à la rendre avec bien
p us de recherches & de fidélité. Si nous ne
plaçons le genre précieux du portrait qu’ au
troilieme rang , c eft parce qu’ il doit peu à
1 imagination ; & pour être v ra i, il faut convenir
que cette qualité eft celle qui diftingue
effentiellement le grand artifte. Sans doute
les plus ardens génies qui ayent exifté' dans
:a peinture , ont fait des portraits, avec excel-
lence ; mais ils n’y ont pas mis cette précifion
de details qui fait un des caraâères de ce
f e? re 1 8e lèmble d’une exécution impolfible
a dès efprits bouillans. Ce n’eft pas ici le lieu
de difeuter fi le plus grand fini eit la meilleure
manière de traiter ce genre. Cette queftion
importante pourra être "approfondie à l’article
portrait.
Tout plaît fous la main de la peinture :*
Il n’ eft point de ferpent ,’ ni de monftre odîeux,
Q u i, par l ’art imité, ne pillée plaire aux yeux,
Boileau , Art poër,
Ainfi, les batailles , ces objets de meurtres,
de ravages St de . deftruâions , les batailles
pour lefquelles les1 mères ont tant d’horreur,
bellaque mattibus .lete/lata, pour me fervjr de
l ’exprelfion d’Horace , forment encore un genre
plein d’intérêt. On voit dans les tableaux du
Bourguignon, de Vander-Meulen , de 'Wou-
wermans, St de nos Parrocels, qu’il eft fuf-
ceptible d’invention & des effets les plus piquants,
& qu’ il rend non-feulement le .p o r trait
des camps & des villes alliégées j - mais
encore les portraits dès généraux eux-mêmes.
Auffi ce genre marchëroit il au mo.t),, de
niveau avèc le genre familier, s’ il étoit fuf-
ceptible d’une exécution auffi précife. Mais
qui peut copier avec exa&itude la nature dans
un fi grand mouvement, & rentrant pour
ainfi dire dans le cahos b D’ailleurs, le genre
dont je parle n’admet qu’ un coftume connu &
toujours fous les y eu x , & il eft rare que le$
expreffians
E I
expreffions fines y trouvent place. Aufll on
fent bien que je ne veux pas parler .ici de
ces combats antiques qui refïbrtiffent de l’ hiftoire
facrée , ou de l’hiftoire profane, & font
un des alimens èffentiels de l’ art de peindre
le grand genre.
L’animal le plus difficile à peindre aptes
l’hommè , c’eft 1 le cheval ; : animal fyperbe ,
dont le poil court & fin n’enipê'che d’apper-
cevoir ni fes .belles proportions;- ni la différence
dès pays qui le produifent, ni la no-
bleffe, la force, & la légèreté de fes mouve-
mens, ni enfin les formes des organes qûi
le mettent en aétion-, animal-, dont toutes
les parties font nëceffaires, ’élégantes, & a
qui nous enlevons de3 beautés frappantes, &
exprefiiv,es par la mutilation abfurde de fés
oreilles & de Tes crins.
Le peintre d’hiftoire & le peintre de batailles
doivent .connôître- le cheval 8c le
peintre qui fe livre à l’a r id e rendre les animaux
morts. & vivants doit lé bien connoître
auffi. Il faut qu’ il étudie- les chiens , efpèce
fi belle ,' fi intereflante, q!ui agit avec tant de
docilité, tant d’agilité, tant d’intelligence.
Il faut qu’ il étudie tous lés animaux avec lesquels
cet animal chaffeur eft en guerre- : les
loups & les renards cruels, ainfi que les oi-
feaux terreftres & aquatiques, dont la poür-
fuite demande tant de rufe & de confiance.
I l n’eft perfonne qui n’aime à retrouver en
peinture ces fcènes pleines d’ un genre d’ ex-
preffion difficile à faifir, d’effets pittorefques,
& de la plus piquante variété. J’ai aimé à
voir , dans le palais du T , cette fuite de portraits
des beaux chevaux des Ducs de Man-
toue, & il n’eft perfonne qui n’admire, dans
un des palais de nos princes, toute la chaleur
qui peut fe mettre dans des combats d’ours
& de lions. Le défordre d’ un poullailler trou-'
blé par les. attaques d’ un vautotir cruel èft
un fpeétacle piquant dans les tableaux d’un
Hondekoeter, ou d’ un Sneyder, & ce n’en-
eft pas un moins agréable que la pourfuite des
dains, des cerfs, des fangliers, & l’affem-
blage des animaux des Indes & du nouveau
monde, par notre célèbre Defportes.
Le Payfage, foit noble , foie champêtre,
la marine, & l’ architeélure, ont un attrait
fi général, fi puiflant, & fi multiplié, que
nous „n’entrerons pas dans le détail des beautés
dont ce genre de peinture eft fufceptible.
Ici nous placerons les fleurs & les frùits.
Sans parler de ces tableaux précieux dont nos
plus belles collections fe parent, foit qu’ ils foient
faits par nos Baptifte - Monoyer , ou par ces
célèbres Hollandois qui ont fi miraculeufement
traité ce genre ; il faut avouer qu’ une galerie
, où la peinture offre un ordre léger d’ar-
j&hiteâure dont les parties font enchaînées par
p e 1 m
des guirlandes'de’ fleurs 8c d e 'fru its , donne à
l’oeil la plus féduifante récréation. On aimé
encore , au bout d’une promenade affez longue,
à fe rendre dans un cabinet de treillage
entrelaifé de fruits & de fleurs, & à y trouver
le. repos 8c le jour le plus doux, fans
perdre de vue ce que la nature a de plus défie
ié 11 fés productions.
N G. Layréffe ’qui a écrit fur l’art en peintre
ingénieux , s’étêrid d’une manière bien inftrue-
ci vë & donne des vues très-élevées fur les divers
emplois de là peinture, ans oublier le genre
des fleurs & des fruits. Voye2 le grand livre
des peintres, nouvellement traduit par M. Jan-
J'en, % vol. in-4®. Paris, 1787. ;
Nous placerons au dernier rang5 le genre
dont le but-eft la plus parfaite imitation des
objets inanimés , imitation portée au point de-
prèduttè • l’i-flufiôn-, parce que -la peinture n’y
offre ni mouvement ni expierions.
On trouve dans ce dictionnaire des détails
très-étendus fur tous les genres de peinture,
ce qui nous difpenfe d’en dire ici d’avantage.
Nous allons parler plus légèrement encore
des différentes méthodes adoptées pour rendre
fes beautés, & nous traiterons ènfuite avec un
peu plus d’étendue, les phafès de notre art
8c les diverfes manières qui les caraCtérifent.
I l eft vraifemblable que îe plus ancien
des procédés , émployés pour la peinture, étoit
le fimple mélange des couleurs qui ne con-
fiftoient que dans quelques terres colorées &
imprégnées d’eau. On y adjoint enfuite quelques
gommes pour les fixer. On trouve des traces
de ces-peintures fur lés plus anciennes momies.
C’eft cette1 manière d’employer la couleur que
nous, appelions aujourd'hui là détrempe.
La Frefque, la plus durable, la plus favante
& la plus prompte de toutes, aura fucccdé à
celle dont nous venons de parler. V . Fresque.
Les1 ancien^ peuples ont connu l’art de dif-
foudrè là c iré, :de la mélanger avéc les cou-.»
leurs, & d’en-Taire dés tableaux. Cette manière
de peindre retrouvée , mais abandonnée
de nos jours , fe nomme Encauftique (1).
.L a peinture fur verre, celle en émail, ont
fuivi la peinture à l’huile. Car quel qu’ancien nés-
que'foient les deux- premières , un tableau
peint à l’huile.,, qui date de 1090 , & fe voit
dans la galerie de Vienne , eft une preuve
que la découverte de cettè forte de peinture
remonte fort haut dans le moyen âge. Un
pacage de Théophile le Prêtre , cité dans le
(r) On peut douter que les modernes ayent pleinement:
recouvré l’ encauftique des anciens. Pline nous apprend que
ceux-ci ne fe feryôient pas de pinceaux pour peindre en ce
gçntëÿ & il diRingue plufieurs rois les peintres au'pmceau dçs
fin îte s à l ’eacauftique. {Note du Rédacteur. )- -