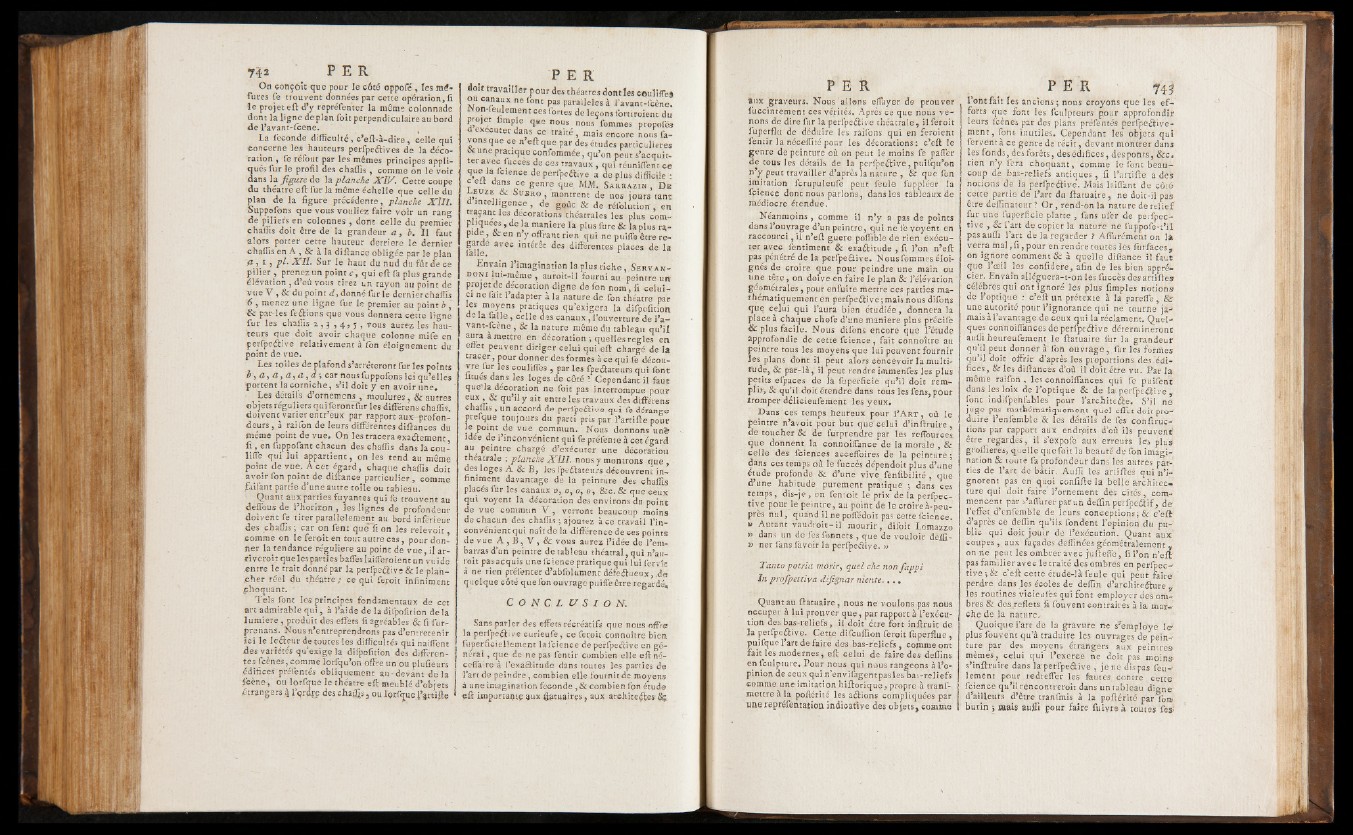
7*2 PER
On conçoit que pour le côté oppofé, les mé-
fures fe trouvent données par cette opération, fi
le projet eft d’y repréfen'ter la même colonnade
dont la ligne de plan foit perpendiculaire au bord
de l’avant-feene.
La leconde difficulté, c’eft-à-dire, celle qui
Concerne les hauteurs perfpeéltves de la décoration
, le refout par les mêmes principes appliqués
fur le profil des chaffis , comme on le voit
dans la figure de la planche XII/. Cette coupe
du théâtre eft fur la même échelle que celle du
plan de la figure précédente, planche X I I I .
Suppolbns que vous vouliez faire voir un rang
de piliefs en colonnes , dont celle du premier
chaffis doit être de la grandeur a , b. I l faut
alors porter cette hauteur derrière le dernier
chaffis en A , & a la diftance obligée par le plan
c , i , p i. X I I . Sur le haut du nud du fût de ce
pilier | prenez un point c , qui eft fa plus grande
élévation , d’où vous tirez un rayon au point de
vue V , & du point d , donné fur le dernier chaffis
6 , menez une ligne fur le premier au point b ,
& par-les feâions que vous donnera cette ligne
fur les c t a i ï i s z , 3 , 4 , 5 , vous aurez les hauteurs
que doit avoir chaque colonne mife en
petftpeftive relativement à fon éloignement du
point ds vue.
Les toiles de plafond s’arrêteront fur les points
b , ü . a . cl. ü.. d car nous fuppofons ici qu’elles
portent la corniche, s’ il doit y en avoir une.
Les détails d’ornemens , moulures, & autres
objets réguliers quiferontfur les différens chaffis,
doivent varier entr’eux par rapport aux profondeurs
, à rai fon de leurs différentes diftances du
même point de vue. On les tracera exaélement
f i , en fuppofant chacun des chaffis dans la cou-
liffe qui lui appartient, on les tend au même
point de vue, A cet égard, chaque chaffis doit
avoir fon point de diftance particulier, comme
Enfant partie d’une autre toile ou tableau.
■ Quant aux parties fuyantes qui fe trouvent au
deffous de l ’horizon , les lignes de profondeur
doivent fe tirer parallèlement au bord inférieur
des chaffis; car on fent q u e l! on les relevoit
comme on le ferait en tout autre cas, pour donner
la tendance régulière au point de vue il arriverai
t que les parties baffes laifferoient un vu ide
entre le trait donné par la perfpetftive&le plancher
réel du théâtre ; ce qui ferait infiniment
choquant. -
Tels font les principes fondamentaux de cet
art admirable q u i, à l’aide de ladifpofuion delà
lumière , produit des effets fi agréables & fi fur-
prenans. Nous n’entreprendrons pas d’entretenir
ic i le leéteur de toutes les difficultés qui naiffent
des variétés qu’exige la difpofition des différentes
fcènes, comme lorfqu’on offre un ou plufieurs
édifices'préfentés obliquement au-devant delà
fcène-, ou lorfque le théâtre eft meublé d’objets
etrangers à l’ordre des chaffis, ou lorfque l im i t e
P E R
doit travailler pour des théâtres dontles couliffe»
ou canaux ne font pas parallèles à l’avant-fcène.
Non-feulement ces fortes de leçons lbrtiroient du
projet impie que nous nous fommes propofés
d exeouter dans ce traité, mais encore nous favoris
que ce n eft que par des études particulières
«une pratique confommée, qu’on peut s’acquitter
avec fucces de ces travaux, qui réunifient ce
que la ictence de perfpe&ive a de plus difficile :
c eit dans ce genre que MM. Sarrazin , De
leuze & Susho, montrent de nos jours tant
d intelligence , de goût & de rélblution , en
tiaçant les décorations théâtrales les plus com-
•d<JUe| S,del>amaniere la Plus fine & laplus rapide,
&en n’y offrant rien qui ne puiffa être regarde
avec intérêt des différentes places de la
ialle. r
En vain l’imagination la plus riche ,.Ser va n-
doni Jui-meme , auroit-il fourni au peintre un
projet de décoration digne de fon nom, fi celui-
ci ne lait l’adapter à la nature de Ton théâtre par
les moyens pratiques qu’exigera la difpofition
de la falie, celle des canaux, l’ouverture de l’avant
fcène , & la nature même du tableau qu’il
aura a mettre en décoration -, quelles regies en
effet peuvent diriger celui qui eft chargé de la
tracer, pour donner des formes à ce qui fe décou-
vre lur les couliffes , par les fpeélateurs qui font
lieues dans les loges de côté ? Cependant il faut:
que’la décoration ne foit pas interrompue pour
CuX/r ^ y a*c entre les travaux des différens
chaffis , un accord de perljpeéUve qui Te dérange
prefque toujours du parti pris par Tartifte pour
le point de vue commun. Nous donnons une?
idée de l’inconvénient qui fe préfente à cet égard
au, peintre chargé d’exécuter une décoratiou
théatrale : planche 'III. nous y montrons que,
des loges A & B, les fpeélateu^s découvrent infiniment
davantage de la peinture des chaffis
places für les canaux o,.o, o, o, &c. 8c que ceux
qui voyent la décoration des environs du point
de vue commun V , verront beaucoup moins
de chacun des chaffis ; ajoutez à ce travail l’inconvénient
qui naît de la différence de ces points
de vue A , B , V , & vous aurez l’idée de l’em-
barrasd’un peintre de tableau théâtral, qui n’au-
roit pas acquis une fcience pratique qui lui fer vît
à ne rien préfenter d’abfoiument défectueux, .de
quelque côté que fon ouvrage puiffe être regardé,
C O N C L U S 1 O N.
Sans parler des effets récréatifs que nous offres
la perfpeftive curieufe, ce feroit connoître bien
fuperficiellement la fcience de perfpeétive en général
, que de ne pas l’en tir combien elle eftné-
I eeffairé à l'exactitude dans toutes les parties de l’art de peindre, combien elle fournit de moyens
à une imagination féconde, & combien fon étude
«ft importante aux ftatuairçs ? aux archite$es 8c,
lu x graveurs. Nous allons effayer de prouver
fuccincément ces vérités. Après ce que nous venons
de dire fur la perfpèéfcive théâtrale, il feroit
fuperflu de déduire les râilons qui en feroient
fencir la néceflité pour les décorations: c’eft le
genre de peinture où on peut le moins fe paffer
de tous les détails de la perfpeétive, puifqu’on
n’y peut travailler d’après la nature , & que fon
imitation fcrupuleufe peut feule fuppléer la
fcience dont nous parlons, dans les tableaux de
médiocre étendue.
Neanmoins , comme il n’y a pas ds points
dans l’ouvrage d’un peintre, qui ne le voyent en
raccourci, il n’eft guere poflible de rien exécuter
avec fentiment & exactitude , fi l’on n’ eft
pas pénétré de la perfpeCtive. Nous fommes éloignés
de croire que pour peindre une main ou
une tête, on doive en faire Je plan 8c l’élévarion
géométrales, pour enfuite mettre ces parties mathématiquement
en perfpeCtive;mais nous difons
que celui qui l’aura bien étudiée, donnera la
place a chaque choie d’une maniéré plus précife
8c plus facile. Nous difons encore que l’étude
approfondie de cette fcience, fait connoître au
peintre tous les moyens que lui peuvent fournir
les plans dont il peut alors concevoir la multitude,
& par-là, il peut rendreimmenfes les plus
petits efpaces de là fuperficie qu’ il doit remplir,
& qu’il doit étendre dans tous les fens, pour
tromper délicieufement les yeux.
Dans ces temps heureux pour I’Ar t , où le
peintre n’avoit pour but que celui d’ inftruire,
de toucher 8c de furprendre par les reffources
que donnent la connoiffance de la morale , &
celle des fciences acceffoires de la peinturé ;
dans c es temps où le fuccès dépendoit plus d’une
étude profonde & d’une vive fenfibilité , que
d’une habitude purement pratique ; dans ces
temps, dis-je , on fentoit le prix de la perfpeCtive
pour le peintre, au point de le croire à-peu-
pres nul, quand il ne poffédoit pas cette fcience.
» Autant vaudroit-îl mourir, difoit Lomazzo
» dans un de Tes fonnets , que de vouloir deffî-
» ner fans favoir la perfpeCHye. »
Tanto potria. môrir, quel che nonfappi
In profpettiva difignar niente. . . ,
Quant au ftatuaire, nous ne voulons pas nous
occuper a lui prouver que, par rapport à l’exécution
des bas-reliefs, il doit être fort inftruit de
la perfpeCUve. Cette difeuflion feroit ffiperflue ,
puifque l’art de faire des bas-reliefs, comme ont
fait les modernes, eft celui de faire des deflins
en fculpture. Pour nous qui nous rangeons à l’opinion
de ceux qui n’en vifagentpasles bas-reliefs
comme une imitation hiftorique^ propre à tranf-
mettre a la poftérité les aéfcions compliquées par
une repréfentation indicative des objets> comme
1 ont fait les anciens; nous croyons que les efforts
que font les fculpteurs pour approfondir
leurs fcèné's par des plans préfentés perfpe&ive-
ment, font inutiles. Cependant les objets qui
fervent à ce genre de récit, devant montrer dans
les fonds, des forêts, des édifices, des ponts, 8cc*
rien n’y fera choquant, comme le font beaucoup
de bas-reliefs antiques , fi l’artifte a des
nocions de la perfpeftive. Mais biffant de côté
cette partie de l ’art du ftatuaire, ne doit-il pas
être deflinateur? O r , rend-on la nature de relief
fur une fuperficie plante , fans ufer de perfpeCtive
, 8c l’art de copier la nature ne fuppofe-t’ il
pasauflî l’art de la regarder ? Affurémenton la
verra m a l,fi, pour en rendre toutes lès furfaces,
on ignore comment & à quelle diftance il faut
que l’oeil les confidere, afin de les bien apprécier.
Envain alléguera-t-on les fuccès desartiftes
célébrés qui ont ignoré les plus fimples notions
de l’ optique ; c’eft un prétexte à la pareffe, 8c
une autorité pour l’ ignorance qui né tourne jamais
à l’avantage, de ceux qui la réclament. Quelques
connôiffances de petfpeéiive détermineront
auffi heureufement le ftatuaire fur la grandeur
qu’il peut donnér a Ion ouvrage, fur les formes
qu’il doit offrir d’après les proportions des .édifices,
& les diftances d’où il doit être vu. Par la
même raifon , les connoiffances qui fe puifenc
dans les loix de Toptique 8c de la:perfpeéUv-e
font indifpenfables pour l’archite<fte* S’ il ne
juge pas mathématiquement quel effet doit pro-
duire l’enfemble & les détails de fies conftruc-
tions par rapport aux endrpits d’où ils peuvent
être regardés, il s’expofie aux erreurs les plus
groffierès, quelle que foit la beauté de fon imagination
& toute fia profondeur dans les autres parties
de l’art de bâtir. Auffi les artiftes qui n’ignorent
pas en quoi confifte la belle architecture
qui doit faire l’ornement des cités, commencent
par s’affurerparun deffin perfipe&if de
l’effet d’ enfiemble de leurs conceptions; & c ’eft
d’après ce deffin qu’ils fondent l’opinion du public
qui doit jouir de l’exécution. Quant aux
coupes , aux façades defîinées géométralemetit ÿ
on ne peut les ombrer avec ÿufteffe, fi l’on n’eft
pas familier avec le traité des ombres en perfipec--
tive ; & c’eft cette étude-là feule qui peut faire
perdre dans les écoles de deffin d’architeéhire ÿ
les routines vicieufies qui font employer des ombrés
& des^reflets fi fiouvent contraires à la marche
de la nature.
Quoiqu-e l’art de la gravure ne s*emploÿe le*
plus louvent qu’à traduire lés ouvrages de peinture
par des moyens étrangers aux peintres
mêmes, celui qui l’exerce ne doit pas moins
s’ inftruire dans la’perfpe&ive , j.e ne dis pas fieu--
lemént pour redreffer les fautes contre cette
fcience qu’ il rencontreroit dans un tableau digne-
d’ailleurs d’ être tranfimis à la poftérité par Ion*
burin ; mais aufii pour faire fuiyre à toutes feÿ