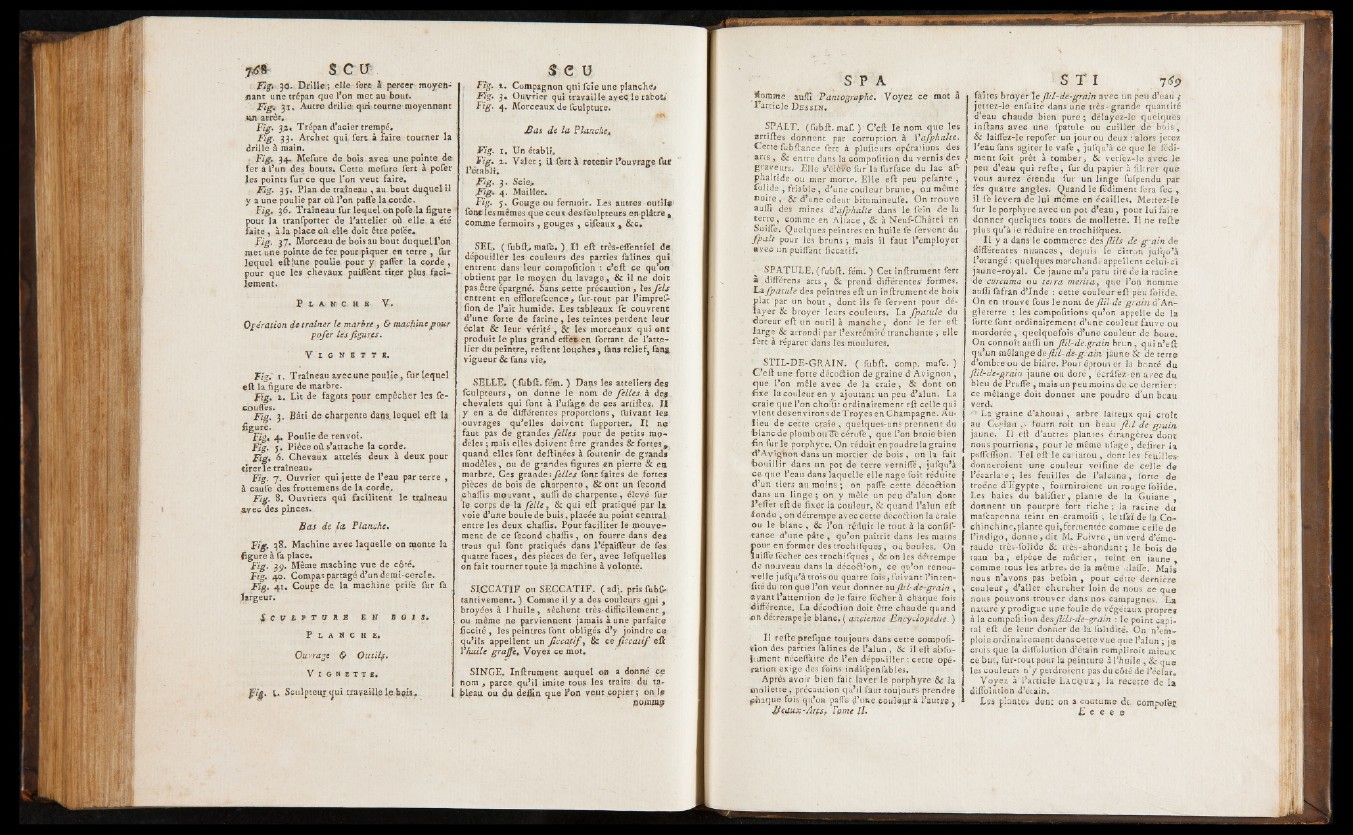
-jré# S C «t Fig\ 3a. Drille.; elle fert à percer moyennant
une trépan que l’on met bout. Fig1. 31. Autre drille qui tourne moyennant
un. arrêt«,
F ig . 3.2« Trépan d’acîer trempé«
Fig. 33. Archet qui, fert à .faire tourner la
drille à main.
: 34" ^ e^ure de h ois avec tme pointe de
fer à l’un des bouts» Cette melure fert à pofer
les points fur ce que l'on veut faire.
F ig . 35. Plan de traîneau , au bout duquel U y a une poulie par où l’on paffe la,corde.
'Figà 36. Traîneau fur lequel onpofe la figure 1
pour la tranfporter de l’attelier où elle, a été
faite , à la place où elle doit être pofée.
F ig. 37. Morceau de bois au bout duquell’on
met un® pointe de fer pour piquer en terre , fur
lequel eft lune poulie pour y palier la corde ,
-pour que les chevaux puiffent tii^ plus facilement.
P x a n c h e V .
Opération de traîner le marbrât, & machinep°&r
pofer lesfigurçs.
V i g n e t t e .
Fiar~ 1. Traîneau avec une poulie^ fur lequel ;
eftF laig f.i g2u.r eL dite dme afrabgroe.ts pour empêcher les fe-
cpuffès. F ig . 3. Bâti de charpente da^s, lequel eft la
figuré.
Fig* 4. Poulie de renvoi.
fyg. 5. Pièce où s’ attache la corde. Fig, 6. Chevaux attelés deux à deux pour
Cirer le traîneau.
Fig. 7. Ouvrier qui jette de l’ eau par terre ,
à caufe des frotteipens de la corde. fig. 8. Ouvriers qui facilitent le traîneau
avec des pinces.
B a s de la Flanche,
Fig. 38. Machine avec laquelle on monte la ;
figure à fa place.
F ig . 30. Même machine vue de côté.
F i<*. 40. Compas partagé d’un demi-cercle. Fig. 41« Coupe ae la machine prife fur fa
largeur.
S c UL P T V X E £ tr B 0 Z S.
P l a n c h e .
Ouvrage & Outils.
V i g n e t t b .
fig. U Scuîpteur ^ui travaille l.e bpis. f
$ e u 1 Flg> %• Compagnon qni feie une planche«
1 F ig. 3.* Ouvrier qui travaille avec le rabotu
Fig. 4. Morceaux de fculpture.
Bas de la Planche*
Fig. 1, Un établi,.
Figv 2. Vajec ; il fert à retenir l’ouvrage fur
l’établi.
F ig . 3. Scie>
F ig . 4. Maillet»
Fig. j . Gouge ou fermoir. Les autres outil«
fondes mêmes que ceux des fculpteucs en plâtre ,
comme fermoirs , gouges , cifeaux , & c .
SEL. ( fubft* mafe. ) ï l eft très»-effentiel de
dépouiller les couleurs des parties falines qui
entrent dans leur compofition : c’ eft ce qu’on
obtient par le moyen du la v age, & il ne doit
; pas être épargné. Sans cette précaution , les fe ls
entrent en efflorefcence, fur-tout par l’ impreC-
: fion de l’air humide. Les tableaux fe couvrent
d’une forte de farine , les teintes perdent leur
éclat & leur vérité , & les morceaux qui ont
produit le plus grand effefcen fortant de l’attg-
lier du peintre, relient louches j fans relief, fans,
vigueur & fans vie,.
SELLE, (.fubft. fém» ) Dans les attelîers des
fculpteurs, on donne le nom de fe lle s à de«
chevalets qui font à l’ulage de ces ardites. XI
y en a de différentes proportions, lui vase les
ouvrages qu’elles doivent fupporcer, I l ne
faut pas de grandes felles pour de petits modèles
; mais ellés doivent êcre grandes & fo r te s#
quand elles font deftinées à fou tenir de grands
modèles, ou de grandes figures «n pierre &. ea
marbre, Çes grandei felles font faites de fortes
pièces de bois de charpente, & ont un fécond
.chaflis mouvant, auffi de charpente, éleyé fur
le corps de la fe lle 9 & qui eft pratiqué par la
voie d’une boule de buis, placée au point central
entre les deux chaffis. Pour faciliter le mouvement
de ce fécond chaffis, on fourre dans des
trous qui font pratiqués dans f ’épaifieur de fes
quatre faces » des pièces de fe r , avec lefquelles
on fait tourner toute ljâ machine à volonté.
SICCA TIF ou SEGÇATIF, ( adj. pris fubG*
tanti veinent* ) Comme il y a des couleurs y
broyées à Thuile , sèchent très-difficilement 9
ou même ne parviennent jamais à une parfaite
ficcité , les peintres font obligés d’y joindre ce
qu’ ils appellent un fic ça fif , 8c ce f c c a t i f eft
l ’huile graffe. Voyez ce mot.
SINGE. Infiniment auquel on a donné ce
nom , parce qu’ il imite tous les traits d# ta-
J>lpau ou du jielpïn que Fon v eut,copier ; on je
jnomrn^
s P A
Somme auffi Pantographe. Voyez ce mot â
l’article Dessin. .
SPALT. (fubft. maf, ) ‘ C’eft lé nom que les :
artiftes donnent par corruption à Ÿ afphalte.
Cette fubftance fert à plufieurs opérations des
arts, & entre dans la compofition du vernis des |
graveurs; Elle s’élève fur la furface du lac af-
phaltide ou mer morte. Elle eft peu pefante ,
folide , friable , d’une couleur brune, ou même
noire, & d’une odeur bitumineufe. On trouve
auffi des mines à'afphalte dans le fejn de la
terre, comme en A lia ce , & à Neuf-Châtel eh
S.uiffe. Quelques peintres'en huile fe fervent du
fp a lt pour les bruns ; mais il faut l’employer
ayec un puiflant ficcatif.
SPATULE, ( fubft. fém. ) Cet inftrument fert
à differens arts , & prend différentes formes.
La fpatule des peintres eft un inftrument de bois
plat par un bout, dont ils fé fervent pour délayer
& broyer leurs couleurs. La fpatule du
doreur eft un outil I manche-, dont le fer eft
large & arrondi par l’extrémité tranchante ; elle
fert à réparer dans lès moulures.
STIL-DE-GRAIN. ( fubft. comp. mafe. )
C’eft une forte décoélion de graine d Avignon ,
que l’on mêle avec de la craie, & dont on
fixe la couleur en y ajoutant un peu d’alun. La
«raie que l’on choifit ordinairement eft celle qui
vient desenvirons deTroyesen Champagne. Au-
lieu de cette craie , quelques-uns prennent du
blanc de plomb oiuîe cérufe , que l’on broie-bien
fin furie porphyre. On réduit en poudre la graine
d’Avigfnon dans un mortier de bois , on la fait
bouillir dans un pot de terre verniffe, jufqu’à
ce que l’eau dans laquelle elle nage foie réduite
d’un tiers au moins ; on paffe cette décoélion
dans un linge ; on y mêle un peu d’alun dont
l ’effet eft de fixer la couleur, & quand l’alun eft
fondu , on détrempe avec cette décoélion la craie
ou le blanc , & l’on réduit le tout à la confif-
tance d’ une pâte, qu’on paîtrit dans les mains
rour en former des trochifques, ou boules. On
aifle fécher ces trochifques , & on les détrempe
de nouveau dans la dçcoél’on, ce qu’on renouvelle
jufqu’à trois ou quatre fois, fuivant l’inren-
■ fité du ton que l’on veut donner au Jlil-de-grain ,
ayant l’attention de le faire fécher à chaque fois
differente. La décoélion doit être chaude quand
en détrempe Je blanc, ( ancienne Encyclopédie. )
Il refte prefque toujours dans cette eompofi-
tion des parties falines de l’alun , & il ell abfo.-
liunent néceffaire de l’en dépouiller: cette opé-
ratipn exige des foins indilpenfables.
Après avoir bien fait laver le porphyre & la
ïnol-iette , précaution, qu’ il faut toujours prendre
chaque fois qu’on pafte çTuRe coulèiir à Fautre ,
B taux-Arts, Tpmç II.
S T I 7 * p
faîtes broyer le Jlil-de-grain avec un peu d’eau ;
jettez-le enfuite dans une très - grande quantité
d eau chaude bien pure ; délayez-le quelques
inftans avec une fpatule ou cuiller de bois,
& laiffez-lç repofer un jour ou deux : alors jetez
l’eau fans agiter le vale , jufqu’à ce que le fédi-
ment loit prêt à tomber, & verfez-le avec le
peu d’eau qui refte, fur du papier à filtrer que
vous aurez étendu fur un linge fufpendu par
fes quatre angles. Quand le fédiment fera fec ,
il fe lèvera de lui meme en écailles. Mettez-le
fur le porphyre avec un pot d’eau, pour lui faire
donner quelques tours de mollette. Il ne refte
plus qu’à Je réduire en trochifques.
Il y a dans le commerce des j li ls de-g~ain de
differentes nuances, depuis le citron jufqu’à
l’orangé: quèlqüesmarchands appellent celui-ci
jaune-royal. Ce jaune m’a paru tiré de la racine
de curcuma ou tetra mérita, que l’on nomme
auffi fafran d’Inde : cette couleur eft peu folide.
On en trouve fous le nom de Jlil-de grain d’Angleterre
: les compofitions qu’on appelle de la
forte font ordinairement d’une couleur fauve ou
mordorée, quelquefois d’une couleur de boue.
On connoît auffi un Jlil-de.grain brun, qui n’effc
qu’un mélange de^Jlil-de-grain jaune & de terre
d’ombre ou de biflre. Pouréprouv er la bonté du
Jlil-de-grain jaune ou doré , écrâfez-en ayec du
bleu de Pruffe , mais un peu moins de ce dernier :
ce mélange doit donner une poudre d’un beau
verd»
m Là graine d’ahouai , arbre laiteux qui croît
au Ge-yîan fourn roit un beau f t d de pruin
jaune. Il eft d’autres plantes étrangères dont
nous pourrions, pour le même ufage, defirer la
pofleflion. Tel eft le cariarou , dent les feuilles-
donneroient une couleur voifine de celle de
l’écarlate.; les feuilles de l’alcana, forte de
troène d’Egypte , fourniraient un rouge folide.
Les baies du balifier, plante de la Guiane
donnent un pourpre fort riche; la racine du
malcapenna teint en cramoifi | le tfaï de lg Co~
ehinchine,plante qui,fermentée comme celle de
l’indigo, donne, dit M. Poivre , un verd d’émeraude
très-folide 8c très-abondant; le bois de
taau ba, elpèce de mûrier, teint en jaune ,
comme tous les arbres de la même >;laffe. Mais
nous n’avons pas befoin , pour cette dernière
couleur, d’aller chercher loin, de nous ce que
nous pouvons trouver dans nos campagnes.. La
nature y prodigue une foule de végétaux propres
à la compofition desjlils-de-grain : le point capital
eft de leur donner de la fohdité. On n’emploie
ordinairement dans cette vue que l’alun ; je
crois que la diffolution d’étain remplirait mieux
ce but, fur-tout pour la peinture à l’huile , 8c que
les couleurs n’y perdraient pas du côté de l’éclat.
Voyez à1 l’article Lacque , la recette de la
diffolution d’étain.
Les plantes don: on a coutume de. compolec
£ e e e e