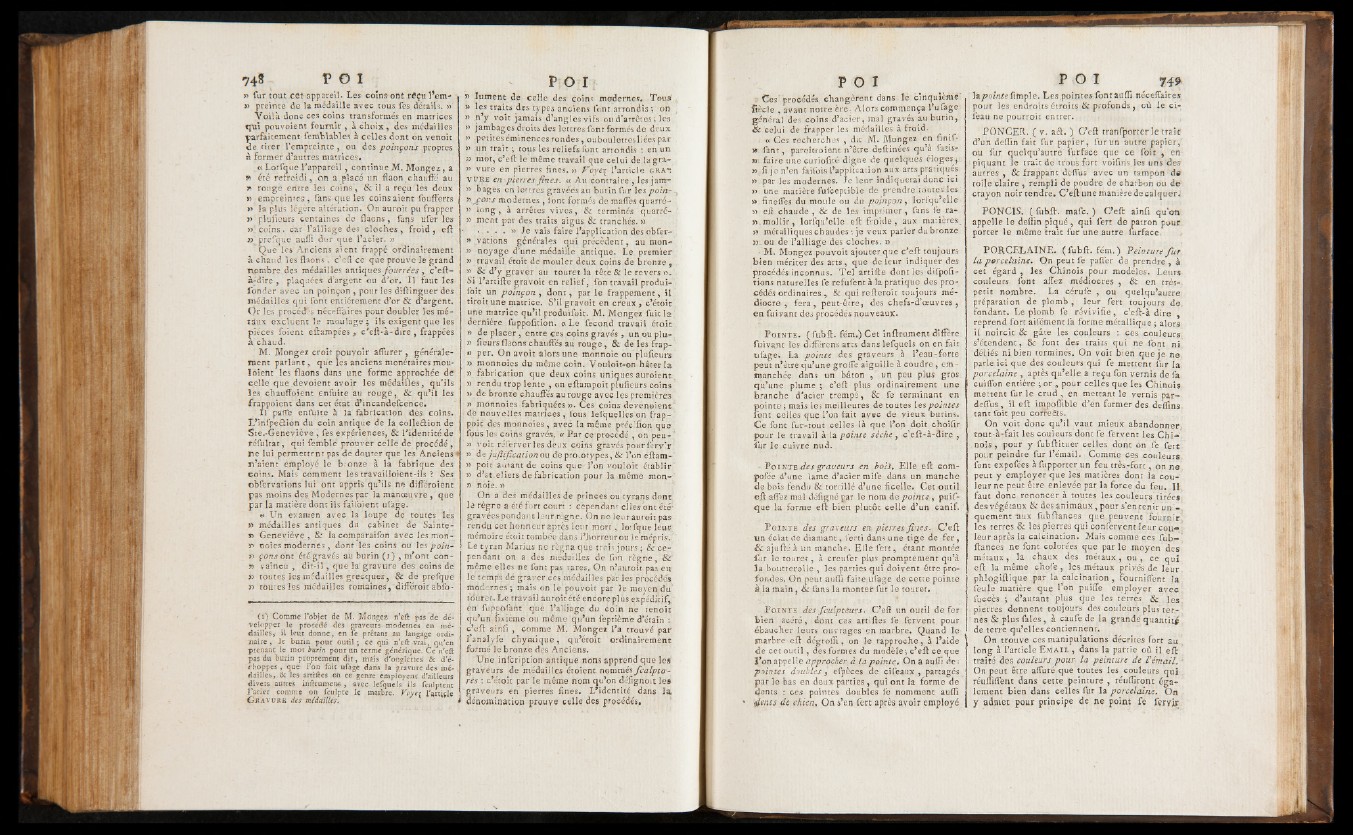
» fur tout cet appareil. Les coins ont fêçul*em-
» preinte de la médaille avec tous fes. détails. »
V o ilà donc ces coins transformés en matrices
qui pouvoient fournir, à ch o ix , des médailles
parfaitement femblables à celles dont on venoit
<de tirer l’empreinte , ou des poinçons propres
à former d’autres matrices.
, « Lorfque l ’appareil, continue M. Mongez, a
» été refroidi, on a placé un flaon. chauffé au
y> rouge entre les coins', & il a reçu lès doux
»empreintes , fans que les coins aient foufferts
» la plus légère altération. On auroit pu frapper
» plufieurs centaines de flaons, fans ufer les
»! coins, car l’alliage des c loches, froid , eft
»' prefque aufli dur que l’acier. »
Que' les'Anciens aient frappé ordinairement
à chaud les flaons , c'eft ce que prouve le grand
nombre, des médailles antiques f burrées , c’eft-
àfd ire, plaquées d’argent ou d’or. Il faut les
fonder avec un poinçon , pour les diftinguer des
médailles qui font entièrement d’or & d’argent.
Or les procédés nécéflaires pour doubler les métaux
excluent le moulage ; ils exigent que les
pièces foient efiampées , c'eft-à-dire , frappées
a. chaud.
M. Mongez croit pouvoir aflurer , généralement
parlant, que les anciens monétaires mou-
ïôient les flaons dans une forme approchée de
celle que dévoient avoir les médailles, qu’ils
les chauffoient enfuite au rouge, & qu’il les
frappoient dans cet état d’ incandefcence.
U pafle enfuite à la fabrication des coins.
L’ iiifpeéHon du coin antique de la côlleâion de
Ste.-Geneviève , fes expériences, & l'identité de
féfultat, qui femble prouver celle de procédé,
ïie lui permettent pas de douter que les Anciens11
n’aient employé le b;on.ze à la fabrique des
coins. Mais comment les tràvailloiënt-ils ? Ses
obfervations lui ont appris qu’ ils ne différoient
pas moins des Modernes par la manoeuvre , que
par la matière dont ils failoient ufage.
« Un examen avec la loupé dç toutes les
» médailles antiques du ' cabinet de Sainte-
» Geneviève, 8c la comparaifon avec les mon-
» noies modernes , dont les coins Où les riou’z-
» çons ont étégravés au burin ( i ) , m’ont con-
» vaincu , d it- il, que la gravure des coins de
» toutes les médailles grecques, & de prefque
» toutes les médailles romaines, diftéroif abfo-
( ï) Comme l’objet de M. Mongez ri’eft pas de développer
le procédé des graveurs modernes en médailles
j il leur donne, en le prêtant au langage ordinaire
, le burin pour outil ; ce qui n’eft -Vrai, qu’en
prenant le mot burin pour Un terme générique. Ce n’eft
pas du burin proprement dit, rtiâîs d’ongletteâ 8c d’échoppes
, que i’ôn fait ufage dans la gravure des médailles,
& les artiftes en ce genre emplo.yent «bailleurs
divers autres inftrumens, avec lefqucls ils fculptent
l ’acier comme on fculpte le marbre. Voyez l’artiçle
Gravure des médailles.
» Jument de celle des1 coins modernes. Tous1
» les traits des types anciens font arrondis *, on
» n’y voit jamais d’angles vifs ou d’arrêtés*, les
» jambages droits des lettres font formés de deux
» petites éminences rondes , ouboulettes liées par
» un trait *, tous les reliefs font arrondis : en un
» mot, c’eft le même travail que celui de la gra-
» vure en pierres fines. » Voye\ l’article gRA*î
vube en-pierres-fines. .« Au contraire , les jam-
» bages en lettres gravées au burin fur les poin-
'>\r£ons modernes, lont formés de maffes quarré-
w î°ng j à arrêtes vives., 8c terminés quarré-
» ment par des traits aigus 8c tranchés. »
• . . . . . » Je vais faire l’application des obfer-
» varions générales qui précèdent, au mon-
» noyage d’une médaille antique. Le premier
» travail étoit de mouler deux coins de bronze r
» & d’y graver au touret la tête & le revers».
Si l ’artifte gravoit en relief, fon travail produis
i t un poinçon , dont, parle frappement, il
tiroitune matrice. S’il gravoit en creux , ç’étoit
une matrice qu’ il produifoit. M. Mongez fuit la
dernière fuppofition. c Le fécond travail étoit
» de placer, entre ces coins gravés , un ou plu-
» fieurs flaons'chauffés au rouge, & de les frap-
» per. On avoit alors une monnoie ou plufieurs
» monnoies du même coin. Vouloit-on hâter la
» fabrication que deux coins uniques auréient-
» rendu trop lente , on eftampoit plufieurs coins.
» de bronze chauffés au rouge avec les premières
» monnoies fabriquées». Ces coins devén.oient
de nouvelles matrices , fous lefquelles on frap-
poit des monnoies , avec la même préc'fion que
foüs les coins gravés, « Par ce procédé , on peu- ’
» voit réferver les deux coins gravés pourfervir
» de jufiificationou deproLOtypes, 8c l ’on èftam-
» poiç autant de coins q u e 'l’on vouloit établir
• » d’at.eliers de fabrication pour la même mon-'
» noié. »
On a des médailles de princes ou tyrans donc
le règne a été fort court : cependant ellesont été"'
gravées pondant leur.règne. On no leur auroit pas-
rendu cet honneur après leur mort, lorfque leur
mémoire étoit tombée dans l’horreurou le mépris."
} Lè tyran Marius ne régna que trois jours ; &: ce-
penaant on a des médailles de Ton règne, 8c
même elles ne font pas rares. On n?auroit pas eu
le temps dé graver ces médailles par les procédés
modernes"; mais on lepouÿoit par Je moyen du'
touret. Le travail auroit été encore plus expéditif,,
én fuppofant que l’alliage du coin ne tenoit
qu’ un fixième ou même qu’ un feptième d'étain :
c’efl: ainfi , comme M. Mongez l ’a trouvé par
l’analyfe thymique, qu’éroit ordinairement
formé l e bronze des Anciens.
Une infeription antique nons apprend que les
graveurs de médailleset oient nommés fcalpto-
rés : c’étoic par le même nom qu’on défignoit les-
graveurs en pierres fines. L’ identité dans la.
dénomination prouve celle des procédés,. J
? Ces procédés, changèrent dans lé cinquiemé
ftècle , avant notre ère, Alors commença l’ ufage
général des coins d’acier, mal gravés au burin,
8c celui de frapper les médailles à froid.
« Ces recherches , dit M. Mongez en finif-
» fant, paroîtroient n’être deftinées qu à fatis-
» faire une curiofité digne de quelques éloges^,
»,;fi je n’en faifois l’application aux arts pratiqués
» par les modernes. Je leur indiquerai donc ici
» une matière fufceptible de prendre toutes les
» fin elfes du moule ou du p o in ç o n , Jbrl qu’ elle
» efl chaude , & de les imprimer , fans lè ra-
». m ollir, lorfqu’elle efl: f o u l e , aux matières
» métalliques chaudes *. je veux parler du bronze
>jiou de l’alliage des cloches. »
- M. Mongez pouvoit ajouter que c’eft toujours
bien mériter des arts, que de leur indiquer des
procédés inconnus. T e l artifte dont les difpofi-
tions naturelles fe refufent à la pratique des procédés
ordinaires., & qui refteroît toujours médiocre
,- fera, peut-êcre, des chefs-d’oeuyres ,
en fuivant des procédés nouveaux.
P ointe, (fubft. fém.)Cet inflrument diffère,
fuivant les différens arts dans lefquels on en fait
triage. La pointe des graveurs à l’eau-forte
peut n’ ètrê qu’ une grolfe aiguille à coudre , emmanchée
dans un bâton , un peu plus gros,
qu’une plume ; c’efl: plus ordinairement une
branche d'acier trempé, & fe terminant en
pointe *, mais le» meilleures de toutes les pointes
font celLes que l’on fait avec de vieux burins.
Ce font fur-tout celles là que l’on doit choifir
pour le travail à la pointe sèche, c’eft-à-Sire ,
fur le,cuivre nud.
• Pointe de s graveurs en hoii. Elle efl: com-
pofée d’une lame d’acier mife dans un manche
de bois fendu & tortillé d’une ficelle. Cet outil
efl allez mal défigné par le nom de pointe , puif-
que la forme efl: bien plutôt celle d’un canif.
Pointe des graveurs en pierres fines. C’ eft
lin éclat de diamant, ierti dans une tige de fe r ,
& ajufté à un manche. Elle fert, étant montée
fur le touret, à creufer plus promptement qu’à
la boutterolle , les parties qui doivent être profondes.
On peut a u fii faire ufage de cette pointe
à la main, & fans la monter fur le touret.
Pointe des fculpteitrs. C’eft un outil de fer
bien acéré, dont ces artiftes fe fervent, pour
ébaucher leurs ouvrages en marbre. Quand le
marbre^eft dégrofii, on le rapproche, à l’aide
de cet o u til, des formes du modèle ; c’eft ce que
l ’on appelle approcher à l,a pointe. On a aufli de ;
pointes doubles , efpèces de cifeaux , partagés^
par le bas en deux parties , qui ont la forme de
dents : ces pointes doubles fe nomment aufii
<rfents de chien. On s’ eu fert après avoir employé ^
la pointe Ample. Les pointes font aufii néceffaires
pour les endroits étroits 8c profonds, où le ci-
feau ne pourroic entrer.,
PONCER. ( v . a61. ) C’ eft tranfporter le traie
d’un deffin fait fur papier, fur un autre papier,'
ou fur quelqu’autre furface que ce foit , en
piquant le trait de trous fort vôifins les uns des
autres , & frappant d.èflus avec un tampon de
toile claire , rempli de poudre de charbon ou de
crayon noir tendre, C ’ eft une manière de calquer;
PONCIS. ( fubft. mafe. ) C’eft ainfi qu’on
appelle le defiin piqué , qui fert de patron pour
porter le même traie fur une autre uirface-
PORCELAINE, (fubft. fem.) "Peinture fu r
la porcelaine. On peut fe paflèr de prendre , à
cet égard , les Chinois pour modèles. Leurs
couleurs font aflez médiocres , & en très-,
petit nombre. La cérufe , ou quelqu’autre
préparation de plomb , leur fert toujours de,
fondant. Le plomb fe revivifie, c’eft-à dire
reprend fort aifémentfa forme métallique; alors
il noircit & gâte les couleurs : ces couleurs
s’étendent, & font des traits qui ne font ni!
défiés ni bien terminés. On voit bien que je ne,
parle ici que des couleurs qui fe mettent fur la
porcelaine , après qu’elle a reçu fon vernis de fa
cuiflbn entière ; or „ pour celles que les Chinois
mettent fur le crud , en mettant le vernis par-
deflus, il eft impoftible d'en former des deffins
tant foit peu correéts.
On voit donc qu’ il vaut mieux abandonner,
tout-à-fait les couleurs donc fe fervent les Chinois,
pour y fubftituèr celles dont on fe fert
pour peindre fur l’émail. Comme ces couleurs
font expofées à fupporterun feu très-fort, on ne
peut y employer que les matières dont la couleur
ne peut être enlevée par la force du feu. Il,
faut donc rononcer à toutes les couleurs tirées
des végécaux 8c des animaux, pour s’en tenir un !-
quement 'aux fubftances que peuvent fournir
les terres 8c les pierres qui conferyentleur couleur
après la calcination. Mais comme ces ftib -’
ftances ne font colorées que par le moyen des
métaux, la chaux des métaux , ou , ce qui
eft la même chôfe, les métaux privés de leur
phlogiftique par la calcination, fourniflent Ja
feule matière que l’on puifie employer avec
face es ; d’autant plus que les terrés & les
pierres donnent toujours des couleurs plus ter-
nés & plus fales, à caufe de la grande quantité
de terre qu’elles contiennenr.
On trouve ces manipulations décrites fort au
long à l’article Email , dans la patrie où il eft
traité des couleurs pour la peinture de Vémail. '
On peut être affuré que toutes les couleurs qui
réulmfent dans cette .peinturé , réufliront également
bien dans celles fur la porcelaine. On
y admet pour principe de ne point fe fervir