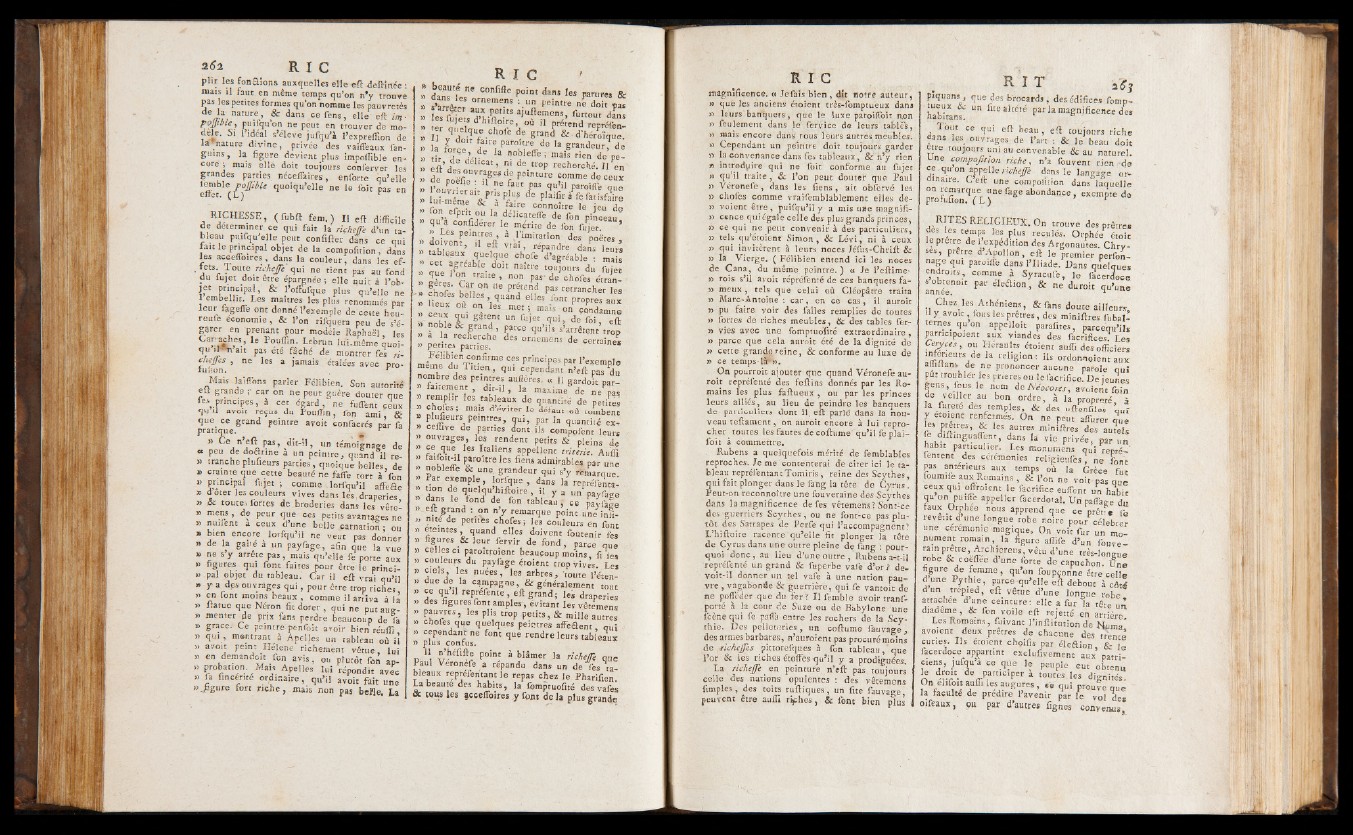
2<S2 R I C
plir les fonaions auxquelles elle eft deftinée :
mais il faut en même temps qu’on n’y trouve
pas les petites formes qu'on nomme les pauvretés
de la nature, & dans ce fens, elle eft im-
P W ° 1‘ , puifqu’on ne peut en trouver de mo-
dele. Si 1 idéal s’eleve jufqu’ i l’ expreffion de
Ja^nature d iv in e , privée des vaiffeaux fan-
guins, la figure devient plus injpoffible enco
re ; mais e lle doit toujours conferver les
grandes parties néceffaires, enforte qu’ elle
lemble pojjiklc quoiqu’elle ne le foit pas en
effet. (L ) r
RICHESSE, ( fu b ft fem. ) Il eft difficile
de deterimner.ee qui fait la rïcheffe d’un tableau
puifqu elle peut confifter dans ce qui
fait le principal objet de la compofition , dans
les acceffoires, dans la couleur, dans les effets
1 oute nchejfie qui ne tient pas au fond
du iujet doit être épargnée ; elle nuit à l’obje
t principal, & l’offufque plus qu’elle
rpmnollîe T o» _i .. t 1 *
7 *xav|uçi«i peu ue s egarer
en prenant pour modèle Raphaël les
Capuches, le Pouffin. Lebrun lui.même quoi-
qu ,m x ait pas été fâché de montrer fes ri-
ehejjes , ne les a jamais étalées avec pro-
lulion. r
Mais .laiffons parler Félibien. Son autorité
elt grande car on ne peut guère douter que
les principes, a cet égard, ne fuffent ceux
qu il avoir reçus_ du Pouffin, foq ami &
que ce grand peintre avoir confacrés par fa
pratique. - ' m r
» Ce n’eft pas, dit-il, un témoignage de
« peu de dodrine a un peintre, quand il re-
» tranche plufieurs parties, quoique belles de
» crainte que cette beauté ne faffe tort à fbn
» pracipal fujet ; comme „lorfqu’ il affeâe
» doter les couleurs vives dans les .draperies
» & toutes fortes de broderies dans les vète-
» mens, de peur que ces petits avantages ne
» nuiient a ceux d’une bellë „carnation ; ou
» bien encore lorfqu’ il ne veut pas donner
» de la gai te a un payfage, afin que la vue
» ne s y arrête pas, mais qu’elle Te porte aux
» figures qui font faites pour être le princi-
» pal objet du tableau.' Car il eft vrai qu’ il
» y a des ouvrages q u i, pour être trop riches
» en lont moins beaux, comme il arriva à la
» ftatuc que Néron fit dorer , qui ne put aug-
» monter de prix fans perdre beaucoup de fa
» grâce. Ce peintre penfoit avoir bien réuffi
» q u i , montrant à Apelles un tableau où iî
» avoir peint Hélene richement vêtue, lui
» en demandoit fon av is , ou plutôt fon an-
» probation. Mais Apelles lui répondit avec
» fa fincerite ordinaire, qu’ il avoir fait une
» Jigure fort r ic h e , mais non pas belle t a
R ï C t '
» d a n s t f * C° nfifle point dans Ies P*rure* &
» s’arrêter ° rneme.ns Peintre n fd o it pas
» les fMera d’h -? ;" “ ’ fes lujets d hiftoire,a Jouù? eiml epnrést> e'n“d» oreuprr édfLens.
» 'M ÊM t grand ^' d’héroïque. » la Ld Paro“ re de la grandeur, de
» tir A j t ' a I’ ° î’le!re'; mais rien de pe-
» eft’ dlr de lc a t’ « de troP recherché. Il en
- » de deL“ uvraS ^ FS peinture comme dp ceux
de poefie : U ne faut pas qu’il paroiflb q“ e
» de à Ce ratisfSre
„ r r f “ a Pajre Connoître le jeu de
fon efprit ou la délicateffe de fon piicean?
» qu a confiderer le mérite de fon fmet ’
» Les peintres , à l’imitation des poètes
. doivent, ,1 eft v ià i , répandre dan^s leurs
tableaux quelque chofe d’agréable • mais ’> cet agréable doit naître toujours du £,”î
Ü l o" tra!te’ no" pas-de Chdfes
» fh T S‘ H l Q" *1e Pratend Pas retrancher les
Çhofes belles, quand elles font propres aux
» lieux où on le^.met ; mais J
» ceux qui gâtent un iujet qui, de fo i, eft
» noble & grand, parce qu’ils s’arrêtent trop
» a la recherche des ornemens de cer raine,
» petites parries. . ne*
mê^fe 1b.!en^.°î,firme ces principes par l’exemple
” M TU>®n ’ qul CePendant n’eft pas du
nombre des peintres aufieres. « Il gardoit par-
» faitement , d it- il, la maxime de nePpas
» remplir les tableaux de quantité de petkes
» choies; ma;s d éviter le défaut où tombent
» plufieurs peintres, qui, parla quantilé ex-
» ceffive de parties dont ils comppfent leurs
» ouvrages, les rendent petits & pleins de
1 |H § K 1 les l ’aliens appellent triteric. Auffi
faToit-d paraître les Cens admirables par une
» nobleffe & une. grandeur qui s’y remarque
Par exemple, lorfque , dans la repréfenta-
» uon de quelqu’hiftoire, il y a un payfage
» dans le fond de fon tableau; ce payfâge
» eft grand : on n’y remarque pointunemfi-
” ni te de petites chofes; les couleurs en font
» éteintes, quand elles doivent foutenir fes
» figures & leur iervir de fond, parce que
» celles ci p^roitroient beaucoup moins, fi j es
» couleurs du payfage étoient trop vives. Les
Ï !fs nuées, les arbres, toute l’éten-
» due de la campagne, & généralement tout
» ce qu il reprefente, eft grand; les draperies
» des figures font amples-, évitant les vêtemens
» pauvres, les plis trop petits, & mille autres
» chofes que quelques peintres affefient, oui
» cependant ne font que rendre leurs tableaux
» plus confus.
Il n’htfifte point à blâmer la richejjk que
Paul Veronefe a répandu dans un de fes tableaux
repréfentant le repas chez le Pharifien.
La beauté des habits, la fbmptuoïïté des vafes
* tous les acceffoires ,y font de la plus grande
R I C
magnificence. « Je fais bien, dit notre auteur*
» quê les anciens étoient très-fomptueux dans
» leurs'ban^uers , que le luxe paroifioit n.on
» feulement dans le fervice de leurs tables,
» mais encore dans rous leurs autres meublesi
» Cependant un peintre doit toujours garder
» la convenance dans fes tableaux, & n’y rien
» introduire qui ne foit conforme au fujet
» qu’il traite, & l’on peut douteir que Paul
» Veronefe, dans les liens, ait obfervé les
» chofes comme vraifemblablement elles de- ,
» voient être, puifqu’ il y a mis une magnifi-
» cence. qui égale celle des plus grands princes,
» ce qui ne peut convenir à des particuliers,
» tels qu’etoient Simon, & L é vi, ni à ceux
» qui invitèrent à leurs noces Jéfus-Chrift &
» la Vierge. ( Félibien entend ici les noces
de Cana, du même peintre.) a Je l’ eftime-
» rois s’ il avoit représenté de ces banquets fa-
» meux , tels que celui où Cléopâtre traita
» Marc-Antoine: car, en ce cas , il auroit
» pu faire voir des lalles remplies de toutes
» fortes de riches meubles, & des tables fer-
» vies avec une fomptuo'fité extraordinaire ,
» parce que cela auroit été de la dignité de
» cette grand.greine, & conforme au luxe de
» ce temps 1^'».
On pourroit ajouter que quand Véronefe auroit
repréfenté des feftins donnés par les Romains
les plus faftueux , ou par les princes
leurs alliés, au lieu de peindre les banquets
de particuliers dont il, eft parlé dans la nouveau
teftament, on auroit encore à lui reprocher
toutes les fautes de coftume- qu’il fe plai—
foit à commettre.
Rubens a quelquefois mérité de femblables
reproches. Je me contenterai de citer ici le tableau
repréfentant Tomiris, reine des Scythes,
qui fait plonger dans le fang la tête de Cyrus.
Peut-on reconnoître une fouveraine des Scythes
dans la magnificence de fes vêtemens? Sont-ce
des guerriers Scythes, ou ne font-ce pas plutôt
des Satrapes de Perfé qui l'accompagnent?
L’hiftoire raconte qu’ elle fit plonger la tête
de Cyrus dans une outre pleine de fang : pourquoi
donc, au lieu d’une outre , Rubens a-t-il
repréfenté un grand & fuperbe valê d’or ? de-
voit-il donner un tel vafe à une nation pauvre
, vagabonde & guerrière, qui fe vantoit de
ne pofîeder que du fer ? I l femble avoir tranl-
porté à la cour de Suze ou de Bàbylone une
fcène qui fe pafla entre les rochers de la Scy-
thie. Des pelleteries, un coftume fauvage}
des armes oarbares, n’auroient pas procuré moins
de /icheffés pittorefques à fon tableau,'que
l ’or & les riches étoffes qu’il y a prodiguées.
La richejfe en peinture n’eft pas toujours
celle des nations opulentes : des vêtemens
fimples, des toits ruftiques, un fite fauvage
peuvent être aufii riches, & font bien plus i
r ï t ifâ
piquans , [jue des brocards , des édifices fooep-
tueux &c un Lite altéré par la magnificence des
liabitans.
lo i i t ce qui eft beau, eft toujours riche
ùsns les ouvrages de l’ art : & le beau doit
etre toujours uni au convenable & au naturel.
Une compofition riche, n’a Louvent rien de
ce .qu on appelle rlchejje dans le langage or-
mnaire. C eft une compofition dans laquelle
pTof2on.TLre&2eab0ndanCe’ eX°mpte d8
RITES RELIGIEUX. On trouve des prêtre.
fi,6!../ * Pea ,plus re0JlIés- Orphée étoit
le prêtre de 1 expédition des Argonautes. Chrv-
ses, prêtre d Apollon, eft le premier perfon-
nage qui paroiffe dans l’Iliade. Hans quelques
endroits, comme à Syracufe, le facer^oce
année” 0“ 1 ^ eleaion > & ne duroit qu’ une
Chez_les Athéniens, & fans doute ailleurs
il y avoir fous les prêtres, des miniftres CubaN
ternes qu on appelloit parafttes, pareéqu’i l .
parricipoient aux viandes des facrifices. Les
teryces, ou Heraults étoient auffi des officiers
inferieurs de la religion: ils ordonnoient aux
aiiiltans de ne prononcer aucune parole qui
pût troubler les prières o u ïe iacrifice. De jeunes
gens, fous, le nom àe Néocores, ayoient foin
de veiller au bon ordre, à la propreté, à
la furete des temples, & des uftenftles qui
y étoient renfermés. On ne peut, affûter que
les pretres, & les autres miniftres des autels
fe diftmguaffenr, dans lâ vie privée, par un
habit particulier. Les monumens qui repré-’
tentent des cérémonies religieufés, ne font
pas antérieurs aux temps où la Grèce fur
foumife aux Romains , & l’on ne voit pas que
ceu.x qui offraient le facrifice euffent un habir
qu on puiffe appeller facerdo.al. Un paffage du
taux Orphee nous apprend que ce prêtie fi,
revêtit d’une longue robe noire pour célébrer
une ceremonie -magique. On voit fur un monument
romain, la figure affile d’un fouveram
prêtre, Archrereus, vêtu d’une très-longue
robe & coeffee d une forte de capuchon. Une
figure de femme, qu’on foupçonne être celle
dune P y th ie , parce-qu’ elle eft debout à côté
d un trépied, eft vêtue d’une longue robe
attachée d une ceinture : elle a fur la tête un
diadème, & fon voile eft rejette en arrière
Les Romains, fuivant l’inftitutionde bfcima"
avoient deux prêtres de chacune des trente
curies. Ils etoienr choifis par éleftion, & 1»
facerdoce appartint exclufivement aux patriciens,
jufqu’a ce que le peuple eut obtenu
^ I S de Participer à toutes,les dignités.
On ehfott auffi ies augures, ce qui prouve que
la faculté de prédire l’avenir par le vol des
tufeaux, pu par d’autres lignes convenus