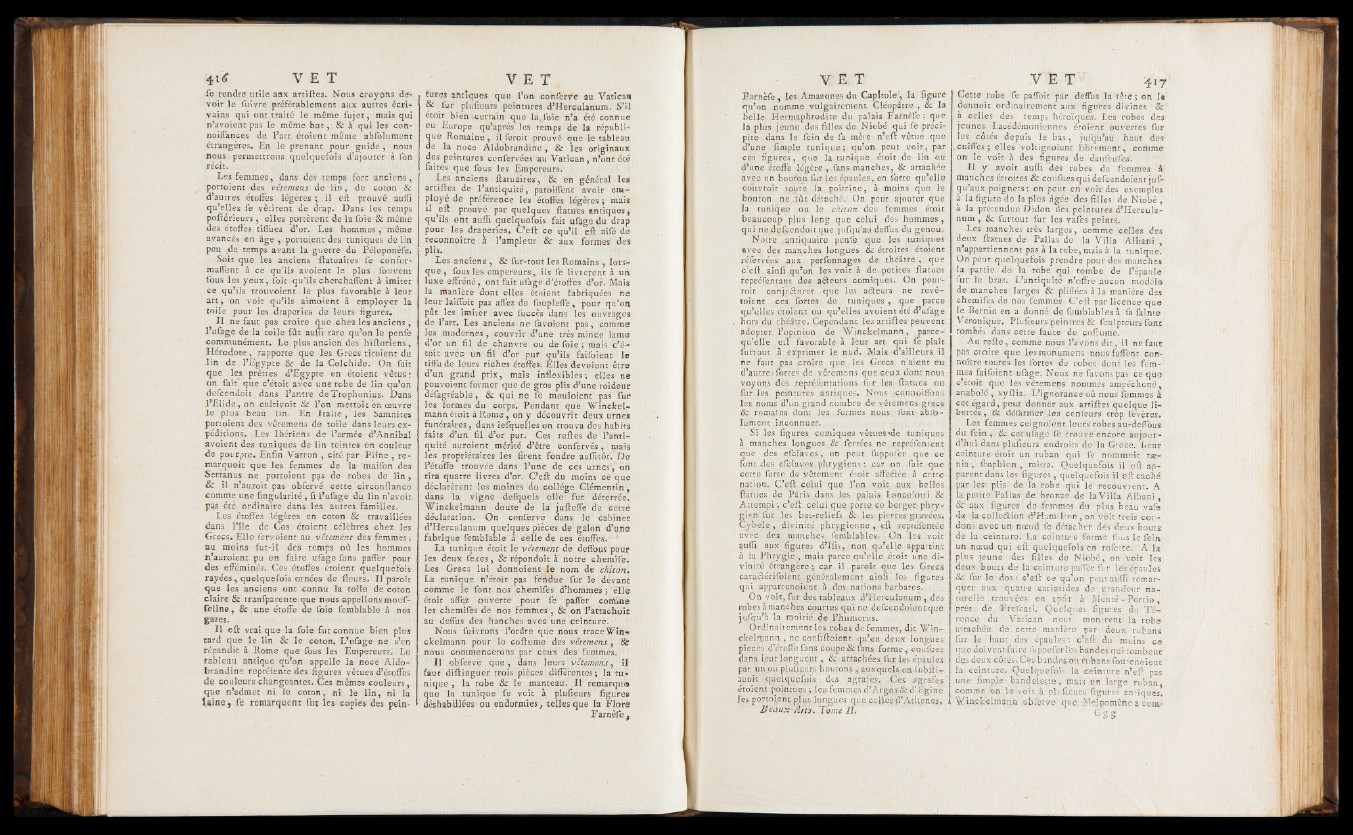
4 i< ? V E T
Te rendre utile aax artiftes. Nous croyons devoir
le lu ivre préférablement aux autres écrivains
qui ont traité le même fu je t, mais qui
n’avoient pas le même b u t, & à qui les con-
noiffances de l’ art étoient même abfolument
étrangères. En le prenant pour guide , nous
nous permettrons quelquefois d’ajouter à l’on
récit.
Les femmes, dans des temps fort anciens,
portoient des vêtemens de lin , de coton &
d autres étoffes légères ; il eft prouvé aufli
qu’elles fe vêtirent de drap. Dans les temps
poftérieurs , elles portèrent de la foie & même
des étoffes tiflues d’or. Les hommes , même
avancés en âge , portoient des tuniques de lin
peu de temps avant la guerre du Péloponèfe.
Soit que les anciens ftatuaires fe confor*
maffent à ce qu’ils avoient le plus fouvent
fous les yeu x, foie qu’ils cherchaffent à imiter
ce qu’ ils trouvoient le plus favorable à leur
a r t, on voit qu’ ils aimoient à employer la
toile pour les draperies de leurs figures.
I l ne faut pas croire que chez les anciens ,
l ’ufage de la toile fût aufli rare qu’on le penfe
communément. Le plus ancien des hiftoriens,
Hérodote, rapporte que les Grecs tiroient du
lin de l’Egypte & de la Colchide. On fait
que les prêtres d’Egypte en étoient vêtus :
on fait que c’étoit avec une robe de lin qu’on
defeendoit dans l’antre deTrophonius. Dans
l ’EIide , on cultivoit 8c l’on mettoit en oeuvre
le plus beau lin. En I ta lie , les Samnites
portoient des vêtemens de toile dans leurs expéditions.
Les Ibériens de l’armée d’Annibal
avoient des tuniques de lin teintes en couleur
de pourpre. Enfin Varron , cité par P lin e , re-
marquoit que les femmes de la 'maifon des
Serranus ne portoient pas de robes de lin ,
& il n’auroit pas obfervé cette circonftance
comme une fingularité , fi l’ ufage du lin n’avoit
pas été ordinaire dans les autres familles.
Les étoffes légères en coton & travaillées
dans l’île de Cos étoient célèbres chez les
Grecs. Elle fervoient au vêtement des femmes;
au moins fut-il des temps où les hommes
n’auroient pu en faire ufage fans paffer pour
des efféminés. Ces étoffes étoient quelquefois-
rayées , quelquefois ornées de fleurs. Il paroît
que les anciens ont connu la toile de coton
claire & tranfparente que nous appelions moufr
fe lin e , & une étoffe ae foie femblable à nos
gazes.
I l eft vrai que la foie; fut connue bien plus
tard que le lin & le coton. L’ ufage ne s’en
répandit à Rome que fous les Empereurs. Le
tableau antique qu’on appelle la noce Aldo-
brandine repréfente dés figures vêtues d’étoffes
de couleurs changeantes. Ces mêmes couleurs
que n’admet ni le coton, ni le lin , ni la
la in e , fe remarquent fur les copies des pein-
V E T
tures antiques que l’on conferve au Vatican
& fur plufieurs peintures d’Herculanum. S’ il
etoit bien .certain que la,foie n’a été connue
eu Europe qu’après les temps de la république
Romaine , il feroit prouvé que le tableau
de la noce Aldobrandine, & les originaux
des peintures ccnfervées au Vatican, n’ont été
faites que fous les Empereurs.
Les anciens ftatuaires, & en général les
artiftes de l ’antiquité, paroiffent avoir employé
de préférence les étoffes légères ; mais
il ^eft prouvé par quelques ftatues antiques,
qu’ils ont aufli quelquefois fait ufage du drap
pour les draperies. C’eft ce qu’ il eft aifé de
reconnoître a l’ampleur 8c aux formes des
plis.
Les anciens , & fur-tout les Romains , lorsque
, fous les empereurs, ils fe livrèrent à un
luxe effréné, ont fait ufage d’étoffes d’or. Mais
la manière dont elles étoient fabriquées- ne
leur laiffoit pas affez de foupleffe, pour qu’on
pût les imiter avec liiccès dans les ouvrages
de 1 art. Les anciens ne favoient pas, comme
les modernes , couvrir d’une très mince lame
d’or un fil de chanvre ou de foie ; mais c’ étoit
avec- un fil d’or pur qu’ ils faifoient le
tiffude leurs riches étoffes. Elles dévoient être
d’un grand prix, mais inflexibles; elles ne
pouvoient former que de gros plis d’une roideur
défagréable, 8c qui ne fe mouloient pas fur
les formes du corps. Pendant que Winckel-
mann étoit à R.ome, on y découvrit deux urne*
funéraires, dans iefquelles on trouva des habits
faits d’un fil d’or pur. Ces reffes de l ’antiquité
auroient mérité d’être conférvés, mais
les propriétaires les firent fondre auffitôt. De
l’étoffe trouvée dans l’ une de ces urnes', oii
tira quatre livres d’or. C’ eft du moins c e que
déclarèrent les moines du college Clémentin,
dans la vigne defquels e lfe 1 fut déterrée.
Winckelmann doute de la jufteffe de cette
déclaration. On conferve dans le cabinet
d’Herculanum quelques pièces de galon d’ une
fabrique femblable a celle de ces étoffes. 1
La tunique étoit le vêtement de deffous pour
les deux fexes, & répondoit à notre chemife.
Les Grecs lui donnoient le nom de chiton.
La tunique n’étoit pas fendue fur le dévant
comme le font nos chemifes d’hommes ; ’'elle
étoit affoz ouverte pour fe paffer confine
les chemifés de nos femmes, & on l’attachoic
au deffus des hanches avec une ceinture.
Nous fuivrons l’ordre que nous trace Win*
ckelmann pour le coftume des vêtemens, &
nous commencerons par ceux des femmes.
I l obferve que1, dans leurs vêtemens ^ il
faut diftinguer trois pièces differentes ; la tu*
nique , la robe & le manteau. Il remarqua
ue la tunique fe voit à plufieurs figures
éshabillées ou endormies, telles que la Flore
Farnèfe,
V E T
Fa-rnèfe, les Amazones du Capitole', la figure
qu’on nomme vulgairement Cléopâtre , 8c la
belle- Hermaphrodite du palais Fafnèfe ; que
la plus jeune des filles de Niobé qui fe précipite
dans le fein de fa mère n’ejft vêtue que
d’une fimple tunique; qu’on peut voir, par
ces figures, que la tunique étoit de lin ou
d’une étoffe légère , fans manches, & attachée
avec un bouton fur les épaules, en forte qu’elle
couvroit toute, la poitrine, à moins que le
bouton ne fût détaché. On peut ajouter que
la tunique ou le chiton des femmes étoit
beaucoup plus long que celui des hommes ,
qui ne defeendoit que jufqu’au deffus du genou.
Notre . antiquaire penfe que les tuniques
avec, des manches longues & étroites étoient
réfervées aux perfonnages de théâtre, que
c ’eft. ainfi qu’on les voit à de petites ftatues
repréfemant des aéleurs comiques. On pourr
roit conjecturer que les aéteurs ne revê-
toient ces fortes de tuniques , que parce
qu’ elles étoient ou qu’ elles avoient été d’ ufàge
hors du th,éâtre. Cependant les artiftes peuvent
adopter l’opinion de Winckelmann, . parce-
qu’elle eft favorable à leur art qui fe plaît
furtout à exprimer le nud. Mais d’ailleurs il
ne faut pas croire que les Grecs n’aient eu
d’autres fortes de vêtemens que ceux dont nous
voyons des repréfentations fur les ftatues ou
■ fur les peintures antiques. Nous çonnoiffons
les noms d’ un grand nombre de vêtemens grecs
8c romains dont les formes nous- font abfo-
lument inconnues.
Si les figures comiques vêtues «de tuniques
a manches longues & ferrées ne repréfentent
que des efclaves, on peut fuppofer que ce
font des efclaves phrygiens : car on fait que
cette forte de yêtement étoit affe&ée à cette
nation. C’ eft celui que l’on voit aux belles
ftatues de Paris dans les palais Lanceîôtîi.&
Attempi ; c’eft celui que porte, ce berger, phrygien
fur les bas-reliefs & les pierres-gravées?
Cybele , divinité phrygienne , eft repréfentée
avec des manches feniblables. On les voit
aufli aux figures d’ Ifis, non qu’elle appartint
à la Phrygie , mais parce qu’elle étoit une divinité
étrangère; car il paroît que les Grecs
cara$énfoient ..généralement ainfi les figures
qui appar.tenoient à .des nations barbares. ; 0 $ voit, fur des tableaux d’Herculanum , des
robes à manches courtes qui ne defcendoientque
jufqu’à la moitié de l’humérus.
Ordinairement les robes de femmes, dit Win*-
çkelmann , ne confiftoient qu’en deux longues
piecés d’étoffe fans coupe & fans forme, epufues
dans leur lo n g u e u r 8c attachées;,fur îjes épaules
par \in ou plufieurs boutons ,, auxquels on fubftw
auoic quelquefois des agrafes. Ces agrafes '
étoient pointues ; les femmes d’Argos & d ’Égine
î.es portoient plus longues que celles d’Athènes.
JJ eaux-Arts . Tome JL
V E T 4 i 7
Cette robe fe paffoit par deffus la tête ; on la
donnoit Ordinairement aux figures divines &
a celles des temps héroïques. Les robes des
jeunes Lacédémonicnnes étoient ouvertes fur
îes côtés depuis le bas, jufqü’au haut des
. cuiffés; elles voltigeoient librement, comme
on le voit à des figures de danfeufea.
Il y avoit aufli des robes de femmes à
manches étroites & coufues qui defeendoient juf-
| qu’aux poignets: on peut en voir des exemples
à la figure de la plus âgée des filles de Niobé ,
à la prétendue Didon des peintures d’Herculanum
, & furtout fur les vafes peints.
Les manches très larges, comme celles des
deux ftatues de Pallas de la V illa Albani ,
n’appartiennent pas à la robe, mais à la tunique.
On peut quelquefois prendre pour des manches
Ma partie de la robe qui tombe de l ’épaule
fur le bras. L’antiquité n’offre aucun modèle
de manches larges & pliflées à la manière des
chemifes de nos femmes. C’ eft par licence que
le Bernin en a donné de femblablesà fa fainte
Véronique, Plufieurs peintres & fculpteurs font
tombés dans cette faute de coftume.
Au refte , comme nous l’avons d it, il ne faut
pas croire que lesmonumens nous faffent con-
noître toutes les fortes de robes-dont les femmes
faifoient ufage. Nous ne favons pas ce que-
c’étoit que les vêtemens nommés ampéchoné,
anaboîé, xyftis. L’ignorance où nous femmes à
cet égard, peut donner aux artiftes quelque libertés
, & défarmer les cenfeurs trop févères.
Les femmes ceignoient leurs robes au-deffous
du fein , 8c cet ufage fé trouve encore aujourd’hui
dans plufieurs endroits de M a Grece. Leur
ceinture étoit un ruban qui le hommoic tæ-
nia , ftophion , mitra. Quelquefois il eft apparent
dans les figures , quelquefois il eft caché
par les plis- de la robe qui le recouvrent. A
la petite Pallas de bronze de laV illa Albani,
& aux - figures de femmes du plus beau vafe 4e la coHeâion d’Ham-lton , on voit trois cordons
avec un noeud fe détâcher des deux bouts
de la ceinture. La ceinturé forme fous le fein
un noeud qui e ft quelquefois en rofecte. A la
plus jeune des filles de Niobé, on voit les
deux bouts de la ceinture paffer fur les épaules
! & fur le dos : e’eft ce qu’on peut aufli remarquer
aux quatre cariatides de grandeur natu
r e lle traimé’é's en 1761 à Monté - Portio ,
près, de Frefcati. Quelques figures du Té-?
rene-e du Vatican nous montrent la robe
attachée de cette manière par deux rubans
fur le haut des épaules : c’eft du moins ce
que doivent faire fuppofer l'es bandes qui tombent
des deux coïtés,:Cês bandes ou rubans fourenoient
la ceinture. Quelquefois la ceinture n’ eft pas
une fimpde bandelette, mais un large ruban,
, comme bn le voit à plufieurs figures antiques.
Winichelnaann obferve que Mejpomène a coia-
G g g