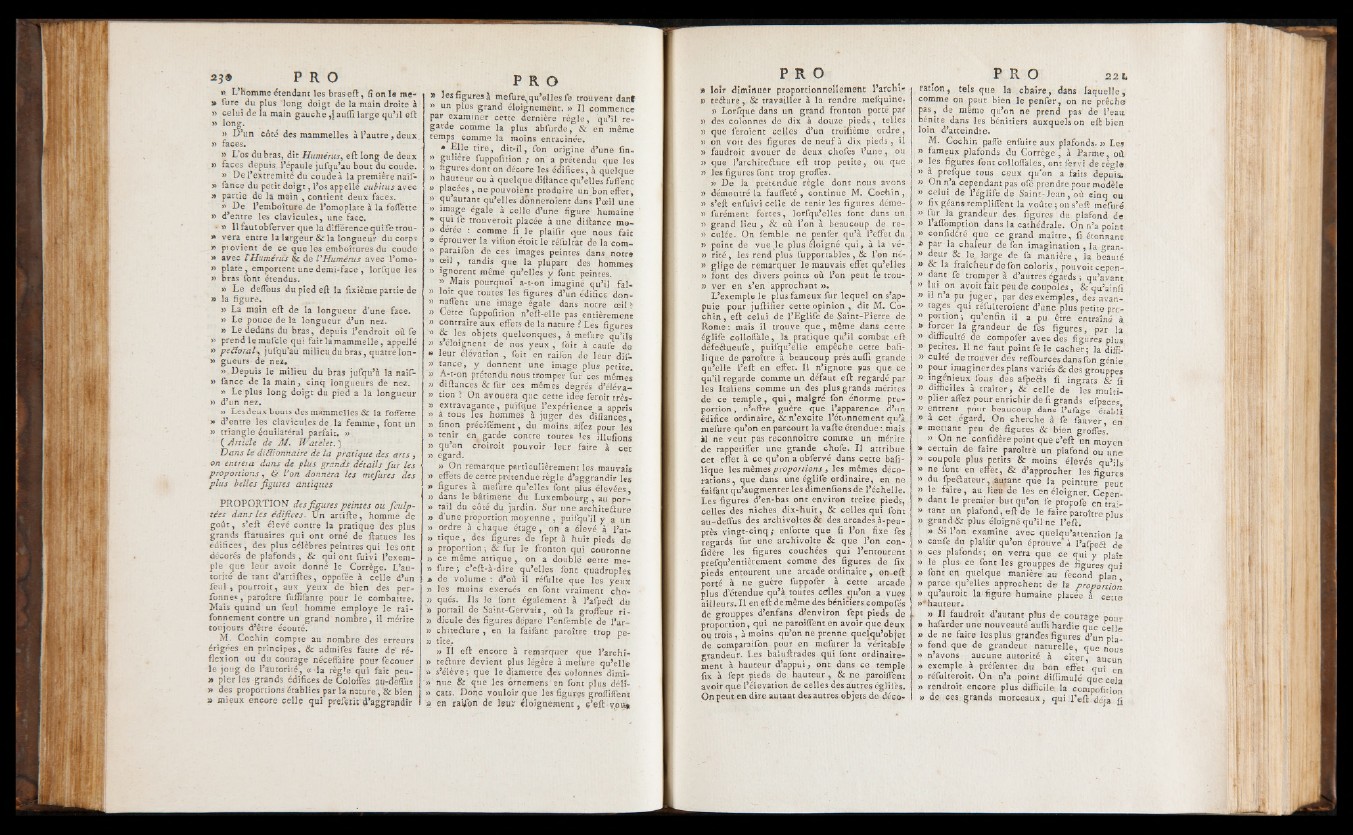
« L’homme étendant les bras e ft, fi on le me-
» lure du plus long doigt de la main droite à
» celui de la main gauche aufli large qu’ il eft
» long.
» D’un côte des mammelles à l’autre, deux.
» faces.
» L’os-du bras, dit Humérus, eft long de deux
» faces depuis-l’épaule jufqu’au bout du coude.
» De 1*extrémité du coude à la première naif-
» fance du petit d oigt, l’os appelle cubitus avec
» partie de la main , contient deux faces.
» De l’emboîture de l’omoplate à la foffette
» d’entre les clavicules, une face.
- » Il fautobferver que la différence qui fetrou-
» vera entre la largeur & la longueur du corps
» ptovient de ce que les emboîtures du coude
» avec THumérüs & de l'Iiumérus avec l’omo-
» plate , emportent une demi-face , lorfque les
» bras font étendus.
» Le deffous du pied eft la fixième partie de
» la figure.
» La main eft de la longueur d’une face.
» Le pouce de la longueur d’ un nez.
» Le dedans du bras, depuis l’endroit où fe
» prend le mufcle qui faitlamammelle, appeilé
» pecïüràî^ jufqu’au milieu du bras, quatre lon-
» gueurs de nez*
» Depuis le milieu du bras jufqu’à la naïf- '
» fance de la main, cinq longueurs de nez.
» Le plus long doigt du pied a la longueur
» d’un nez.
» Les deux bouts des mammelles & la foffette
» d’ entre les clavicules de la femme, font un
» triangle éauilatéral parfait. » ;
( Article de M . ÎVatelet. ) ;
Vans le dictionnaire de la pratique des arts ,
on entrera dans de plus grands détails fu r les
proportions, & Von donnera les mefures des
plus belles figures antiques
PROPORTION des figures peintes ou fculp-
tées dans les édifices. Un artifte, homme de
goû t, s’ eft élevé contre la pratique des plus
grands ftatuaires qui ont orné de ftatues les
édifices, des plus célèbres peintres qui les ont
décorés de plafonds, & qui ont fuivi l’exemple
que leur avoit donné le Corrège. L’autorité
de tant d’artiftes, oppofée à celle d’ un
le u l , pourroit, aux yeux de bien des per-
fbnnes, paraître fuffifante pour le combattre.
Mais quand un feul homme employé le rai-
fonnement contre un grand nombre, il mérite
toujours d’ être écouté. ’
M. Cochin compte au nombre des erreurs
érigées en principes, & admifes faute de' ré?
flexion ou du courage néceflaire pour fecouer
le joug de l’autorité, « la règle qui fait peu-
» pier les grands édifices de Colofles au-deffhs
» des proportions établies par la nature, & bien
a» «lieux ençore celle qui prefçrit d’aggrandir I
» les figures à mefure^qu’ elles fe trouvent danf
» un plus grand éloignement. » Il commence
par examiner cette dernière règle, qu’ il regarde
comme la plus abfurde, & en même
temps comme la moins enracinée.
* '^ 5 c*re> ditril, fon origine d’une fin-
» gulièrë fuppofition ; on a prétendu que les
» figures dont on décore les édifices, à quelque
» hauteur ou à quelque diftance qu’elles fuffent
» placées, ne pouvoient produire un bon effet,
_» qu autant qu’elles donneraient dans l’oeil une
» image égale à celle d’ une figure1 humaine
» qui le trouverait placée à une diftance mo~
» dérée : comme fi le plaifir que nous fait
» éprouver la vifion étoit le réfultat de la com-
» paraifon de ces images peintes dans notre
» oeil , tandis que la plupart des hommes
» ignorent même qu’elles y font peintes.
» Mais pourquoi a-t-on imaginé qu’ il fal-
» loit que toutes lés figures d’ un édifice don-
| * naflenc une image égale dans notre oeil ?
» Cette fuppofition n’eft-elle pas entièrement
i » contraire aux effets de la nature ? Les figures
j » & les objets quelconques, à mefure qu’ils
| » s éloignent de nos yeux , foit à caufe de
•» leur élévation , foit en raifon de leur dil^
» tance, y donnent une image plus petite.
» A-t-on prétendu nous tromper fur ces mêmes
» difiances & fur ces mêmes degrés d’éléva-
» tion ? On avouera que cette idée ferait très-
» extravagante, puifque l’expérïence a appris
» à tous les hommes à juger des diffance,s
» finon précifément, du moins affez pour les
» tenir en garde contre toutes les Ululions
» qu’on croirait pouvoir leur faire à cet
» égard.
» On remarque particulièrement les.mauvais
» effets de cette prétendue règle d’aggrandir le$
» figures a mefure qu’elles font plus élevées,
» dans le bâtiment du Luxembourg, au por-
» tail du côté du jardin. Sur une architeéîure
» d’une proportion moyenne , puifqu’il y a un
» ordre à chaque étage, on a élevé à l’a&-
» tiq u e , dès figures de fept à huit pieds de
» proportion j & fur le fronton qui couronné
» ce même attique , on a doublé eette me-
» fure ; c’eft-à-dire qu’elles font quadruples
a de volume : d’où il réfulte que les yeux
» les moins exercés en font vraiment cho-
» qués. Us le font également , à l’ afpeél du
» portail de Samt-Gervai*, où la gro,fleur ri-
» dicuîe dés figures dépare l’enfemble de l'ar-
» chiteélure , en la faifant paroître trop pe-
» tite,
» Il eft encore à remarquer que l ’archi-?
» reclure devient plus légère à mefure qu’elle
v> s’élève ; que le diamètre des colonnes dimi-
» nue & que les ôrnemens en font plus délî-
» cats. Donc vouloir que les figures groffiflent
» en raison de leur éloignement, ç’eft yow*
» loîr diminuer proportionnellement l’archi-
» te â u r e ,.& travailler à la rendre melquine.
» Lorfque dans un grand fronton porté par
» des colonnes de dix à douze pieds, telles
» que feraient celles d’ un troisième ordre ,
» on voit des figures de neuf à dix pieds , il
» faudrait avouer de deux chofes l’ une , ou
» que l’architeélure eft trop petite, ou que
» les figures font trop grofles.
» De la prétendue règle dont nous avons
» démontré la fauffeté , continue M. Cochin,
» s’ eft enfuivi celle de tenir les figures déme-
« furément fortes, lorfqm’elles lbnt dans un
» grand lieu , & où l’on à beaucoup de re-,
» culée. On femble ne penfer qu’à l’effet du
» point de v u e ’le plus éloigné q ui, à la vé-
» r ité , les rend plus fupportables, & l’on né-
» glige de remarquer le mauvais effet qu’elles
» font des divers points où l’on peut fe trou-
» ver en s’en approchant ».
L’exemple le plus fameux fur lequel on s’appuie
pour juftiner cette opinion , dit M. Cochin
, eft celui de l’Eglife de Saint-Pierre de
Rome: mais il trouve que, même dans cette
églife colloffale, la pratique qu’ il combat eft-
défeétueufe, puifqu’ élle empêche cette bafi-
lique de paroître à beaucoup près aufîi grande
qu’elle l’eft en effet. Il n’ ignore pas que ce
qu’il regarde comme un défaut eft regardé par
les Italiens comme un des plus grands mérites
de ce temple, q u i, malgré fon énorme proportion,
n’offre guère que l’apparence d’un
édifice ordinaire, & n’excite l ’étonnement qu’à
mefure qu’on en parcourt la vafte étendue : mais
i l ne veut pas reconnoître comme un mérite
de rappetiffer une grande chofe. I l attribue
cet effet à ce qu’on a obfervé dans cette bafi-
lique les mêmes proportions, les mêmes décorations,
que dans une églife ordinaire, en ne
faifant qu’augmenter les dimenfions de l’échelle.
Les figures d’en-bas ont environ treize pieds,
celles des niches dix-huit, & celles qui font
au-deflus des archivoltes & des arcades à-peu-
près vingt-cinq; enforte que fi l’on fixe fes
regards fur une archivolte & que l’on con-
fidère les figures couchées qui l’entourent
rrefqu’entièrement comme des figures de fix
pieds entourent une arcade ordinaire, on -eft
porté à ne guère fuppofer à cette arcade
plus d’étendue qu’ à toutes celles qu’on a vues
ailleurs. I l en eft de même des bénitiers compofés
de grouppes d’enfans d’environ fept pieds de
proportion, qui ne paroiflent en avoir que deux
ou trais, à moins qu’on ne prenne quelqu’objet
de comparaifon pour en mefurer la véritable
grandeur. Les baluftrades qui font ordinairement
à hauteur d’appui, ont dans ce temple
fix à fept pieds de hauteur, & ne paroiflent
avoir que l’élévation de celles des autres églifes.
On peut en dire autant des autres objets de décoration,
tels que la chaire, dans laquelle,
comme on peut bien le penfer, on ne prêche
pas, de même qu’on ne prend pas de l’eau
bénite dans les bénitiers auxquels on eft bien
loin d’atteindie.
M. Cochin paffe enfuite aux plafonds. » Les
n fameux plafonds du Corrège , à Parme, où
» les figures font colloffales, ont fervi dérègle
” à prefque tous ceux qu’on a faits députa.
» On n’a cependant pas ofé prendre pour modèle
» celui de l’églife de Saint-Jean, où einq ou
« fix géans rempliffent la voûte ; ou s’ eft tnefuré
» fur la grandeur des figures ' du plafond de
» l’affomption dans la cathédrale. On n’a point
» conftdéré que ce grand maître, fi étonnant
a par * la chaleur de fon imagination , la gran-
» deur & le, large de fa manière , ia beauté
» & la fraîcheur de fon coloris, pouvoit cepen-
” dant fe tromper à d’autres égards ; qu’avant
» lui on avoit fait peu de coupoles, & qu’ainfi
» il n’a pu ju g e r , par des exemples, des avan-
» rages qui réfulteroient d’ une plus petite prc-
« portion; qu’enfin il a pu être entraîne à
» forcer la grandeur de fès figures, par la
» difficulté de compofer avec des figures plus
» petites. Il ne faut point fê le cacher; la diffi-
» culte de trouver des reffources dans fon génie
» pour imaginerdesplans variés&des grouppes
» ingénieux fous des afpeéls fi ingrats & fi
» difficiles à traiter, & celle de les multi-
» plier affez pour enrichir de fi grands efpaces
» entrent pour beaucoup dans l’ ulage établi
» à cet .égard. On cherche à fe fauver, en
» mettant peu de figures & bien groffes.
» On ne confidère point que c’eft un moyen
» certain de faire paraître un plafond ou une
» coupole plus petits & moins élevés qu’ ils
» ne font en effet, & d’approcher les figures
» du fpeélateur, autant que la peinture peut
P le faire, au lien de les en éloigner. Cepen-
» dant le premier but qu’on fe propofe en tral-
» tant un plafond, eft de le faire paraître plus
» grand & plus éloigné qu’ il ne l ’eft. r
» Si l’on examine avec quelqu’attention la
» caufe du plaifir qu’on éprouve à l’afpeft de
» ces plafonds; on verra que ce qui y plaît
» le plus* ce font les grouppes de figures qui
» font en quelque manière au fécond plan
» parce qu’ elles approchent de 1a proportion
» qu’auroit la figure humaine placée a cette
»# hauteur.
» Il faudrait d’autant plus de courage pour
» hafarder une nouveauté auffi hardie que celle
» de ne faire les plus grandes figures d’un pla-
» fond que de grandeur naturelle, que nous
» n’avons aucune autorité à citer aucun
» exemple à préfenter du bon effet’ qui en
» réfulteroit. On n’ a point diftïmulé que cela
» rendrait encore plus difficile; la compofition
» de ces.grands morceaux, qui l ’eft dc.ja fi