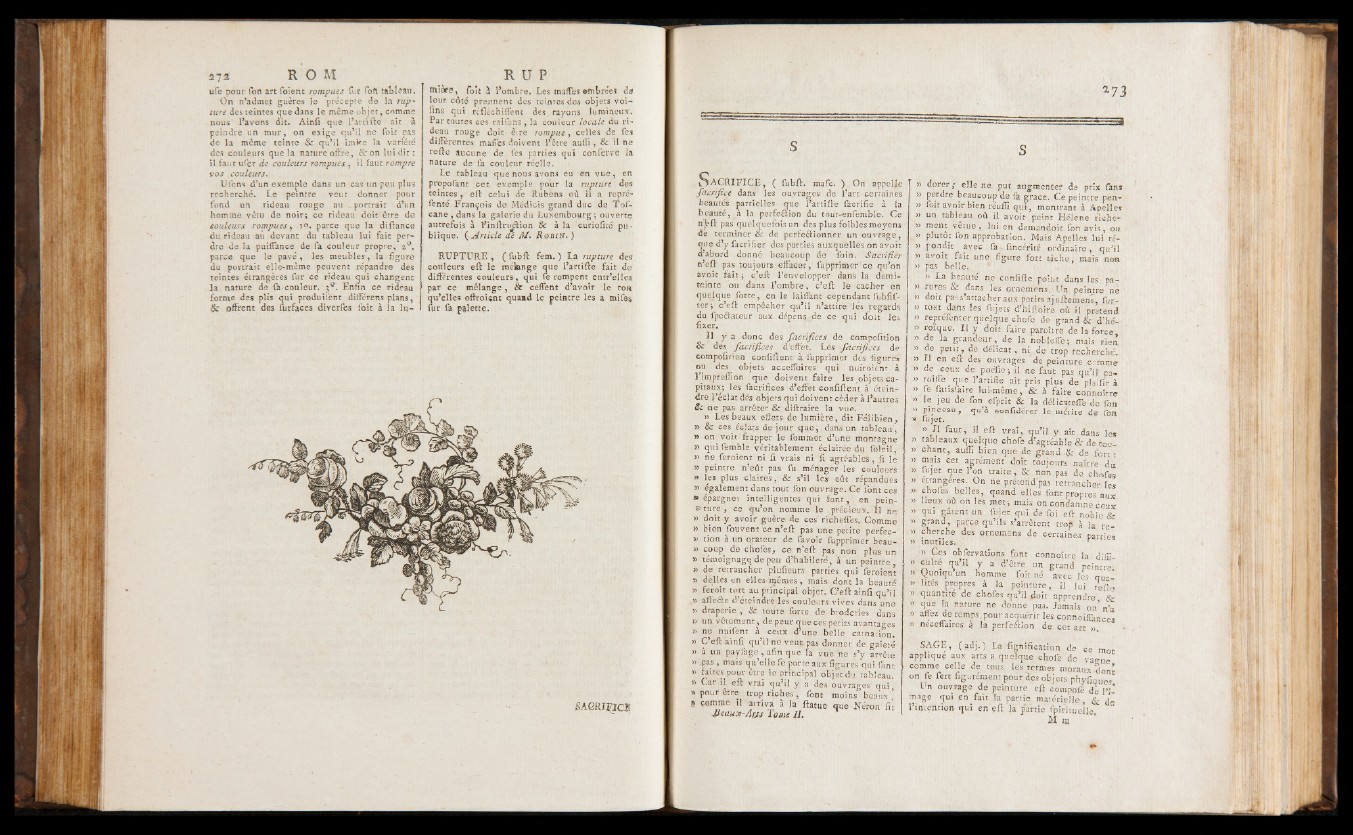
a 7 a R O M
ufe pour Ton art foient rompues fur ioft tableau.
On n’admet guères le précepte de la rupture
des teintes que dans le même objet, comme
nous l’avons dit. Ainfi que l’artifte ait à
peindre un mur, on exige qu’ il ne foie pas
de la même teinte 8c qu’ il imke la variété
des couleurs que la nature offre, & on lui dit:
il faut ufer de couleurs rom pues, il faut rompre
•vos couleurs.
Ulons d’un exemple dans un cas un peu plus
recherché. Le peintre veut donner pour
fond un rideau rouge au . portrait d’un
homme vêtu de noir; ce rideau doit être de
couleurs rom pues, i ° . parce que la diftance
du rideau au devant du tableau lui fait perdre
de la puiffance de fa couleur propre, a9,
parce que le pavé, les meubles, la figure
du portrait elle-même peuvent répandre des
teintes étrangères fur ce rideau qui changent
la nature de fa couleur. 3°. Enfin ce rideau
forme des plis qui produisent différens plans,
8c offrent des furfaces diverfes foit à la lu -
R U P
nùère, foït à l’ombre. Les maffes ombrées ds
leur côté prennent des teintes des objets voi-
fins qui ré fiée biffent des rayons lumineux.
Par toutes ces rai fa ns , la couleur locale du rideau
rouge doit êire rom pue, celles de fes
différentes mafîes doivent l’être auffi, & il ne
refte aucune de fes parties qui conferve la
nature de fa couleur réelle.
Le tableau que nous avons eu en vu e , en
propofant cet exemple pour la rupture des
teintes, efl celui de Rubens où il a repré-
fenté François de Médicis grand duc de Toi-
cane , dans la galerie du Luxembourg; ouverte
autrefois à Rinftruélion & à la curiofité publique.
(sA rticle de M . R o b in . )
RUPTURE , ( fubft fem. ) La rupture dçs
couleurs eft le mélange que l’artifte fait de
différentes couleurs, qui fe rompent entr’ elles
par ce mélange, & ceffent d’avoir le toa
qu’elles oftroiçnc quaad le peintre les a mife-s
fur fa palett?.
SACRIFICE
a 73
S S
O A C R IF IC E , ( fubff. mafe. ) On appelje
facrïfice dans les ouyrages de l’arc certaines
beautés partielles que l’artifte facrifie à la
beauté, a la perfection du tour-enfemble. Ce
n’^?ft pas quelquefois un des plus foibles moyens
de terminer & de perfectionner un ouvrage,
que d’y facrifier des parties auxquelles on avoit
d abord donné beaucoup de foin. Sacrifier
n’eft pas toujours effacer, fupprimer'ce qu’on
avoit fait ; c’eft l ’envelopper dans la demi-
teinte ou dans l ’ombre, c’eft le cacher en
quelque forte, en le laiffant cependant fuLfif-
ter ; c’eft empêcher qu’ il n’attire lés regarda
du fpeéiateur aux dépens de ce qui doit les
fixer.
Il y a donc des facrifices de compofition
& des facrifices d'effet. Les facrifices de
compofition confiftenr à Supprimer des figures
ou des objets accefloires qui nuiroient à
1 impreffion que doivent faire les objets*capitaux;
les facrifices d’ effet confiftent à éteindre
l’éclat dés objets qui doivent céder à l’autres
8c ne pas arrêter & diftraire la vue.
» Les beaux effets de lumière, dit Félibien,
» 8c ces éclats de jour que, dans un tableau,
» on voit'frapper le fommèt d’une montagne
» qui femble véritablement éclairée du foleil,
» ne feroient ni fi vrais ni fi agréable!», fi le
» peintre n’eût pas fu ménager les couleurs
» les plus claires, & s’ il les? eût répandues
» également dans tout fon ouvrage. Ce lont ces
» épargnes intelligentes qui font, en peines
ture , ce qu’on nomme le précieux. Il ne
» doit y- avoir guère de ces richefles.. Comme
» bien fouvent ce n’eft pas une petite perfec-
» tion a un o.rateur de favoir fupprimer beau-
» çoup de chofes, ce n’eft pas non plus un
» témoignage de peu d’habileré, à un peintre,
» de retrancher piufieurs parties qui feroient
» délies en e lle s ‘njêmes, mais dont la beauté
» feroit tort au principal objet. C’eft ainfi qu’ il
.» affecte d’éteindre les couleurs vives dans une
» draperie , & toute forte de broderies dans-
» un vêtement, de peur que ces petits avantages
» ne nuifent à ceux d’ une belle carnation.
» C’ eft.ainfi qu’ il ne veut pas donner de gaieté
» à un payfage, afin que la vue ne s’y arrête
» .pas, mais qu’elle fe porté aux figures qui font
» faites,pour être le principal objet du tableau.
» Car il eft vrai qu’ il y, a des ouvrages qui
» pour être trop riches, font moins beaux *
n comme il arriva à la ftatue que I^éron fie
M eau x-A fjs Tome II.
» dorer; elle ne. put augmenter de prix fans
» perdre beaucoup de fa grâce. Ce peintre pen-
» foit avoir bien réuffi qui, montrant à Apelles
» un tableau où il avoir peint Héîene riche4’
» ment vêtue, lui en demandoit fon avis, ou
plutôt fon approbation. Mais Apelles lui ré-
» pondit avec fa - fincérité ordinaire, qu’ il
» avoit fait une figure fort riche, mais non
» pas belle, '
» La beauté ne confifte point dans les pa-
» rures 8c dans les ornemens, Un peintre ne
» doit pas s’attacher aux petits ajuftemens, fur-
» tout dans les fujets d’hiftoire où il prétend
» repréfenter quelque chofe de grand & d’hé-
55 *°1(Iue- I l y doit faire paroilte de la force,
J » de la grandeur, de la noblefle; mais rien
» de petit, de délicat, ni de trop recherché.
» Il en eft des ouvrages de peinture.comme
» de ceux de poëfie; il ne faut pas qu’ il pa-
» roiffe que l’artifte ait pris plus de plaifir à
» fe fatisfaire lui-même, &: à faire connoître
'» le jeu de fon efprit & la délicateffe de fon
» pinceau, qu’à confidérer le mérite de fon ’
». fujet.
» I l faut, il eft vrai, qu’ il y ait dans les
» tableaux quelque chofe d’agréable &• de tou-
» chant, auffi bien que de grand .& de fort •
» mais cet agrément doit toujours naître dn
» fujet que l’on traite^, & non pas de chofes
» étrangères. On ne prétendras retrancher les
» chofes belles, quand elles font propres aux
» lieux où on les met; mais on condamne ceux
» qui gâtent un fujet qui de foi eft noble &
» grand, parce qu’ ils s’arrêtent trop à la re-
» cherche des ornemens de certaines parties
» mutiles. r
■ » Ces observations font connoître la diiE
» culte qu’ il y a d’être un grand peintre.
» yuoiqu un homme foit né avec les qu-
>» lités propres à la peinture, il lui
» quantité de chofes qu’ il doit apprendre &
» que fa nature ne donne pas. Jamais on’ n’a
» affez de temps,pour acquérir les connoiflances
» néceffaircs à la perfection de cet art » .
SAGE, (a d j.) La fignification de ce mot
applique aux arts a quelque chofe de vaeue
comme celle de tous les termes moraux dont
on fe fert figtirément pour des objets phyiiques
Un ouvrage de peinture eft compofé d e l ’i*
mage qui en fait la partie matérielle, & <]„
l’ intention qui en eft la partie fpirituelle.
M m