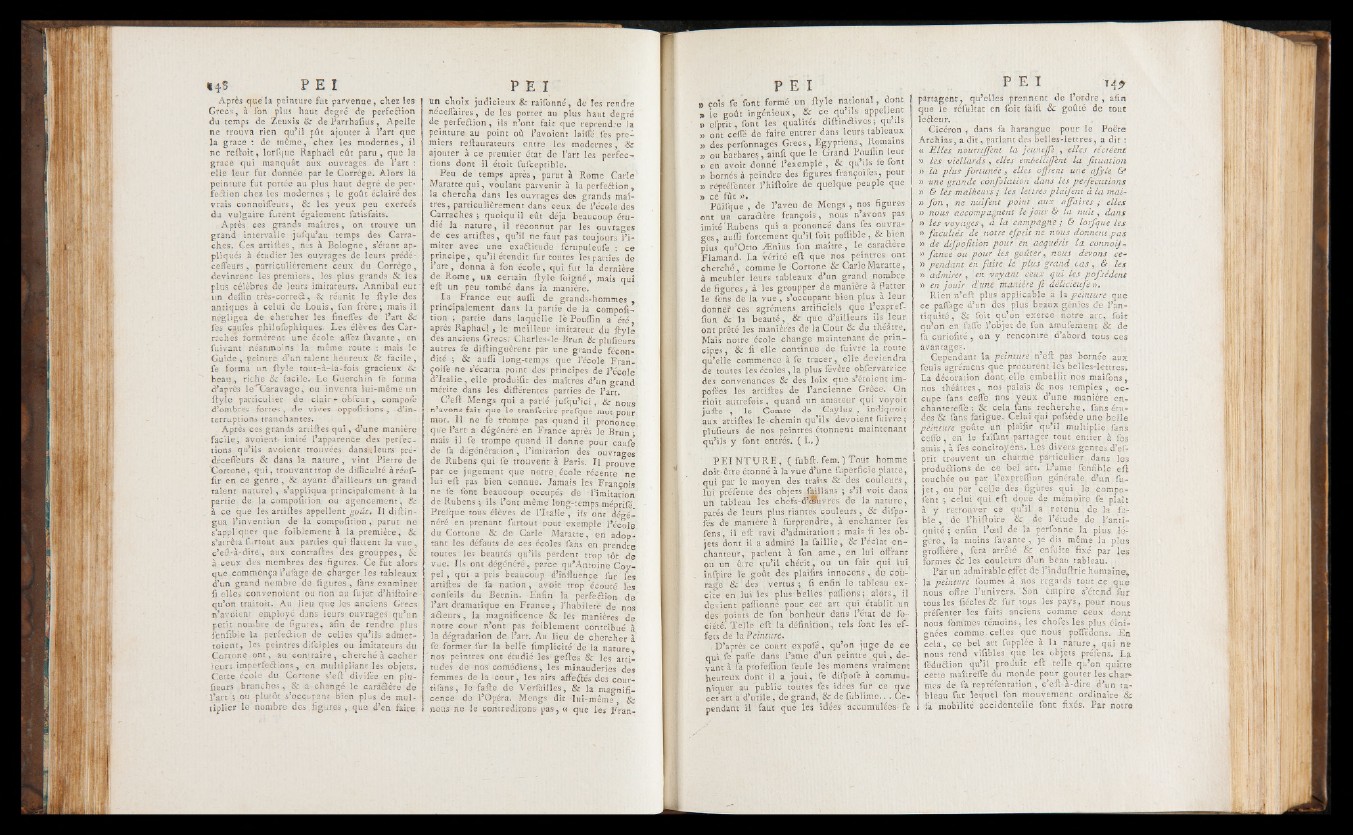
Après que la peinture fut parvenue, chez les
Grecs, à ion plus haut degré de perfe&ion
du temps de Zeuxis 8c de Parrhafius, Apelle
ne trouva rien qu’ il pût ajouter à l’art que
la grâce : de même, chez les modernes, il
ne reftoit, lorfque Raphaël eût paru , que la
gracè qui manquât aux ouvrages de l’ art :
elle leur fut donnée par le Gorrègé. Alors la
peinture fut portée au plus haut degré de per-
fëffion chez les modernes •, le goût éclairé des
vrais connoifleurs, & les, yeux peu exercés
du vulgaire furent également latisfaits.
Après ces grands maîtres, on trouve un
grand intervalle j.ufqu’au temps des Carra -
ches. Ces artiftes, nés à Bologne, s’étant appliqués
à étudier lès ouvrages de leurs prédé-
cefleurs, particulièrement ceux du Corrège,
devinrent les premiers, les plus grands 8c les
plus célèbres de leurs imitateurs. Annibal eut
un deflin très-correél, 8c réunit le fty le des
antiques à celui de Louis, fon frère; mais il
négligea de chercher les finefles de l’ art 8c
fes cailles pliilGfophiq.ues. Les élèves des Carraches
formèrent une école affez favante, en
fuivant néanmoins la même route : mais le
Guide, peintre d’ un talent heureux & facile,
fe forma un ftyle tout-à-la-fois gracieux 8c
beau,, riche & facile. Le Guerchin fe forma
d’ après le^ C a r a v a g e o u inventa lui-même un
fty le particulier de clair - obfcur, compofé
d’ombrés fortes, de vives oppofitions, d’in>-
terruptions tranchantes. -
Après ces.grands artiftes q u i, d’ une manière
fac ile, avaient- imité l’apparence des perfections
qu’ ils avoient trouvées- dansi^leur.s pré-'
déceffeurs & dans la nature , vint Pietre de
Xlortone, q u i, trouvanttrop de difficulté àrénf-
fir en ce g enre, & ayant d’ailleurs un grand
talent naturel, s’appliqua principalement à la
partie de la compoution ou agencement, &
à ce que les artiffes appellent goût. Il diftin-
gua l’ invention de la compofition, parut ne
s’appliquer que foiblement à la première, &
s’arrêta furtout aux parties qui flattent la vue,
c’ert-à-dire, aux contrarftes des groiippes, &
à ceux des membres des figures. Ce fut alors
que commença l’ ufage de charger les tableaux
d’un grand nombre dé figures , fans examiner
fl elles convenoient ou non au fit jet d’hiftoire
qu’on traitoit. Au lieu que les anciens Grecs
n’avoiem employé dans leurs ouvrages qu’ un
petit nombre de figures, afin de rendre plus
fie niable la perfeâion de celles qu’ ils admet-
toient, les peintres difciples ou imitateurs du
Cortone ont, au contraire, cherché à cacher
leurs imperfections , en multipliant les objets.
Cette école du Cortone s’.eft divifée. en pîu-
fieurs branches, & a changé le earâ&ère de
l’art *, ou plutôt s’occupant bien plus de multiplier
le nombre des , figures , que d’en faire
un choix judicieux &: rationné, de Tes rendre
néceflaires, de les porter au plus haut degré
de perfeélion , ils n’ont fait que reprendre la
peinture au point où l’avoient laiffé fies premiers
reftaurateurs entre les modernes, &
ajouter à ce premier état de l’art les perfections
dont il étoit fufceptible.
Peu de temps après , parut à Rome Carie
Marattequi, voulant parvenir à la perfeélion ,
la chercha dans les ouvrages des grands maîtres
, particulièrement dans ceux de l’écele des
Carraches ; quoiqu il eût déjà beaucoup étudié
la nature, il reconnut par les ouvrages
de ces artiftes, qu’il ne faut pas toujours l ’imiter
avec une exa&itude fcrupuleufe : ce
principe, qu’ il étendit fur toutes les parties de
l’a r t , donna à fon école, qui fut la dernière
de Rome, un certain ftyle foi g né, mais qui
eft un peu tombé dans la manière.
l a France eut aufïi de grands-hommes ,
principalement dans la partie de la compofition
-, partie dans, laquelle lp Pouffin a été,
après Raphaël , le meilleur imitateur du f tyle
des anciens Grecs: Charles-le-Brun & plufieurs
autres fe diftinguèrent par une grande fécondité
; & aufïi long-temps que l’école Fran-
çoife ne s’écarta point des principes de l ’école
d’I ta lie , elle produific des maîtres d’un grand
mérite dans les différentes parties de l’ art.
C’efl: Mengs qui a parlé jufiqu’i c i , & nous
n’avons fait que le tranferire prefque mot pour
mot. Il ne fe trompe pas quand il prononce
que l’art a dégénéré en France après le Brun ;
mais il~fe trompe quand il donne pour caufe
de fia dégénération, l ’imitation des ouvrages
de Rubens qui fie trouvent à Paris. I l prouve
par ce jugement que notre,école récente ne
lui eft pas bien connue. Jamais les François
ne fie font beaucoup occupés de l’imitation
de Rubens ; ils l’ont même long-temps méprifé
Prefque tous élèves de lTtalie , iis ont dégénéré
en prenant furtout pour exemple l’ école
du Cortone & de Carié Maratte, en adoptant
les défauts de ces écoles faiis en prendre
toutes'les beautés qu’ ils perdent trop tôt de
vue. Ils ont dégénéré, parce qu’Antoine Coy-
pel , qui a pris beaucoup d’influence fur les
artiftes de fia nation, avoit trop écouté les
confeils du Bernin. Enfin la perfection de
l’ art dramatique en France * l’habfleré de nos
acteurs, la magnificence & les manières de
notre cour n’ont pas foiblement contribué à
la dégradation de l’art. Au lieu de chercher à
fé former fur la belle (implicite''de la nature,
nos peintres ont étudié les geftes 8c les attitudes
de nos comédiens, les minauderies des
femmes de la cour, les airs affëétés des cour-
tifans, le fafte de Verfailles, & la magnificence
de l’Opéra. Mengs dit lui-même &
I nous ne le contredirons pas, « que les Fran-
» çoîs re font formé, un ftyle national, dont
33 le goût ingénieux, & ce qu’ ils appellent
» efprit, font les qualités diftinaives; qu ils
» ont ceffé de faire entrer dans leurs tableaux
» des perfonnages Grecs, Egyptiens, Romains
» ou barbares, ainfi que le Grand Pouffin leur
» en avoit donné l ’exemple, & qu’ ils ië font
» bornés à peindre des figures françoifes, pour
» rèpréfenter l ’hiftoire de quelque peuple que
» ce fût ».
Puifque , de l’aveu de Mengs , nos figures
ont un caraaère françois, nous n’avons pas
imité Rubens qui a prononcé dans fes ouvrages,
aufïi fortement qu’ il foit poffible, & bien
pius qu’Otto Ænius (on maître, le caraftere
Flamand. La vérité eft que nos peintres ont
cherché, comme le Cortone & Carie Maratte,
à meubler leurs tableaux d’un grand, nombre
de figures, à les groupper de maniéré a flatter
le fens de la v u e , s’occupant bien plus à leur
donner ces agrémens artificiels que l’expref-
fion & la beauté, & que d’ailleurs iis leur
ont prêté les manières de la Cour & du theatre.
Mais notre école change maintenant de principes
, & fi elle continue de fuivre la route
qu’elle commence à fe tracer , elle deviendra
de toutes les écoles, la plus févère ob.fervatrice
des convenances & des loix que s’etoient im-
pofées les artiftes de l’ancienne Grèce. On
rioit autrefois , ’quand un amateur qui voyoit
jufte , le Comte de Gaylus , indiquoit
aux artiftes le-chemin qu’ils dévoient fuivre ;
plufieurs de nos peintres étonnent maintenant
qu’ ils y font entrés. ( L, )
P E IN T U R E , ( fubft. fem. ) Tout homme
doit-être étonné à la vue d’une fuperfide platte,
qui par le moyen des traits & des couleurs,
lui préfèrite des objets,faillans ; s’ il voit dans
un tableau les chefs-d’* iv r e s de la nature,
parés de leurs plus riantes couleurs, 8C difpo-
fés de manière à furprendre, à enchanter fes
fens, il eft ravi d’admiration; mais fi lés objets
dont il a admiré la faillie , & l’éclat enchanteur,
parlent à fon ame, en lui offrant
ou un être qu’ il chérit, ou un fait qui lui
ïnfpire le goût des plaifirs innocens , du courage
& ’ dès vertus; fl enfin le tableau excite
en lui; lés plus belles pallions; alors, il
devient paffionné .pour cet art qui établit un
des points de l’on bonheur dans l’état de fio~
ci,été. T e lle eft la définition, tels font les effets
de la Peinture.
D’après ce court expofé, qu’on juge de ce
qui. fe palTe dans l’ame d’ un peintre q u i, devant
à fa profelîion feule les momens vraiment
heureux dont il a jo u i, fe difpole à communiquer
au public toutes fiés idées fur ce que
cet art a d’ utile, de grand, 8c de fublime.. . Cependant
il faut qué les idées accumulées- fe
partagent, qu’elles prennent de l ’ordre, afin
que lé réfultat en foit faifi 8c goûté de tout
leéleür. .
Cicéron dans fa harangue pour le Poète
Archias, a d it , parlant des belles-lettres, a dit :
cc Elles nournjjent la jeuneffe , elles récréent
» les viellards , elles embelliffent la jituation
» la plus fortunée , elles offrent une afyle G*
» -ane grande cônfolation dans les perféditions
» & les malheurs ; les lettres plaifent à la mai-
» f o n , ne nuifent point aux affaires ,• elles
>5 nous accompagnent le jour & la n uit, dans
» les voyages-, à la campagne ; & lorfque les
» facultés de notre efprit ne nous donnent.pas
» de difpofition pour en acquérir la çonnoij-
» fance ou pour les goûter, nous devons ce-
» pendant en faite le plus grand cas , & les
» admirer, en voyant ceux qui les pofsèdent
» en jouir d'une manière f i délicieufe ».
Rien n’eft plus applicable à la peinture que
ce paffag-e d’ un des plus beaux génies de l’antiquité,
& foit qu’ on exerce notre art, fioic
qu’on en fafîe l’objet de. fon amufement ,8c de
fa curiofité , on y rencontre d’abord tous ces
a van cages. ; ' . U ; • ^ 1 ; • -
Cependant la peintitrë n’eft pas bornée-aux
fieuls agrémens que procurent les belles-lettres.
La décoration dont, elle embellit nos maifions,
nos théâtres, nos palais & nos temples, occupe
fans cefle nos yeux d’une manière en-
chanterefle ; 8c cela fans recherche, fans études
& (ans fatigue. Celui qui pofsède une belle
peinture goûte un plaiftr qu’ il multiplie fans
ceffe , en le faifant partager tout entier à fies
amis, à fes concitoyens. Les divers genres d’eP-
prit trouvent un charme particulier dans les
produ&ions de ce bel' art. L’ ame fenfible eft
touchée ou par l’expreffion générale, d’un fiu-
je t , ou par celle des figures qui le compo-
fient ; celui qui eft doué âe mémoire fe plaît
à y retrouver ce qu’ il à retenu . de la fable
, de l’ hiftoire & dë l’étude, de l’antiquité
; enfin l’oeil de îa perfonne la plus légère,
la moins lavante , je dis même la plus
groffière, fera arrêté 8c en fui te fixé par les
formes 8c les couleurs d’ un beau tableau.
Par un admirable effet de l’ induftrie humaine,
la peinturé foumet à nos regards tout ce que
nous offre l ’univers. Son empire s’étend fur
tous les fiécles & fur toys les pays , pour nous
préfenter les faits anciens comme ceux dont
nous fommes témoins , les chofes les plus éloignées
comme, celles que nous portedons. En
cela, ce bel art fuppléê à ï i nature., qui ne
nous rend vifibles que les objets préfens. La
féduéiion qu’ il produit eft telle qu’on quitte
cette maîtreffe du monde pour goûter les char*-
mes de fa repréfentation, c’eft-à-dire d’un tableau
fur lequel fon mouvement ordinaire &
fa mobilité accidentelle font fixés. Par notre