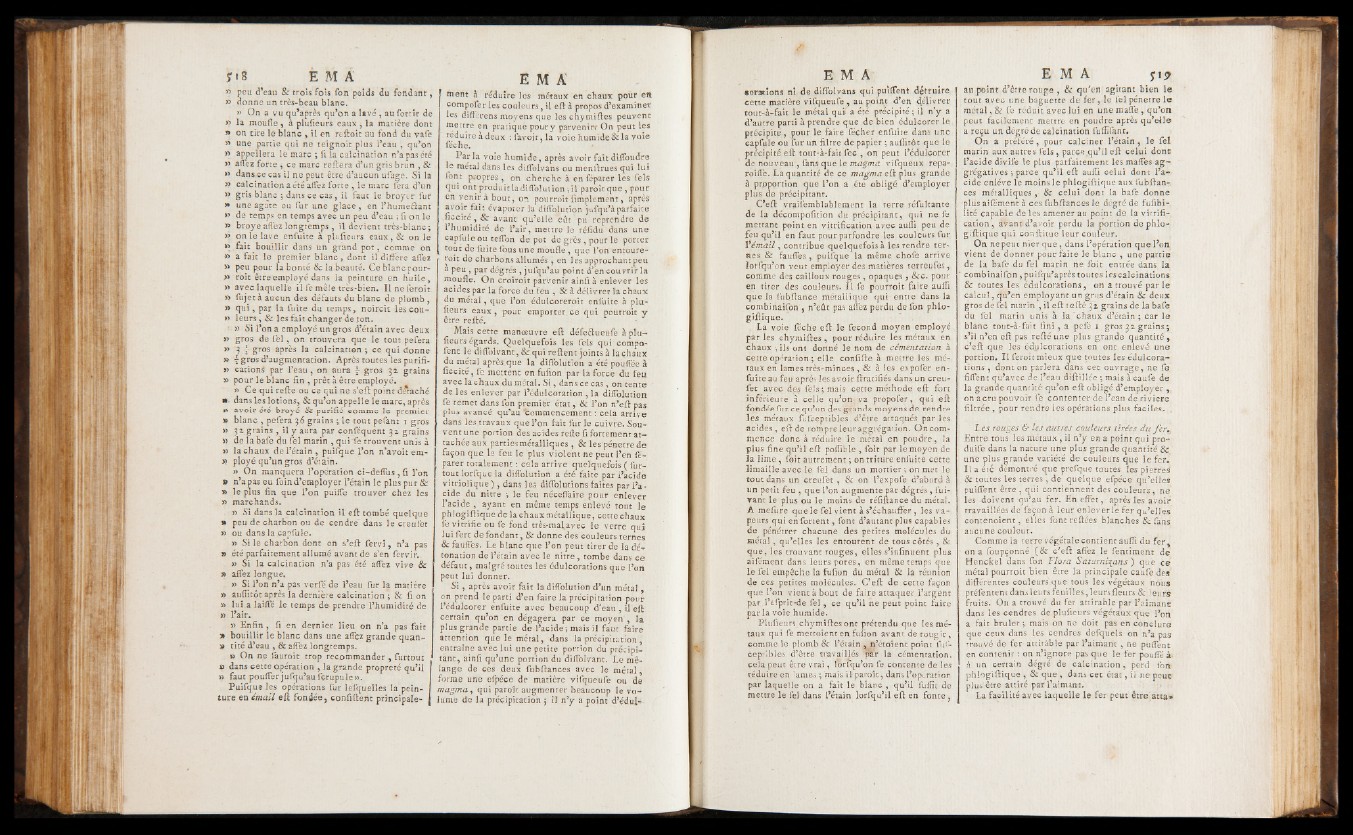
y 18 EMA
» peu d’eau & trois fois fon poids du fondant,
» donne un très-beau blanc.
» On a vu qu’après qu’on a lavé , au fortir de
» la moufle, à plufleurs eaux , la matière dont
J» on tire le blanc > il en reftoit au fond du vafe
» une partie qui ne teignoit plus l’eau , qu’ on
» appellera le marc ; fl la calcination n’a pas été
>5 allez forte ; ce marc reliera d’ un gris brun , &
» dans ce cas il ne peut être d’aucun ufage. Si la
» calcination a été allez forte , le marc fera d’un
» gris blanc ; dans ce cas, il faut le broyer fur
» une agate ou fur une g la c e , en i’ humeôant
» de temps en temps avec un peu d’ eau -, fi on le
» broyé allez longtemps , il devient très-blanc;
» on le lave enfuite à plu fieufs eaux, & on le
» fait bouillir dans un grand p ot, comme on
» a fait le premier blanc, dont il différé a fiez
» peu p.our la bonté & la beauté. Ce blanc pour-
>> roit être employé dans la peinture en h u ile ,
» avec laquelle il le mêle très -bien. Il ne feroit.
» fujetà aucun des défauts du blanc de plomb ,
» q u i, par la fuite du temps, noircit les cou-
» leurs, & les fait changer de ton.
I » Si l’on a employé un gros d’étain avec deux
» gros de f e l , on trouvera que le tout pefera
» 3 v gros après la calcination ; ce qui donne
» f gros d’augmentation. Après toutes les purifi-
» cations par l’eau, on aura f- gros 32 grains
» pour le blanc fin , prêt à être employé. ^
» Ce qui refie ou ce qui ne s’efl point détaché
*- dans les lotions, & qu’on appelle le marc, après
» avoir été broyé & purifié comme le premier
» blanc , pefera 36 grains ; le tout pefant 1 gros
» 32 grains , il y aura par conféquent 32 grains
» de la bafe du fel marin , qui'fe trouvent unis à
» la chaux de l’étain, puifque l’on n’ayoit em-
» ployé qu’ un gros d’étain.
» On manquera l’opération ci-deffus , fi l’on
9 n’ a pas eu foin d’ employer l’étain le plus pur & j
» le plus fin que l’on puifle trouver chez les
» marchands.
. » Si dans la calcination il efl tombé quelque
» peu de charbon ou de cendre dans le creufet
» ou dans Iacapfule.
>5 Si le charbon dont on s’efl fe rv i, n’a pas
» été parfaitement allumé avant de s’en fervir.-
» Si la calcination n’a pas été allez vive &
9 affez longue.
» Si l’on n’ a pas verfé de l’ eau fur la matière
» aufiitôt après la dernière calcination ; & fi on
» lui a 1 aille le temps de- prendre l’humidité de
» l’air.
» Enfin, fi en dernier lieu on n’a pas fait
9 bouillir le blanc dans une afiez grande quan-
9 tité d’ eau , & afiez longtemps.
» On ne fauroit trop recommander , furtout
9 dans cette opération , la grande propreté qu’ il J
» faut pouffer jufqu’aufçrupule». I
Puifque les opérations fur lefquelles la pein^ I
ture en émail efl fondée, confiflent principale- 1
EMA’
nient à réduire les métaux en chaux pour en
composer les couleurs, il efl à propos d’examiner
les difterens moyens que les chymifles peuvent
mettre en pratique pour y parvenir? On peut les
réduire à deux : lavoir, la voie humide & la voie
féche. ’
Par la voie humide, après avoir fait diffoudre
le métal dans les difiolvans ou menflruesqui lui
font propres , on cherche à en féparer les fels
qui ont produit la diflolution -, il paroît q u e , pour
en venir à bout, on pourroit Amplement, après
avoir fait évaporer la difiblution jufqu’à parfaite
xfic c ité , & avant qu’elle eût pu reprendre de
1 humidité de l’air, mettre le réfidu dans une
capfuleou tefibn de pot de grès , pour le porter
tout de fuite fous une moufle , que l’on entourerait
de charbons allumés , en les approchant peu
a peu , par degrés , jufqu’au point d’en couvrir la
moufle. On croirait parvenir ainfi à enlever les
acides par la force du feu , & à délivrer la chaux
du métal, que l’on édulcoreroit enfuite à plu-
fieurs eaux, pour emporter.ee qui pourroit y
être refié.
Mais cette manoeuvre efl défeélueufe à plu-
fleurs égards. Quelquefois les fels qui compo-
fent le difiolvant, & qui refient joints à la chaux
du métal après.que la difiblution a été pouffée à
ficcité, fe mettent en fufion par la force du feu
avec la chaux du métal. S i, dans ce cas , on tente j
de les enlever par l’édulcoration , la difiblution
fe rèmet dans ion premiêr état, & l’on n’efi pas
l plus avancé qu’ au "bommencement : cela arrive
dans les travaux que l’on fait furie cuivre. Souvent
une portion des acides refie fi fortement attachée
aux parties métalliques , & les pénétré de
façon que le feu le plus violent ne peut l’en
parer totalement : cela arrive quelquefois ( fur-
tout lorfque la difiblution a été faite par l’acide
vitriolique) , dans les diffolutïons faites par l’a cide
du nitre ; le feu néceflaire pour enlever
l’acide , ayant en même temps enlevé tout le
phlogiflique de la chaux métallique, cettechaux
fe vitrifie ou fe fond très-mafavec le verre qui
luifert de fondant, & donne des couleurs ternes
& faufies. Le blanc que l’on peut tirer de la détonation
de l’étain avec le nitre, tombe dans ce
défaut, malgré toutes les édulcorations que l’on
peut lui donner.
S i , après avoir fait la difiblution d’un métal,
on prend le parti d’en faire la précipitation pour
l’édulcorer enfuite avec beaucoup d’eau , il eft
certain qu’on en dégagera par ce moyen , la
plus grande partie de l’acide; mais il faut faire
attention que le métal, dans la précipitation,
entraîne avec lui une petite portion du précipitant,
ainfi qu’ une portion du difiolvant. Le mélange
de ces deux fubflances avec le métal,
forme une efpéce de matière vifqueufe ou de
magma, qui paroît augmenter beaucoup le volume
de la précipitation ; il n’y a point d’éduf*»
E M A
«ornions ni de difiolvans qui puiffent détruire
cette matière vifqueufe, au point d’en délivrer
tout-à-fait le métal qui.' a été précipité; il n’y a
d’autre parti à prendre que de bien édulcorer le
précipité-, pour le faire fécher enfuite dans une
capfule ou fur un filtre de papier ; aufiitôt que le
précipité efl tout-à-fait fec , on peut l’édulcorer
de nouveau , fans que le magma vifqueux repa-
roifie. La quantité de ce magma efl plus grande
à proportion que l ’on a été obligé d’employer
plus de précipitant.
C’eft vraifemblablement la ferre réfultante
de la décompofition du précipitant, qui ne.fe
mettant point en vitrification avec aüfli peu de
feu qu’ il en faut pour parfondre les couleurs fur
Yémail, contribue quelquefois à les rendre ter-
ses & faufies, puifque la même chofe arrive
ïorfqu’on veut employer des matières terreufes,
comme des cailloux rouges , opaques 3 & c . pour
en tirer des couleurs. Il fe pourroit faire aufli
que la fubflance métallique qui entre dans la
combiiiaifon , n’eût pas afiez perdu de fon phlogiflique.
La voie feche efl le fécond moyen employé
par les chymifles , pour réduire les métaux en
chaux -, ils ont donné le nom de cémentation à
cette opération ; elle confifle à mettre les métaux
en lames très-minces , & à les expofer en-
fuite au feu après les avoir flratifiés dans un creufet
avec des fels ; mais cette méthode eft fort
inférieure à celle qu’on va propofer, qui efl
fondée fur ce qu’ un des grands moyens de rendre
les métaux fulceptibles d’être attaqués par les
acides, efl de rompre leur aggrégation. Oncom-
mence donc à réduire le métal en poudre, la
plus fine qu’ il efl pofiible , foit par le moyen de
la lime , foit autrement ; on triture enfuite cette
limaille avec le tel dans un mortier -, ôn met le
tout dans un creufet , & on l’expofe d’abord à
un petit feu , que l’on augmente par dégrés , fui-
vanc le plus ou le moins de refinance du métal.
A mefure que le fel vient à s’échauffer , les vapeurs
qui en fortent, font d’autant plus capables
de pénétrer chacune des petites molécules du
métal , qu’elles les entourent de tous côtés , &
que, les trouvant rouges, elles s’ infinuent plus
aifément dans leurs pores, en même temps que
le fel empêche la fufion du métal & la réunion
de ces petites molécules. C’ efl de cette façon
que l ’on vient à bout de faire attaquer l ’argent
par l’efprit'de fel , ce qu’il ne peut point faire
par la voie humide.
Plufleurs chymifles ont prétendu que les métaux
qui fe mettoient en fufion avant de rougir,
comme le plomb & l’étain n’étoienc point fuf-
cepvibles d’être travaillés par la cémentation,
cela peut être vrai, lorlqu’on fe contente de les
réduire en ’âmes ; mais il paraît, dans l’opcratior
par laquelle on a fait le blanc , qu’ il fufiit de
mettre le fel dans l’étain lorfqu’ il eft en fonte,
E M A
au point d’être rouge , & qu’en agitant bien le
tout avec une baguette de fe r , le fel pénétré le
métal, & fe réduit avec lui en une malle , qu’on
peut facilement mettre en poudre après qu’e lle
a reçu un dégréde calcination fuffifanr.
On a préféré, pour calciner l’étain, le fel
marin aux autres fe ls , parce .qu’il efl celui dont
l’acide divife le plus parfaitement les malles ag-
grégatives ; parce qu’ il efl aufii celui dont l’acide
enlève le moins le phlogiflique aux lu bilan-,
ces métalliques , & celui dont la bafe donne
plus aifément à ces fubflances le dégré de fufibi-
lité capable de les amener au point de la vitrification,
avant d’avoir perdu la portion de phlogiflique
qui conflitue leur couleur.
On ne peut nier que, dans l’opération que l’on
vient de donner pour faire le blanc , une partie
de la bafe du fel marin ne foie entrée dans la
combinaifon, puifqu’après toutes les calcinations
& toutes les édulcorations, on a trouvé par le
calcul, qu’ en employant un gros d’étain &: deux
gros de fel marin , il efl refié 32 grains de la bafe
du fel marin unis à la 'chaux d’étain; car le
blanc tout-à-fait fin i, a pefé 1 gros 32 grains;
s’il n’en efl pas refié une plus grande quantité ,
c’ efl que les édulcorations en ont enlevé une
portion. Il ferait mieux que toutes les édulcorations
, dont on parlera dans cet ouvrage, ne fe
fifient qu’avec de l’eau diflillée ; mais à caufe de
la grande quantité qu’on efl obligé d’ employer ,
on a cru pouvoir fe contenter'de l’eau de riviere
filtrée , pour rendre les opérations plus faciles. .
Les rouges & les autres couleurs tirées du fe rOJ
Entre tous les métaux , il n’y en a point qui pro-
duife dans la nature une plus grande quantité &
une plus grande variété de couleurs que le fer.
Il a étc démontré que prefque toutes les pierres
& toutes les terres , de quelque efpéce qu’elles
puiffent être , qui contiennent des couleurs, ne
les .doivent qu’au fer. En effet,'après les avoir
travaillées de façon à leur enleverle fer qu’elles
contenoient, elles font reliées blanches & fans
aucune couleur.
Comme la terre végétale contiént aufli du fe r9
on a foupçonné (& c’ efl afiez le fentiment de
Henckel dans fon Flora Satumi^ans ) que ce
métal pourroit bien être la principale caufe des
différentes couleurs que tous les végétaux nous
préfentent dans leurs feuilles, leurs fleurs & leurs
fruits. On a trouvé du fer attirable par l’ aimanc
dans les cendres de plufleurs végétaux que l’on
a fait brûler ; mais on ne doit pas en conclure
que ceux dans les cendres defquels on n’a pas
trouvé de fer actiràble par l’aimant , ne pùffent
en contenir : on n’ ignore pas que le fer pouffé à-
à un certain dégré de calcination, perd fon
phlogiflique , & que , dans cet état, il ne peut
plus être attiré par l’aimant.
La facilité avec laquelle le fer peut être atta*