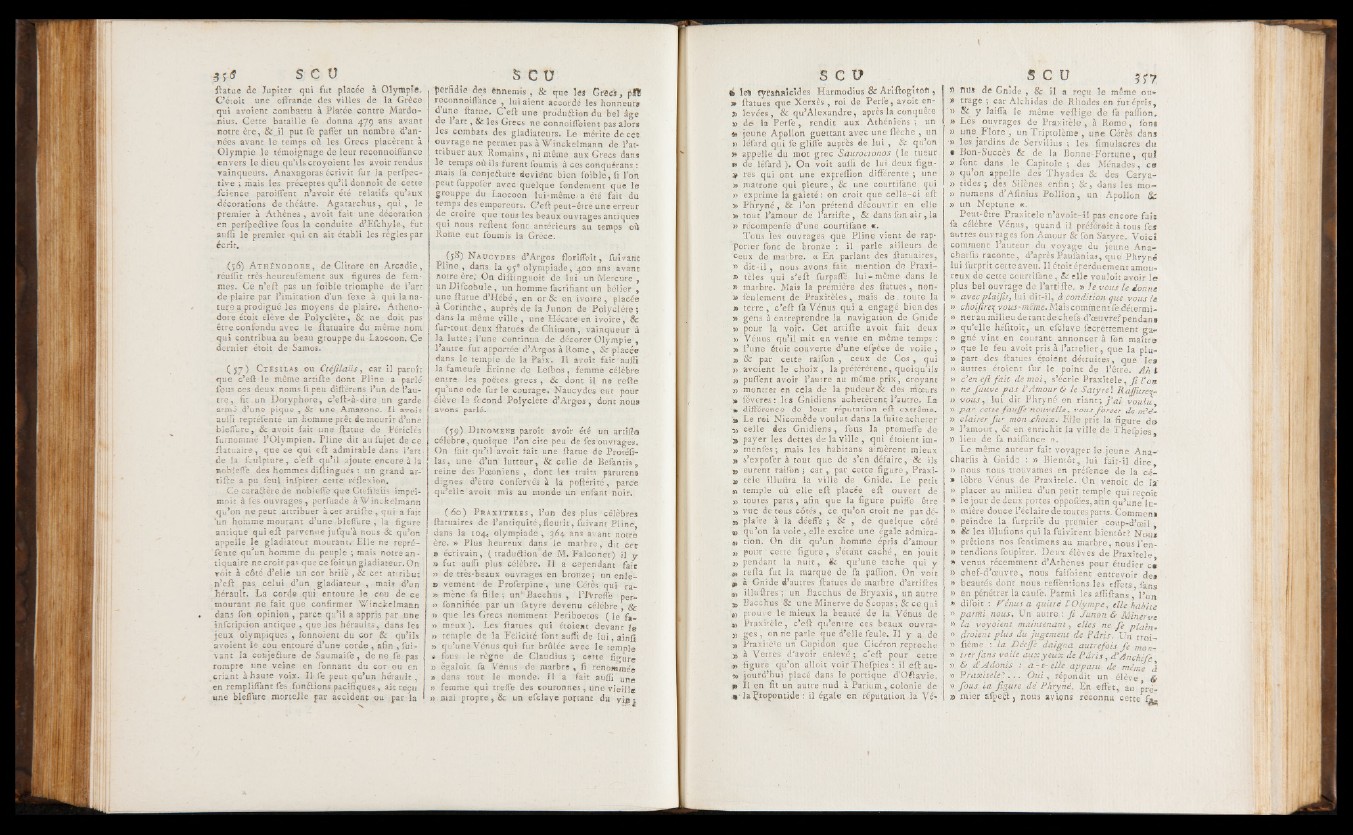
ftatue de Jupiter qui fut placée à Olympïé..
G’étoit une offrande des villes de la Grèce
qui avoient combattu à Platée contre Mardo-
nius. Cette bataille fe .donna 479 ans avant
notre ère, & il put fe paffer un nombre d’années
avant le temps où les Grecs placèrent à
Olympie Je témoignage de leur reconnoiflance
envers le dieu qu’ils croyoient les avoir rendus
vainqueurs. Anaxagoras écrivit fur la perfpec-
tlve ; mais les préceptes qu’ il donnoit de cette
fcience paroiffent n’avoir été relatifs qu’aux
décorations de théâtre. Agatarchus, qui , le
premier à Athènes , avoit fait une décoration
en perfpeétive fous la conduite d’Efchyle, fut
aufli le premier -qui en ait établi les règles par
écrit.
(56) Athénodore, de Clitore en Arcadie,
réuflit très-heureufement aux figures de femmes.
Ce n’eft pas un foibîe triomphe de l’arc
de plaire par l’imitation d’un fexe à qui la na-
rurejjDrodigue les moyens de plaire. Atheno-
dore ét6it élève de Polyclète, & ne doit pas
être confondu avec le flatuaire du même nom
qtui contribua au beau grouppe du Laocoon. Ce
dernier étoit de Samos.
(57) Ctésilas ou Ctéfilaiis, car il paroît
que c’ eft le même artifle dont Pline a parlé
fous ces deux noms fi peu diffère ns l’ un de l’autre
, fit un Doryphore, c’eft-à-dire un garde
arme d’une pique , & une Amazone. Il avoit
aulfi repréfenté un homme prêt de mourir d’une
bleflure, & avoit fait une ftatue de Périclès
furnommé l’Olympien. Pline dit au fujet de ce
flatuaire, que ce qui efl admirable dans l'art-
de la l’cülpture, c’eft qu’ il ajoute encore à la!
ïiob’lèfle des hommes diftingués : un grand artifice
a pu feul infpirer cette réflexion.
Ce caractère de noblefle que Ctéfilaiis impri-
moit à les ouvrages, perfuade àWinckelmann
qu’on ne peut attribuer à cet artifle, qui a fait
un homme mourant d’une bleflure , la figure
antique qui efl parvenue jufqu’à nous & qu’on
appelle le gladiateur mourant.- Elle ne repréfente
qu’ un homme du peuple ; mais notre antiquaire
ne croit pas que ce foit un gladiateur. On
voit à côté d’elle un cor brilë , & cet attribut
n’eft pas. celui d’un gladiateur , mais d’un
hérault. La corde .qui entoure le cou de ce
mourant ne fait que confirmer Winckelmann
dans fon opinion , parce qu’ il a appris par une
infcription antique , que les héraults, dans les
jeux olympiques , fonnoient du cor & qu’ ils
avoient le cou entouré d’une corde , afin , fui- 1
vant la conjeâure de Saumaife , de ne fe pas
rompre une veine en fonnant du cor ou en
criant à haute voix. I l fe peut qu’un hérault ,
en rempliflant fes fondions pacifiques, ait reçu
une bleffure mortelle par accident ou par la
'perfidie Ses en n em is , & q u e le s G r é e s , p i*
recon n oiflan ce lu i a ien t accordé le s honneur#
d u n e ftatu e. C e fl u n e production du b el âge
d e 1 a r t , & le s G recs n e con noifT oient pas alors
le s com b ats des g lad iateu rs. L e m érite d e c e t
o u v ra g e n e perm et pas àW in c k e lm a n n d e l’attrib
u er aux R om ains , n i m êm e aux G recs dans
le tem ps où ils fu ren t fournis à ces coh quérans :
m ais fa con jectu re d ev ie n t b ien fo ib le , fi l’on
p eut fuppofer a v ec q u elq u e fon d em en t q u e le
grouppe du L aocoon lu i-m êm e^ a été fa it-d u
tem ps des em pereurs. C ’e ft p eu t-être u n e erreur
d e croire q u e tou s les beau x o u vra ges a n tiq u es
q u i n ou s relien t font, antérieurs au tem ps où
R om e eu t fournis la G rèce.
(5 8 ) N aucydes d’A rg os flo r iflo it, fu îva n t
P lin e , dans la 9 5 e o ly m p ia d e , 4 0 0 ans avan t
n otre ère.' O n d iftin g u o it de lu i u n M ercure ,
un D ifc o b u le , un h om m e facrifiant un b élier ,
u n e ftatu e d’H é b é , en or & en iv o ir e , p lacée
a C o r in th e , auprès d e la Junon d e P o ly c lè te ;
dans la m êm e v ille , u n e H écate en iv o ir e , &
fur-tout d eux fla tu ès d e C h im o n , vain q u eu r à
la lu tte , l’un e con tin u a de décorer O lym p ie ,
l’autre fu t apportée d’A rgos à R om e , & p lacée
dans le tem p le de la P a ix . I l a v o it fait 'aufïi
la fam eu fe E rin n e d e L e fb o s, fem m e célèb re
en tre le s p o ètes g recs , & d on t il n e re lie
qu ’un e o d e fur le co u ra g e. N a u cy d es eu t pour
élèv e le fécon d P o ly c lè te d’A r g o s , don t n ou s
avons parlé.
(59) Dingwene paroît avoir été u n artifta
c é lè b r e , q u o iq u e l’on c ite peu de fes ou vra ges.
O n fait qu ’il a v o it fa it u n e ftatu e d e Protéfi-
la s , u n e d ’un lu tte u r , & c e lle d e B e fa n tis,
rein e des P oe on ien s , d on t les traits parurent»
d ig n es d’être con fervés à la p o ftérité, parc’e
q u ’e lle a v o it m is au m on d e un en fan t n o ir .
( 6 0 ) P r a x i t i l e s , l’un des plus célèb res
ftatuaires de l’a n tiq u ité ,fle u r it, fu iva n t P lin e
dans la 104e olym p iad e , 3 64 ans avan t notrè
ère. » P lu s h eu reu x dans le marbre, d it c e t
» é c r iv a in , ( traduClion de M . F a lc o n e t) il y
» fu t aufïi plus célèb re. I l a cep en d a n t fa it
» d e très-beaux ou vrages en bronze ; un e n le -
s v em en t d e P roferp in e , u n e Cérès q u i ra -
» m èn e fa fille -, u n 1 B acch u s , l ’IVrefle per-
» fon n ifiée par un fatyre d ev en u c é lè b r e , &
» q u e le s G recs n om m en t P erib oeto s ( le fa -
» m eu x ). L es ftatu es q ui éto ien t d evan t le
» tem p le d e la F é lic ité fon t aufïi de l u i , ainfi
» q u ’u n e V én u s q u i fut b rû lée a v ec le tem p le
» fous le règn e de C lau d iu s y ce tte fi<rure
» égal oit fa V én u s de m arbre , fi renom m ée
» dans tou t le m o n d e. Il ;a fait aufïi u n e
» fem m e q u i treffe des c o u ro n n e s, u n e v ie ille
» m al p ro p re, & un e fc la y e portant du y i# *
\
é le* fyfaftnîeides Harmodius & Arîftogïtofi ,
» ftatues que Xerxès , roi de Perle, avoit en-
i> levées, & qu’Alexandre, après la conquête
» dé la Perfe, rendit aux Athéniens ; un
«»•jeune Apollon guettant avec une flèche , un
» léfard qui fe gliffe auprès de lui , & qu’ on
» appelle du mot grec Sauroctonos (le tueur
1» de léfard ). On voit aufïi de lui deux figu-
» res qui ont une exprefîion différente ; une
» matrone qui pleure, & une courtifane qui
» exprime la gaieté : on croit que celle-ci eft
» Phryné, & l’on prétend découvrir en elle
» tout l’âmour dé l’artifte, & dans fon a ir , la
» récompenfe d’ une courtilàne «c.
Tous les ouvrages que Pline vient de rapporter
font de bronze : il parlé ailleurs de
ceux de marbre. « En parlant des ftatuaires,
» dit-il , nous avons fait mention de Praxi-
x> tèles qui s’ eft furpafle lui-même dans le
» marbre. Mais la première des ftatues , non-
» feulement de Praxitèles, mais d e . toute la
» terre , c’eft fa Vénus qui a engagé bien des
» gens à entreprendre la navigation de Gnide
» pour la voir. Cet artifle avoit fait deux
» Vénus qu’ il mit en vente en même temps :
» l ’ une étoit couverte d’une efipèce de voile ,
» & par cette raifon , ceux de Cos , qui
» avoient le ch o ix , la préférèrent, quoiqu’ils
» puffent avoir l’autre au même prix, croyant
» montrer en cela de la pudeur & des moeurs
» févères : les Gnidiens achetèrent l’autre. La
& différence de leur réputation eft extrême.
» Le rèi Nicomède voulut dans la fuite acheter
ï > celle des Gnidiens, fous la promeffe de
» payer les dettes de la ville , qui étoient im-
» mentes-, mais les habitans aimèrent mieux
» s’expofer à tout que de s’en défaire, & ils
g» eurent raifon ; car , par cette figure, Praxi-
b cèle illuflra la ville de Gnide. Lé petit
» temple où elle eft placée eft ouvert de
» toutes parts, afin que la figure puiffe . être
» vue de tous côtés , ce qu’on croit ne pas dé-
53 plaire à la déeffe ; & , de quelque côté
© qu’on la v o ie , elle excite une égale admira-
© tion. On dit qu’ un homirfe épris d’amour
» pour cette figure, s’éta'nt caché, en jouit
© pendant la n u it , & qu’une tache qui y
$> refta fut la marque de Fa paffïon. On voit
p a. Gnide d’autres ftatues de marbre d’artiftes
illuftres ; un Bacchus de Bryaxis, un autre
© Bacchus & une Minerve de Scopas ; & ce qui
'*> prouve le mieux la beauté de la Vénus de
» Praxitèle, c’ eft qu’entre ces beaux ouvra-
» g e s , on ne parle que d’elle feule. Il y a de
3» Praxitèle un Cupiaon que Cicéron reproche
» à Verres d’avoir enlevé; c’eft pour cette
1» figure qu’ on alloit voir Thefpics : il eft au-
» jourd’hui placé dans le portique d’Oftavie.
® Il en fit un autre nüd à Parium, colonie de
.a T a Proponti.de : il égale en réputation la Véy>
nus de Gnide , & il a reçu le même ou®
» trage -, car Alchidas de Rhodes en fut épris,
» & y laiffa le même veftige de fa pafïion,
» Lés ouvrages de Praxitèle, à Rome, font
» une Flore , un Triptolème , une Cérès dans
•» les jardins de Servilius -, les fimulacres du
• Bon-Succes & de la Bonne-Fortune, qui
» font dans le Capitole ; des Ménades, c®
» qu’on appelle des Thyades & des Carya-
» tilles ; des Silènes enfin; dans les mo-
» numens d’Afinius Pollion, un Apollon &
» un Neptune «.
Peut-être Praxitèle n’àvoit-il pas encore fait
fa célèbre Vénus, quand il préferoit à cous fes
autres ouvrages fon Amour & fon Satyre. V o ic i
comment l’auteur du voyage du jeune Ana-
charfis raconte, d’après Paufanias, que Phryné
lui furprit cette aveu. Il étoit éperduement amoureux
de cette courtifane, & elle vouloit avoir le
plus bel ouvrage de l’artifte. » Je vous le donne
» avec plai(ir, lui dit-il, à condition que vous le
» choifire\ vous-même. Mais commentfe détermi-
■ » ner au milieu de tant de chefs- d’oeu vref pendant
» qu’elle héfitoit, un efclaye fecrettement ga-
» g né vint en courant annoncer à fon maître
» que le feu avoit pris à l’attelier, que la plu-
» parc des ftatues étoient détruites, que le®
» autres étoient fur le point de l’être. Ah l
» c’en ejl fa it de moi, s’écrie P r a x it è le f i Von
» ne fauve pas VAmour & le Satyre] RaJfure-%-
» vous, lui dit Phryné en riant; f ai voulu
» par cette faujfe nouvelle, vous forcer de thV-
» clairer f u *• mon .choix: Elle prit la figure d©
» l’amour, & en enrichit la v ille de Thefpies
» lieu de fa naiïfance ».
- Le même auteur fait voyager le jeune Ana-
charfis à Guide : » Bientôt, lui fait-il dire
» nous nous trouvâmes en préfenee de la cé-
» lèbre Vénus de Praxitèle. On venoit de la"
» placer au milieu d’ un petit temple qui reçoit
» le jour de deux portes oppofées, afin qu’une lu-
» mière douce l’éclaire de toutes parts. Comment
» peindre la furprife du premier conp-d’oeii
» & les illufions qui là fuivirent bientôt? Nous
» prêtions nos fentimens au marbre, nousl’en-
» tendions foupirer. Deux élèves de Praxitèle
» venus récemment d’Athènes pour étudier c#
» chef-d’oeuvre, nous faifoient entrevoir de*
» beautés dont nous refièntions les effets fans
» en pénétrer la caufe. Parmi les afïiftans l ’ un
» difoit : Vénus a quitté l'Olympe, elle habite
» parmi nous. Un autre : fe Junon & Minerve
» la voÿoient maintenant, elles ne f e plain-
» (,Iroïent plus du jugement de Paris. Un rroi-
» fième : la Déeffe daigna autrefois f é mon-*
» trer fans voile aux y eux de P a r is , d’Anchife
» & d'Adonis : a - t - elle apparu de même à
» Praxitèle?— Oui , répondit un élève 5»
« fous ia figure dé Phryné. En effet, au pré-
» mier afpe&, nous ayions reconnu cette fj^