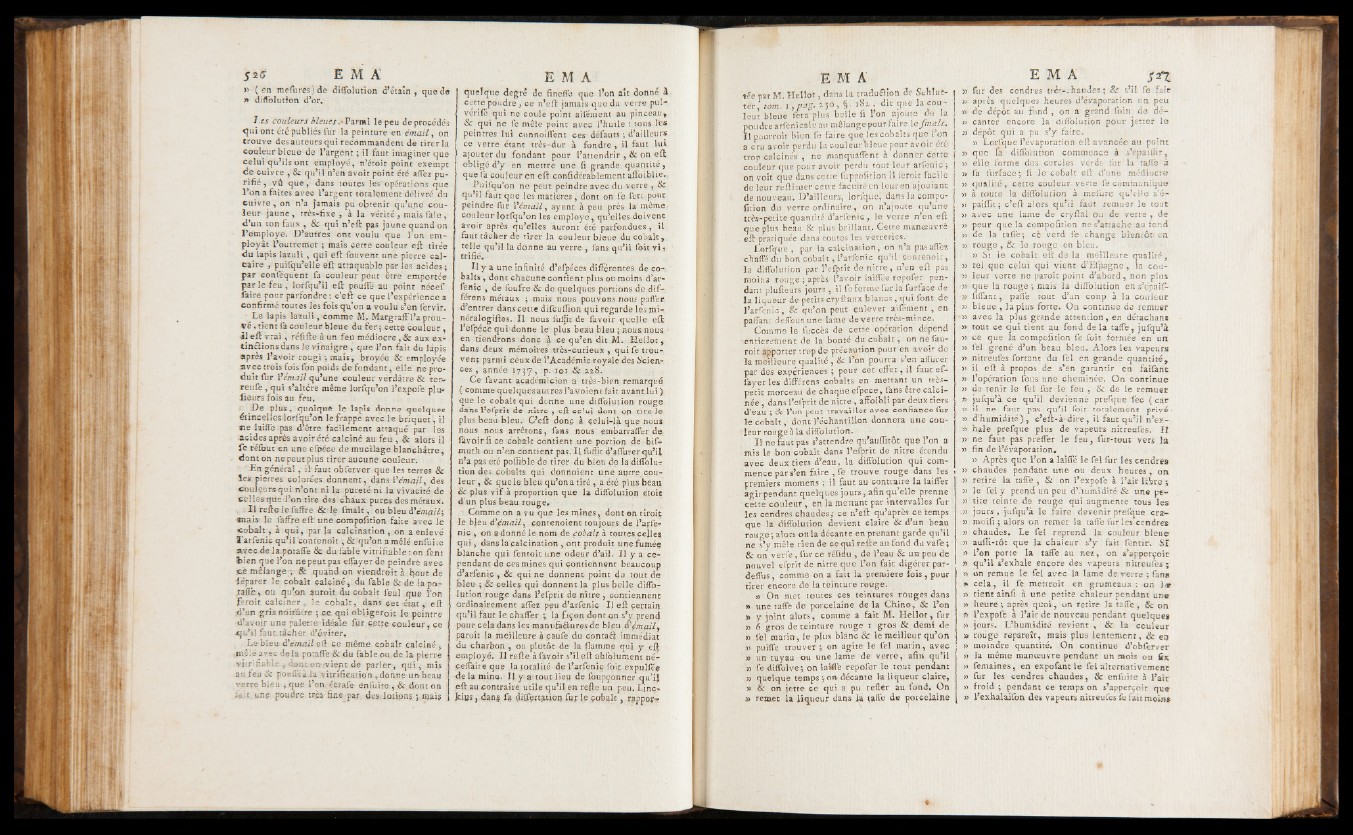
E M Â
» (en -mefures) de diffolution d’étaîn , que de
» diffolution d’or.
J,es couleurs bleues.»Parmi le peu deprocèdes
qui ont été publiés fur la peinture en émail, on
trouve des auteurs qui recommandent de tirer la
couleur bleue de l’argent ; il faut imaginer que
celui qu’ ils ont employé, n’étoit point exempt
de cuivre , & qu’ il n’en avoit point été affez purifié
, vû q ue, dans toutes les operations que
l ’on a faites avec l’argent totalement délivré du
c u iv re , on n’ a Jamais pu obtenir qu’une couleur
jaune , très-fixe , à la vérité , mais (aie ,
d ’un ton faux , 8c qui n’eft pas jaune quand on
l ’employé. D’autres ont voulu que Ton employât
l’outreiiiet ; mais cette couleur eft tirée
du lapis la zu li, qui eft fouvent une pierre calcaire
, puifqu’elle eft attaquable par les acides ;
par conféquent fa couleur peut être emportée
par le feu , lorfqu’ il eft pouffé au point néeef
faire pour parfondre : c’e ft ce que l’expérience a
Confirmé toutes les fois qu’on a voulu s’en fervir.
Le lapis la zuli, comme M. Margraff l’a prouvé
, tient fa couleur bleue du fer; cette couleur,
i l eft v ra i, réfifteà un feu médiocre, & aux ex-
tin&ions dans le vinaigre , que l’on fait du lapis
après l’avoir rougi ; mais, broyée 8c employée
av ec trois fois fon poids de fondant,.elle ne produit
fur Ÿémail qu’une couleur verdâtre & ter*-
reu fe , qui s’altère même lorfqu’on l’expofe pîu-
iieurs fois au feu,
De plus, quoique le lapis donne quelques
étincelleslorfqu’on le frappe avec le briquet', il
fie laiffe pas d’être facilement attaqué par les
acides après avoir été calciné au feu , & alors il
fe réfbut en une efpéçe de mucilage blanchâtre,
dont on ne peut plus tirer aucune couleur.
En général, i l faut obferver que les terres &
le s pierres colorées donnent, dans Ÿ émail, des
douleurs qui n?ont ni la pureté ni la vivacité de
celles que i’on.tire des chaux pures des métaux.
I l refte le faffre d^le fmàlt, ou bleu dVmai/;
«nais le faffre e f t une çompofition faite avec le
«obaJt, à q ui, par Ja calcination , on a enlevé
2’arfenic qu’ il contenoit , & qu’on a mêlé enfuice
avec.de la.poraffe & du fable vitrifiable :on fent
i>ien que l?on nepeut pas effayer de peindrè avec
3C.e mélange -, & quand on viendroit à bout de
iéparer le cobalt calciné, du fable & de !apo-
tafte., ou qu’on auroit du cobalt feu! .que l’on
feroit calciner, le cobalt, dans cet é ta t, eft
un gris noirâtre ; ce. qui obligeroit le peintre
d’avoir une palette idéale fur çetpe couleur, ce
-qu’ il faut tâcher d’ é-virer,
. Le bleu à?émail eft ce même cobalt calciné ,
jnêlé avec delà potaffe & du fable ou de la piçrre
vitrifiable y dont on-rvient dé parler-, q u i, mis ■
au feu & pottffeà la vitrification , donne un beau
verre bleu , que l’on jéfcrafe énfuite , & dont on
ifcit une poudre très-fine par. des potions ; mais
EMA
quelque degré de fineffe que l’on ait donné à
cette poudre . ce n’eft jamais que du verre pul-
vérifé qui ne coule point ailement au pinceau,
& qui ne fe mêle point avec l’huile : tous l'es
peintres lui connoiffent ces défauts ; d’ailleurs
ce verre étant très-dur à fondre , il faut lui
ajouter du fondant pour l’attendrir , & on eft
obligé d’y en mettre une fi grande quantité,
que fa couleur en eft considérablement affoiblie.,
Puifqu’on ne peut peindre avec du verre , &
qu’ il faut que les matières, dont on fe ferc pour
peindre fur Ÿémail, ayent à peu près la même-
couleur lorfqu’on les employé, qu’elles doivent
avoir après qu’elles auront été parfondues , il
faut tâcher de tirer la couleur bleue du cobalt,
telle qu’il la donne au verre , fans qu’ il foit vi i
trifié.
Il y a une infinité d’efpéces différentes de co-
balts, dont chacune contient plus ou moins d’ar-
lenic , de foufre & de quelques portions de différons
métaux ; mais nous pouvons nous pafl’er
d’entrer dans cette difeuflion qui regarde les mi-,
néralogiftes. I l nous fuffit de favoir quelle eft
1 efpéce qui donne le plus beau bleu ;nous nous -
en tiendrons donc à ce qu’ en dit M. H e llo t,
dans deux mémoires très-curieux , quife trouvent
parmi ceux de l’Académie royale des Sciences
, année 1737, P- lo i
Ce favant académicien a très-bien remarqué
( comme quelques autres l’avoiept fait avant lui )
que le cobalt qui donne une diffolution rouge
dans Pêfprit de nitre , eft celui dont op tire le
plus beau bleu. C’eft donp à çelui-là que nous
nous nous arrêtons, fans nous embarraffer de:
favoir fi ce cobak contient une portion de bifi*
muth ou n^en^ontient pas. I l fuffit d’afllirer qu’ i{
n’a pas été pofiible de tirer du bleu de la diffolu*
tion des çobalts qui donnoient une autre couleur,
& que le bleu qu’ on a tiré , aéré plus beau
& plus v if à proportion que la diffolution étoiç
d’un plus beau rouge.
Comme on a vu que les mines, dont on tiroic
le bleu tfçmail, contenoient toujours de i’ajrfe-
nic , on a donné le nom de cobalp a toutes cejlea
q u i, dans la calcination , ont produit une fuméç
blanche qui fentoit une odeur d’ail. Il y a cependant
de ces mines qui çontiennent beaucoup
d’arfeniç , & qui ne donnent point du tout de
bleu ; & pelles qui donnent la plus belle diffolution
rouge dans l’efprit de nitre , contiennent
ordinairement affez peu d’arfeniç II eft certain.
qu?iî faut le çhaffer ; la façon dont qn s’ y prend
pour cela dans les tnaniifàél-ures de bleu à’fmailj
paroît la meilleure à paufe du conta61 immédiat
du charbon , ou plutpt de la flamme qui y eft
employé. Il refte à favoir s’ il eft abfolument né-
ceffaire que la totalité de i’arfeniç foit expulfée
de la mina. Il y 3 tout lieu de foupçonner qu’ij
eft au contraire utile qu’ il en refte un peu. Line?
Jcius, d$n§ difiçL'tation fuj: lé çabalt, wppotr
E M A
«ée par M. H e llo t, dans la tradu&ion de Schlut- |
ter, tout. 1 -, P&S» 250, §. i8a , dit que la cou-
leur bleue fera plus belle fi l’on ajoute de la
poudre arfenicale au mélange pour faire 10 finale.
Il pourroit Bien fe faire que lescobalcs que l’on
a cru avoir perdu la couleur bleue pour avoir été J
trop calcinés , ne manquâffent à donner cette J
couleur que pour avoir perdu tout leur arfenic ;
on voit que dans cette ûtppofuion il feroit facile
de leur refticuer cett e faculté en leur en ajourant
de nouveau. D’ailleurs, lorfque, dans la compo-
fition du verre ordinaire, on n’ajoute qu’ une
très-petite quantité d’arfenic, le verre n’en, eft
que plus beau & plus brillant. Cette manoeuvré
eft pratiquée dans toutes les verreries.
Lorfqu e , par la calcinai ion, on n’ a pas affez
chaffé du bon cobalt, l’arfenic qu il contenoit,
la diffolution par l’efprit de nitre, n’ en eft pas
moins rouge ; après l’avoir laiffée repofer pendant
plufieurs jours , il fe forme fur la furface de
la liqueur de petits cryftaux blancs, qui font de
l ’arfçntc, 8c qu’on peut enlever aifément , en
paffant deffous une lame de verre très-mince.
Comme le fuccès de cette opération dépend
entieretnent de la bonté du cobalt, on ne fau-
roit apporter trop de précaution pour en avoir de
la meilleure qualité , & l’on pourra s’en affurer
par des expériences ; pour cet effet, il faut effayer
les différens cobalts en mettant un très-
petit morceau de chaque efpece, fans être calcinée
, dans l’ efprit de nitre, affoibli par deux tiers
d’eau ; & l’on peut travailler avec confiance fur
le cobalt, dortt l’échantillon donnera une couleur
rouge à la diffolution.
Il ne faut pas s’attendre qu’auflitôt que l’on a
mis le bon cobalt dans l’efprit de nitre étendu
avec deux tiers d’eau, la diffolution qui commence
par s’ en faire , fe trouve rouge dans les .
premiers momens -, il faut au contraire la laiffer
agir pendant quelques jours, afin qu elle prenne
cette couleur , en la mettant par intervalles fur
les cendres chaudes,* ce n’eft qu’après ce temps
que la diffolution devient claire & d’ un beau
rouge; alors on la décante en prenant garde qu’il
ne s’y mêle rien de ce qui refte au fond du vafe ;
& on v e r fe , fur ce réfidu , de l’eau & un peu de
nouvel efprit de nitre que l’on fait digérer par-
deffus, comme on a fait la première fois , pour
tirer encore de la teinture rouge.
n On met toutes ces teintures rouges dans '
» une taffe de porcelaine d e là Chine-, & l ’on
» y joint alors, comme a fait M. H e llo t, fur
» 6 gros de teinture rouge 1 gros & demi de
» fel marin , le plus blanc & le meilleur qu’ on
v puiffe trouver ; on agite le fel marin, avec
» un tuyau ou une lame de verre, afin qu’ il
» fe diffolve; on laiffe repofer le tout pendant
» quelque temps y on décante la liqueur claire,
» &: on jette ce qui a pu refter au fond* On
» remet la liqueur dans la taffe de porcelaine
E M A "
» fur des cendres trèr-jhaudes ; 8c s’ il fe fait
» après quelques heures d’évaporation un peu
» de dépôt au fond , on a grand foin de dé-
» canter encore la diffolution pour jetter le
» dépôt qui a pu s’ y faire.
» Lorfque l’évaporation eft avancée au point
» que la diffolution commence à s’èpaiffir,
» elle forme des cercles verds fur la taffe à
» fa furface; fi le cobalt eft d’une médiocre
» qualité, cette couleur, verte fe comhiu nique
» à toute la diffolution à inclure qu’elle s’é-
» paiflit; c’eft alors qu’ il faut remuer le tout
» avec une lame de cryftal ou de verre , de
» peur que la çompofition ne s’attache au fond
» de la taffe; cè verd fe change bientôt: en
>? rouge , 8c le rouge en bleu.
" » Si le cobalt eft de la meilleure qualité ,
» tel que celui qui vient d’Efpagne, la cou-
-» leur verte ne paroît point d’abord, non plus
•» que la rouge ; mais la diffolution en s’épaif*
y fiffant, paffe tout d’un conp à la couleur
» bleue , la plus forte. On continue de remuer
» avec la plus grande attention, en détachant
» tout ce qui tient au fond de la taffe, jufqu’à
» ce que la çompofition fe foit formée en un
» fel grené d’ un beau bleu. Alors les vapeurs
» nitreufes forçant du fel en grande quantité,
» il eft à propos de s’en garantir en faifanc
» l’opération fous une cheminée. On continue
» de renir le fel fur le feu , & de le remuer
» jufqu’à ce qu’il devienne prefque fec ( car
» il ne faut pas qu’ il foit totalement privé'
» d’humidité), c’eft-à-dire, il faut qu’ il n’ex -.
» haie prefque plus de vapeurs nitreufes. I l
» ne faut pas preffer le feu , fur-tout vers la
» fin de l’évaporation,
» Après que l’on a laiffé le fel fur les cendres
» chaudes pendant une ou deux heures, on
» retire la taffe , & on l’expofe à l’air libre ;
» le fel y prend un peu d’humidité & une t?e-
» tite teinte de rouge qui augmente tous les
■n»: jours , jufqu’à le faire devenir prefque cra-
» moifi ; alors on remet la taffe fur les cendres
» chaudes. Le fel reprend la couleur bleue
» aufii-tôt que la chaleur s’y fait fentir. SI
» l ’on porte la taffe au nez, on s’apperçoic
» qu’ il s’exhale encore des vapeurs nitreufes ;
» on remue le fel avec la lame de verre ; fans
» cela , il fe mectroit en grumeaux : on 1«
.» tient ainfi à une petite chaleur pendant un«
» heure*, après quoi, un retire la taffe, & on
t> l ’expofe à l’air de nouveau pendant quelques
» jours. L’humidité revient , & la couleur
» rouge reparoît, mais plus lentement, & en
» moindre quantité. On continue d?obferver
» Ja même manoeuvre pendant un mois ou fix
» femaines, en expofant le fel alternativement
» fur les cendres chaudes, & enluite à l’air
» froid ; pendant ce temps on s’apperçoit que
» l’ exhalaifon des vapeurs nitreufes fe fait moins