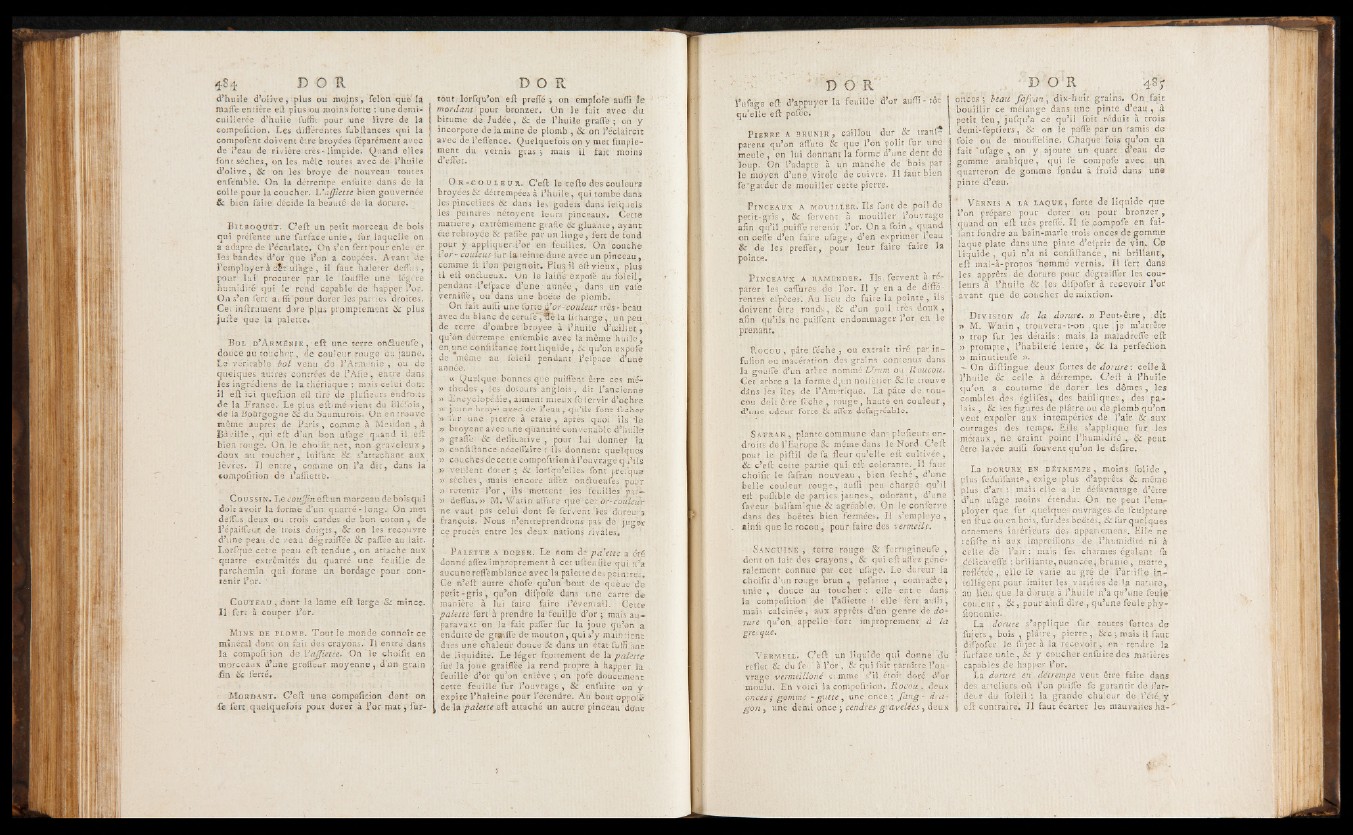
d’huile d’o liv e , plus ou moins, félon que là
lîiafte entière eft plus ou moins forte : une demi-
cuillerée d’huilë fuffit pour une livré de là
eompofition. Les différentes fubftances qui la
compofenc doivent être broyées féparément avec
de l’eau de rivière très-limpide. Quand elles
font sèches, on les mêle toutes avec de l ’huile
d’o liv e , de on les broyé de nouveau toutes
enfémble. On la détrempe enfuite dans de la
colle pour la coucher. L’ aJJiettc bien gouvernée
& bien faite décide la beauté de la dorure.
Bilboquet. C’eft un petit morceau de bois
qui prêfente une furface unie, fur laquelle on
a adapté de l’écarlate. On s’en fert'pour en le er
les bandes d’or que l’on a coupées. Avant de
l’employer à élit ufage , il faut haleter deflus,
pour lui procurer par le foiiffle une légère
humidité qui le rend capable de happer l’or.
On s’ en fert aufli'pour dorer les parties droites.
Cet infiniment dore 'plus promptement & plus
jufte que la palette.
Bol .d’Arménie , eft une terre on&ueufe,
douce au toucher , de couleur rouge ou jaune.
Le véritable venu de l’Arménie, ou de
quelques autres contrées de l ’Aile^ entre dans
les ingrédiens de la thériaque : mais celui dont
il eft ici queftion eft tiré de plufieurs endroits
de la France. Le plus eftimé vient du Bléfoîs,
dé la Bourgogne & du Saumurois. On en trouve
même auprès de Paris, comme à Meudon , à
Bàville , qui eft d’un bon ufage quand il eft
bien ronge. On le choifit net, non graveleux ,
doux au toucher, luifant 8c s’attachant aux
lèvres. Il entre, comme on l’ a d it, dans la
eompofition dé i’afîietté.
Coussin. Le coiifjineûun morceau deboisqui
doit ay-oir la forme d’un: quarré - long. On met
deftus deux ou trois cardes de bon coton , de
l ’épaiflèur. de trois doigts, & on les recouvre
d’ une peau .de veau dégraiffée. & paffée au lait.
Lorfque cetre peau eft tendue , on attache aux
quatre extrémités du quarré une feuille de
parchemin qui forme un bordage pour contenir
l’or. ’
Couteau ,; dont la lame eft large 8c mince.
I l fert à couper l’or.
Mine de plomb. Tout le monde connoît ce
minéral dont on fait des crayons. IL entre dans
la eompofition de 1 fajjzette. On le choifit en
morceaux d’une groflèur moyenne, d’un grain
fin & ferré.:;
Mordant. C’eft une eompofition dont on
fe 1ère, quelquefois pour dorer à l’or mat, furtout
lorfqu’on eft preffé -, on emploie suffi îe.
mordant pour bronzer. On le fait avec du
bitunie de Judée, 8c de l’huile g rafle ; on y
incorpore de la mine de plomb , 8c on l’éclaircic
avec de l’eflence. Quelquefois on y met Amplement
du vernis gras ; mais il fait moins
d’ effet.
O r - c o u l e u r . C’eft le reft© des couleurs
broyées & détrempées à l ’huile, qui tombé dans
les pinceliers & dans les godets dans lelquels
les peintres nétoyent leurs pinceaux. Cette
matière, extrêmement grade 8c gluante, ayant
été rebroyée 8c paffée par un lin g e , lért de fond
pour y appliquer-l’ or en feuilles. On couche
Vor-couleur i'\ir la teinte dure avec un pinceau,
comme li l’on peignoir. Plus. il eft vieux, plus
il eft onélueux. Un le laifte expofé au foie il,
pendant l ’efjpace d’une: année , dans .un val'e
vernidé, ou dans -une boëte de plomb.
On fait aufli une forte^or-couleur très - beau
avec du blanc de céruieyrle la lie barge , tun peu
de terre d’ombre broyée à fihuiie d’oeilï.et,
qu’on détrempe enlëmble avec la même huile ,
en.une confiftance fortliquide, & qu?ron expofe
de même au foleil pendant. l’el’pace d’unè
année. ;•
« Quelque bonnes que puifferit être çes me-
» thodes , les doreurs an g lois , dit f ancienne
» -Encyclopédie, aiment mieux fe fer vit d’ochre
» jaune broyé avec de l’ eau, qu’ils font fechèr
>> fur une pierre à craie , après quoi ils le
» broyenc avec une qîrantiré convenable d’hùile
» gradé & deflicativé , pour lui donner la
-» confiftance néceflaire : ils donnent quelques
» couches de cette eompofition à l’ouvrage qu’ ils
» veulent dorer •; & lorfqu’elles font preique
» sèches, mais encore allez- onétueufes pour
retenir l’o r , ils mettent les feuilles par—
» deffus.» M. Watin affure que cet àr-coiiieiir
ne vaut pas celui dont fe fer vent.les doreurs
françois. Nous n’entreprendrons pas de jugér
ce,procès entre les deux nations rivales.
Palette a dorer. Le p.om ds palette a été
donné afféz improprement à cet uftentjle qui n’a
aucune reffemblance avec la palette des peintres.
Ce n’ eft autre chofe qu’un bout de queue de
petit-gris -, qu’on difpofe dans une carte': de
manière à lui faire faire l ’éventail. Cette
palette fert' à* prendre la feuille d’o r ; mais auparavant
on la fait pad’er fur la joue qu’on a
enduite de graille de mouton, qui s’y maintient
dans une chaleiîr douce & dans un état lufffânc
de liquidité. Le léger flottement de la palette
fut' la joue graiffée la rend propre à happer la
feuille d’or qu’on enlève ; on pôle doucement
cette feuille fur l’ouvrage , & enfuite on y
expire l’haleine pour l’étendre. Au bout oppolc
, de la palette eft attaché un autre pinceau detor
eft d’appuyer la feuille d’or aufli - tôt
qu’elle eft pofée.
P ierre a brunir, caillou dur & trahir
parent qu’on adute 8c que l’on polit fur une
meule , en lui donnant la forme d’une dent de f
loup. Qn l’adapte à un manche de bois par
le moyen d’une virole de cuivre. Il faut bien
fe’ garder de mouiller cette pierre.
Pinceaux a mouiller. Ils font de poil de
petit-gris, 8c fervent à mouiller l’ouvrage
afin qu’il .puiffe retenir l’ or. On a foin , quand
on celle d’ en faire ufage | d’ erf exprimer l’eau
& de les preffer, pour leur faire ’faire la
pointe.
Pinceaux , a ramender. Ils, fervent a ré- j
parer les eaffures.ffe l’or. I l y en a de différentesespèces'.
Au lieu de faire la pointe, ils
doivent être ronds, & d’ un poil très, doux ,
afin qu’ ils ne.puiffent endommager l’or en le
prenant.
Kqcôu,, pâte, féchè , ou extrait tiré par in-
fufion ou macération des grains contenus dans
la gouffe d’ un arbre nommé U mm ou îloucou.
Cet arbre a la forme d{un noil'etier &.fe trouve
dtfns les îles de l’ Amérique. La pâte de rou-
cou doit être lèche , -rouge , haute en couleur ,
d’une odeur forte & affez défagréable.
S a f r a n , plante commune dan** pi ufieurs endroits
de l’Europe & même dans le Nord- C’eft
pour le piftil de fa fleur qu’elle eft cultivée,
& c’ eft cette partie qui eft colorante.^îî faut
choifir le fafran nouveau , bien feché , d’une
belle couleur rouge, aufli peu chargé qu’ il
elt poflible de parties jaunes, odorant, d’une
faveur bâlfam’que 8c agréable'. On le conferve
dans des boëtes bien'fermées. Il s’employe ,
âinfi que le rocou , pour faire des vermeils.
- Sa n g u in e , terre rouge & ferrugineufe ,
dont on fait des crayons, & qui eft affez généralement
connue par cet ufage. Le doreur la
choifit d’un rouge brun , pefanre , compacte ,
unie , douce au toucher : elle entre dans
la eompofition de. l’ affiette : elle fert aufli,
mais calcinée, aux apprêts d’un genre de dorure
qu’on, appelle fore improprement à la
grecque.
V ermeil. C’eft un liquide qui donne du
reflet & du fer à l’or , 8c qui fait paroître l’ouvragé
vermeillàné ct.moie s’ il ctoit doré d’or
moulu. En voici la eompofition. Rocou ., deux
onces ; gomme - gutte , une once,; fa n g - dragon
, une demi once ; cendres graveUes, deux
onces ; beau fafran \ dix-huit grains. On fait
bouillir ce mélange dans une pinte d’eau , à
petit, fe u , jufqu’à ce qu’ il foit réduit à trois
demi'feptiers, & on le paffe par un tamis de
foie ou de mouffeline. Chaque fois qu’on en
fait ‘ ufage , oh y ajoute un quarc d’ eau de
gomme arabique, qui fe compofe avec un
quarteron de gomme fondu à froid dans une
pinte d ’eau.
* Vernis a la laque, forte de liquide que
l’on prépare pour dorer., ou pour bronzer,
quand on eft très preffé. Il fe.,compofe en fai-
fa nt fondre au bain-marie trois onces de gomme
laque plate dans une pinte d’elprit de vin. Ce
liquide, qui n’a ni confiftance, ni brillant,
eft maî-à-propos "nommé vernis. Il fert dans
les apprêts de dorure pour dégraiffer les couleurs
à l’huile & les difpofer à recevoir l’or
avant que de coucher de mixtion.
Division de la dorure. » Peut-être, die
» M. Watîn , trouvera-t-on que J e m’arrête
» trop fur les détails; mais la înaladreffe eft
» prompte, l’habileté lente, 8c la perfedion
» minutieufe >j.
On diftingue deux fortes de dorure : celle à
l’huile 8c celle à détrempe. C’ eft à l’huile
qu’ on a coutume de dorer les dômes, les
comblés des églifes, des bafiliques, des palais
, & les figures de plâtre ou derplomb qu’on
veut.expoler aux intempéries de l’air 8c aux
outrages des temps. Elle, s’applique; fur. les
métaux, ne craint point l’humidité , & peut
être lavée aufli fouvent qu’on le délire.
La DORURE. EN DÉTREMPE , moins folide ,
plus feduilante, exige:plus d’apprêts & même
plus d’ art ; mais elle, --a le défavantage d’ être
d’un ufage moins étendu. On ne peut l’emr
, ployer que fur quelques ouvrages de fculpture
en fiuc ou en bois., fur des boetes, 8c fur quelques
ornemens inférieurs des ap par terne ns. Elle nè
refifte ni aux impreflions d e l ’humidité ni à
celle dé l ’air: mais fés charmes égalent fa
délicateffe : brillante,nuancée;,brunie , matte,
reflétée elle lé varie au gré de l’àrtifte intelligent
pour imiter les variétés de la nature,
,aû lieu que ;la dorure à l’huile n’a qu’ une feule
1 couleur , pour ainfi dire , qu’une feulephy-
fiononiie.
La dorure s’applique .fur toutes fortes de
fujers , bois , plâtre, pierre , & c ; mais il faut
difpofer le.fujët à la recevoir, en rendre la
furface unie , 8c y coucher enfuite des matières
capables de happer l’or.
La dorure ens détrempe veut être faite dans
des arteliers où l’ on puiffe fe garantir de i’ar-
deur du foleil : la grande chaleur de .l’ cté, y
eft contraire. I l faut écarter les mauvaiies ha