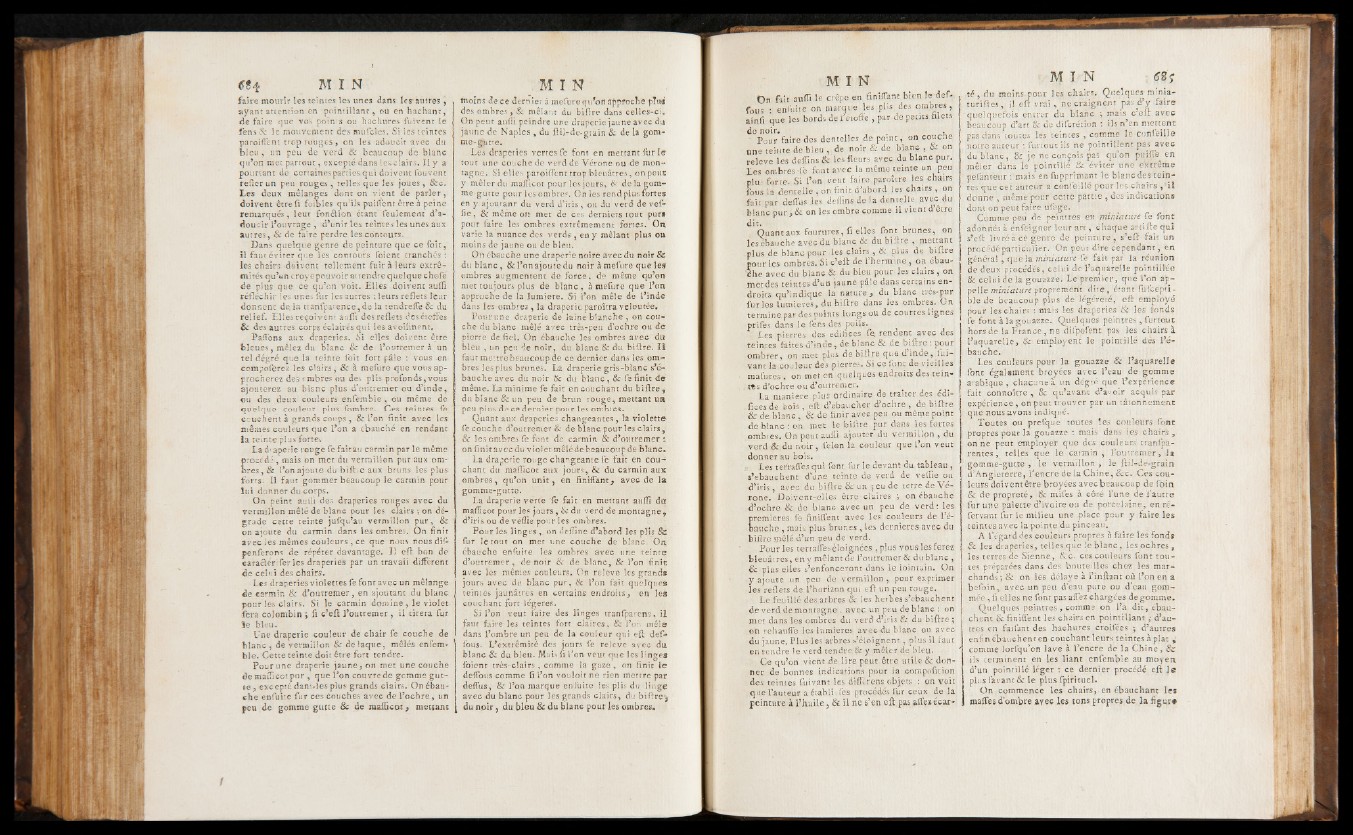
faire mourir les teintes les-unes dans les-autres ,
ayant attention en pointi-llant, ou en hachant,
Refaire que vos points ou hachures fuïvent le
iens & le mouvement des mule les. Si ies teintes
paroiflent trop rouges» on les adoucit avec du
bleu , un peu de verd & beaucoup de blanc
qu’on met partout, excepté dans tes clairs. Il y a
pourtant de certaines parties qui doivent fouvent
relier un. peu rouges , telles que les joues, & c.
Les deux mélanges dont on vient dè parler,
doivent être fi foibîes qu’ils puiflent être à peine
remarqués, leur fonction étant feulement d’adoucir
l’ouvrage , d’ unir les teintes les unes aux
autres, & de faire perdre les contours.
Dans quelque genre de peinture que ce loit,
il faut éviter que les contours foient tranchés :
les chairs .doivent tellement fuira leurs extrémités
qu’en croyepouvoir attendre quelque chefe
de plus que ce qu’on voit. Elles doivent auffi
réfléchir les unes fur les autres ; leurs reflets leur
donnent de.la tranfparence,de la tendrefle 8c du
relief. Elles reçoivent aufïi des reflets des étoffes
& des autres corps éclairés qui les avoiîinent,
Paffons aux draperies. Si elles doivent être
bleues, mêlez du blanc & de l’outremer à un
tel degré que la teinte foit fort pâle : vous .en
compoferez les clairs, & à mefure que vous approcherez
des ombres ou des plis profonds,vous
ajouterez au blanc plus d’outremer ou d’inde,
ou des deux couleurs enfemble , ou même de
quelque couleur plus fotnbre. Ces teintes fe
couchent à grands coups , & l’on finit _avec les
mêmes couleurs que l ’on a ébauché en rendant
la teinte plus forte-.
La dîaperie rouge fe faitau carmin par le même
procédé, mais on met du vermillon pur aux ombres,
& l’on ajoute du bift;c aux bruns les plus
forts. Il faut gommer beaucoup le carmin pour
lui donner du corps.
On peint auili des draperies rouges avec du
Vermillon mêlé de blanc pour les clairs -, on dégrade
cette teinte jufqu’au vermillon pur, &
on ajoute du carmin dans les ombres. On finit
avec les mêmes couleurs , ce que nous nous difi-
penferons de répéter davantage. Il eft bon de
caractérfer les draperies par un travail différent
de celui des chairs.
Les draperies violettes fe font avec un mélange
de carmin 8c d’outremer, en ajoutant du blanc
pour les clairs. Si le carmin domine , le violet,
fera colombin j fi c’efl l’outremer, il tirera fur 3e bleu.
L'ne draperie couleur de chair fe couche de
blanc , de vermillon 8c de laque, mêlés enfem* 1
ble. Cette teinte doit être fort tendre.
Pour une draperie jaune» on met une couche
de maificot pur , que l'on couvre de gemme gut-
te» excepté dansées plus grands clairs. On ébauche
enfuite fur ces couches avec de l’ochre, un
peu de gomme gutte 8c de maificot; mettant
moins de ce dernier à mefure quTon approché pF.i*
des ombres» & mêlant du biflre dans celles-ci.
On peut aufil peindre une draperie jaune avec du
jaune de Naples , du flii-de-grain & de la gomme
gutte.
Les draperies vertes fe font en mettant fur le
tout une couche de verd de Vérone ou de montagne.
Si elles paroiflent trop bleuâtres, on peut
y mêler du mafficot pour les jours, 8c delagom-
me gutte pour les ombres. On les rend plus fortes
en y ajouranr du verd d’iris , ou du verd de vef-
fie , & même on met de ces derniers tout pur»
pour faire les ombres extrêmement fortes. On
varie la nuance des verds , en y mêlant plus ou
moins de jaune ou de bleu.
On ébauche une draperie noire avec du noir &
du blanc, & l’on ajoute du noir à mefure que les
ombres augmentent de force, de même qu’on
met toujours plus de blanc., à mefure que l’on
approche de la lumière. Si l’on mêle de l’ inde
dans les ombres , la draperie paroîtra veloutée.
Pour une draperie de laine blanche , on couche
du blanc mêlé avec très-peu d’ochre ou de
pierre de fiel. On ébauche les ombres avec du
bleu , un peu de noir, du blanc & du biflre] I l
faut mettre beaucoup de ce dernier dans les ombres
les plus brunes. La draperie gris-blanc s’ébauche
avec du noir & du blanc, & fe finit de
même. La minime fe fait en couchant du biflre ,
du blanc & un peu de brun rouge, mettant un
peu plus de ce dernier pour les ombres.
Quant aux draperies changeantes, la violette
fe couche d’outremer & de blanc, pour les clairs,
& les ombres fe font de carmin & d’outremer t
on finitavec dii violet mêléde beaucoup de blanc.
La draperie rouge changeante fe fait en couchant
du mafficot aux jours, & du carmin aux
ombres, qu’on unit, en finiflant, avec de la
gomme-gutte.
La draperie verte fe fait en mettant aufïi dût
mafficot pour les jours, & du verd de montagne ,
d’iris ou de véflie pour les ombres.
Pour les linges , on deffine d’abord les plis &
fur le tout on met une couche de blanc On
ébauche enfuite les ombres avec une teinte
d’outremer, de noir & de blanc, & l’on finit
avec les mêmes couleurs. On releve les grand*
jours avec du blanc pur, 8c l’on fait quelques
teintes jaunâtres en certains endroits» en les
couchant fort légères.
Si l ’on veut faire des linges tranfparens, il
faut faire les teintes fort claires. & l’ on mêle
dans l ’ombre un peu de la couleur qui efl défi*
Tous. L’ extrémité des jours fe releve avec du
blanc & du bleu. Mais fi l’on veut que les linges
foient très-clairs , comme la g aze, on finit le
deflbus comme fi l’on vouloit ne rien mettre par
deflus, & l’on marque enfuite lés plis du linge
avec du blanc pour les grands clairs, du biflre1*
du n oir , du bleu 8c du blanc pour les ombres«
On fait auffi le crêpe en finiflant bien le défi-,
fous • enfuite on marque les plis des ombres,
ainfi que les bords de l'étoffé , par de petits filets
de noir. , ,
' Pour faire des dentelles de point, on couene
une teinte de bleu , de noir &. de blanc , & on
releve les deffins 8c ies fleurs avec du blanc pur.
Les ombres -fie font avec la même teinte un peu
plus forte. Si l’on veut faire paroîire les chairs
fous la dentelle , on finit d’abord ies chairs , on
fait par deflus les deffins de la dentelle avec du
blanc pur »& on les ombre comme il vient d être
dit. .
Quant aux fourures, fi elles font brunes, on
les ébauche avec du blanc 8c du biflre , mettant
plus de blanc pour les cla irs , 8c plus de biflre
our les ombres. Si c’efl de l’hermine., on ébau-
he avec du blanc & du bleu pour les clairs , on
met des teintes d’ un jaune pâte dans certains endroits
qu’ indique la nature» du blanc très-pur
furies lumières» du biflre dans les ombres. On
termine par des points longs ou de courtes lignes
prifes dans le fie ns des poils.
Les pierres des édifices fe rendent avec des
teintes faites d’ inde, de blanc 8c de biflre : pour
ombrer, on met plus de biflre que d Inde, lui-
vanc la couleur des pierres. Si ce font de vieilles
mafia res , on met en quelques endroits des teintas
d'ochre ou d’outremer.
La maniéré plus ordinaire de traiter des édifices
de bois, eil d’ ébaucher d’ochre , de biflre
& de blanc , 8c de finir avec peu ou même point
de blanc : on met le biflre pur dans les fortes
ombies. On peut auffi ajouter du vermillon , du
verd & du noir , iélen la couleur que l’on veut
donner au bois.
Les tefrafles qui font fur le devant du tabjeau ,
s’ébauchent d’une teinte de verd de veffie ou
d’ iris, avec du biflre & un peu de terre de Vérone.
Doivent-elles être claires -, on ébauche
d’ochre 8c de blanc avec un peu de .verd : les
remieres fe finiflent avec les couleurs de l ’e-
auche, mais plus brunes , les dernieres avec du
biflre mêlé d’un peu de verd.
Pour les terraifes éloignées , plus vous les ferez
bleuâtres, en y mêlant de l’outremer & du blanc ,
& plus elles s’enfonceront dans le lointain. On
y ajoute un peu de vermillon, pour exprimer
les reflets de l’horizon qui efl un peu rouge.
Le feuille des arbres 8c les herbes s’ébauchent
de verd de montagne . avec un peu de blanc : on
met dans les ombres du verd d’iris 8c du biflre ;
on rehaufle les lumières avec du blanc ou avec
du jaune. Plus les arbres s’éloignent , plus il faut
en rendre le verd tendre & y mêler de bleu.
Ce qu’on vient de lire peut être utile & donner
de bonnes indications pour ia compofition
des teintes fuivant les diffère ns objets : on voit
que l’auteur a établi fies procédés lur ceux de la
peinture à l’huile, & il ne s’en efl.pas afleiécarté
, du moins pour les chairs* Quelques minia-
t u r ifle s , il efl vrai , ne craignent pas d’ y faire
quelquefois entrer du blanc ; mais c’efl: avec
beaucoup d’ art & de diferétion : ils n’en mettent
pas dans toutes les teintes , comme le con fe ille
notre auteur : furtout ils ne pointilient pas avec
du blanc, & je ne conçois pas qu’on puiffe en
mêler dans le pointillé & éviter une extrême
pelântenr : mais en fupprimant le blanc des teintes
que cet auteur a confeille pour les chairs , il
donne , même pour cette partie , des indications
dont on peut faire ufage.
Comme peu de peintres en miniature fe font
adonnés à enfeigner leur a r t, chaque artifle qui
s’efl livré a. cé genre de peinture, s’efl fait un
procédé particulier. On peur dire cependant, en
général , que la miniature fe fait par la réunion
de deux procédés, celui de l’ aquarelle pointillée
& celui de la gouazze. Le premier, que l’on appelle
miniature proprement dire, étant fufeepti-
bie de beaucoup plus de légèreté, efl employé
pour les chairs : mais les draperies & les fonds
fe font à la gouazze. Quelques peintres , furtout
horsde la France, ne dilppfent pas les chairs à
l’aquarelle, 8c employent le pointillé: dés l ’ébauche.
Les couleurs pour la gouazze & l’aquarelle
font également broyées avec l’ eau de gomme
arabique, chacune à un degré que l’expérience
fait connoître , & qu’avant d’avoir acquis par
expérience, on peut trouver par un tâtonnement
que nous avons indiqué.
Toutes ou prefque toutes les couleurs font
propres pour la gouazze : mais dans les chairs ,
on ne peut employer que des couleurs tranfpa-
rêntes , telles que le carmin, l’outremer, Ja
gomme-gutte , le vermillon , le flii-de-grain
d’Angleterre, l’encre de ia Chine, & c . Ces couleurs
doivent être broyées avec beaucoup de foin
8c de propreté, & miles à côté l’une de l ’autre
fur une palette d’ ivoire ou de porcelaine, en re-
fervant fur le milieu une place pour y ,faire les
teintes avec la pointe du pinceau.
A l’égard des couleurs propres à faire les fond*
& les draperies, telles que le blanc, les ochres ,
les terres de Sienne, & c . ces couleurs font toutes
préparées dans des bouteilles chez les marchands
-, & on les délaye à l’ inftant où l’on en a
befoin, avec un peu d’eau pure ou d’eau gommée
, fi elles ne font pas allez chargées dégommé.
Quelques peintres , comme on l’a d it, ébauchent
8c finiflent les chairs en pointillant ; d’autres
en faifant des hachures croifées ; d’autres
enfin ébauchent en couchant leurs teintes à plat ,
comme lorfqu’on lave à l’encre de la Chine, &
ils terminent en les liant enfemble au moyen
d’un pointillé léger : ce dernier procédé efl le
plus favant & le plus fpirituel.
On commence les chairs, en ébauchant le*
maffes d’ombre avec les tons propres de la figure