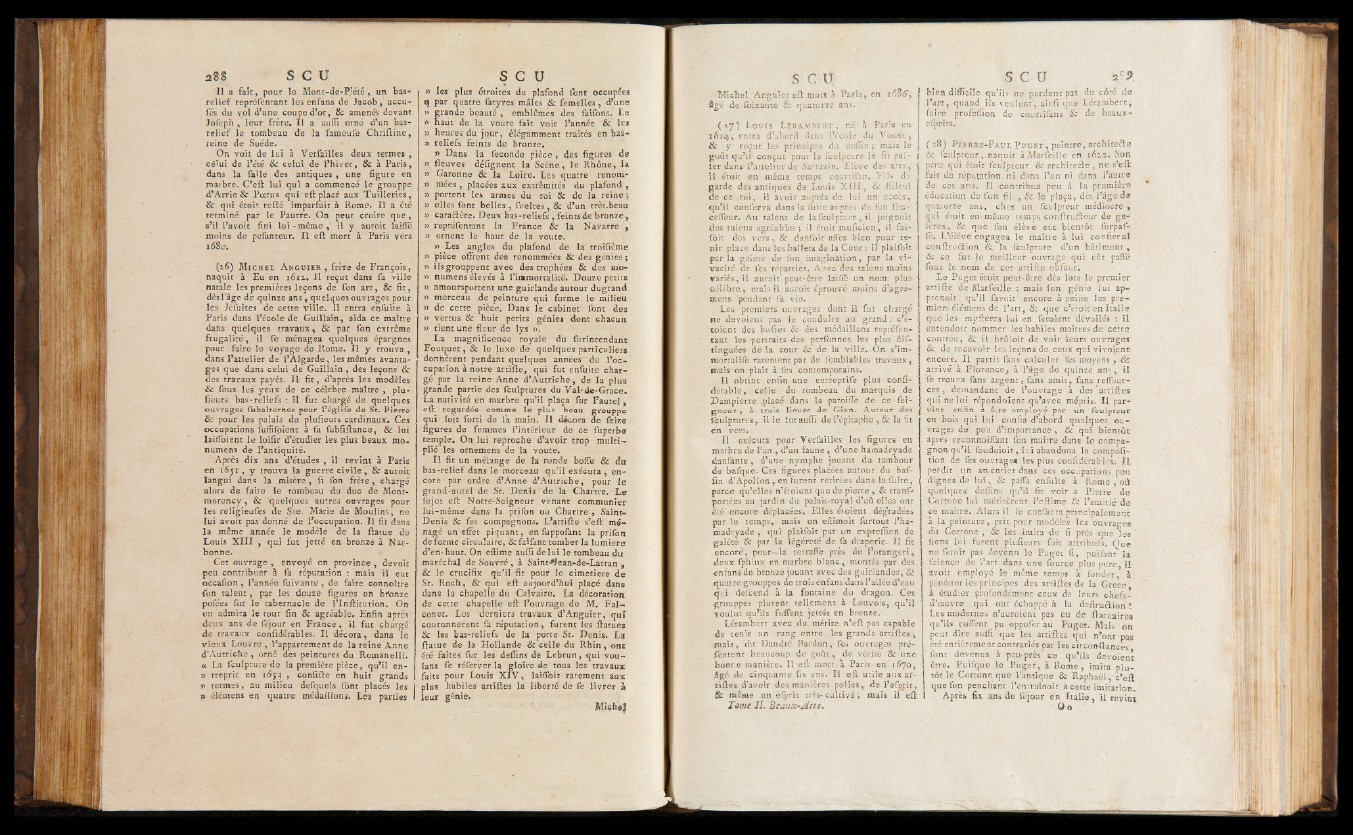
I l a fait, pour le Mont-de-Pjété, un tas -
re lie f reprélenrant les enfans de Jacob, accu-
fés du vol d’une coupe d’or, & amenés devant
Jofeph , leur frère. I l a aufli orné d’ un bas-
relief le tombeau de la fameule Chriftine,
reine de Suède.
On voit de lui à Verfailles deux termes ,
célui de l’été & celui de l’hiver, & à Paris,
dans la fallë des antiques , une figure en
marbre. C’eft lui qui a commencé le grouppe
d’Arrie & Poetus qui eft placé aux Tuilleries,
& qui étoit relié imparfait à Rome. Il a été
terminé par le Pautre. On peut croire q ue ,
s’ il l’avoit fini lui - même ,v il y auroit laifle
moins de pefanteur. I l e il mort à Paris vers
1680.
• » les plus étroites du plafond font occupées
«5 par quatre fatyres mâles & femelles, d’une
» grande beauté , emblèmes des faifons. Le
û haut de la voûte fait voir l’année & les
» heures du jour, élégamment traités en bas-
» reliefs feints de bronze,
(26) Michel Anguier , frère de François,
naquit à Eu en 1612. 11 reçut dans fa v ille
natale les premières leçons de fon art, & fit,
dès l’âge de quinze ans, quelques ouvrages pour i
les Jéfuites de cette v ille . Il entra enfuite à ]
Paris dans l ’école de Guillain, aida ce maître
dans quelques travaux, & par fon extrême
frugalité, il fe ménagea quelques épargnes
pour faire le voyage de Rome. I l y trouva ,
dans l’ attelier de l ’A lg a rd e , les mêmes avantages
que dans celui de Guillain, des leçons &
des travaux payés. I l f it , d’après les modèles
& fous le s'yeux de ce célébré maître , plu-
fieurs bas-reliefs : il fut chargé de quelques
ouvrages fubalternes pour l’églife de St. Pierre
8c pour les palais de plufieurs cardinaux. Ces
occupations fuffifoient à fa fubfiftance, & lui
laiffoient le loifir d’étudier les plus beaux mo-
numens de l’ antiquité.
Après dix ans d’études , il revint à Paris
en 1651 , y trouva la guerre civile , & auroit
langui dans la misère, fi fon frère, chargé
alors de faire le tombeau du duc de Montmorency
, & quelques autres ouvrages pour
les religieufes de S te. Marie de Moulins, ne
lui avoir pas donné de l’occupation. Il fit dans
la même année le modèle de la ftatue de
Louis X I I I , qui fut jetté en bronze à Narbonne.
Cet ouvrage , envoyé en province , devoit
peu contribuer à fa réputation : mais il eut
occafion , l’année fuivante, de faire connoître -
fon talent, par les douze figures en bronze
pofées fur le tabernacle de l ’ Inftitution. Oh
en admira le tour fin & agréable. Enfin après'
deux ans de féjour en France, il fut chargé
de travaux confidérables. Il décora, dans le
vieux Louvre , l’appartement de la reine Anne
d’Autriche, orné des peintures du Romanelli.
« La fculprure de la première pièce, qu’ il en-
» treprit en 1653 , confifte en huit grands
y» termes, au milieu defquels font placés les j
r. élémens en quatre médaillons. Les parties I
» Dans la fécondé pièce , des figures de
» fleuves défignent la Scène, le Rhône, la
» Garonne & la Loire. Les quatre renom-,
» mées, placées aux extrémités du plafond,
» portent les armes du roi & de la reine;
» elles font belles , fveltes , & d’un très.beau
» caraélère. Deux bas-reliefs, feints de bronze,
» repréfentant la France 8c la Navarre ,
» ornent le haut de la voûte.
» Les angles du plafond de la troifième
» pièce offrent des renommées & des génies ;
» ilsgrouppent avec des trophées & des mo-
» numens élevés à l’immortalité. Douze petits
» amoursportent une guirlande autour dugrand
,» morceau de peinture qui forme le milieu
» de cette pièce.- Dans le cabinet font des
» vertus & huit petits génies dont chacun
» tient une fleur de lys ».
La magnificence royale du furintendant
Fouquet, & le luxe de quelques particuliers
donnèrent pendant quelques années de l’occupation
à notre artifte, qui fut enfuite char-,
gé par la reine Anne d’Autriche, de la plus
grande partie des fculptures du Val-de-Grace.
La nativitéjsn marbre qu’il plaça fur l ’au tel,
eft regardée comme le plus beau grouppe
qui foit forti de 1a main. I l décora de feize
figures de femmes l’ intérieur de ce fuperba
temple. On lui reproche d’avoir trop multi-
plié les ornemens de la voutè.
I l fit un mélange de la ronde boffe & du
bas-relief dans le morceau qu’il exécuta , encore
par ordre d’Anne d’Autriche, pour le
grand-autel de St. Denis de la Chartre. Le
fujet eft Notre-Seigneur venant communier
lui-même dans la prifon ou Chartre , Saint-
Denis & fes compagnons. L’artifte s’eft ménagé
un effet piquant, en fuppofant la prifon
déforme circulaire, &faifant tomber la lumière
d’ en-haut. On eftime aufïi de lui le tombeau du
maréchal de Souvré , à Saint-*Jean-de-Latran ,
& le crucifix qu'il fit pour le cimetiere de
St. Roch, & qui eft aujourd’hui placé dans
dans la chapelle du Calvaire, La décoration
de cette chapelle eft l’ouvrage de M. F a l-
conet. Les derniers travaux d’Anguier, qui
couronnèrent fa réputation, furent les ftatues
& les bas-reliefs de la porte St. Denis. La
ftatue de la Hollande & celle du Rhin, ont
été faites fur les deflins de Lebrun , qui voulant
fe réferver la gloire de tous les travaux
faits pour Louis X IV , laiffoit rarement aux
plus habiles artiftes. la liberté de fe livrer à
leur génie.
Miçhe|
. Michel Anguier eft m or t-1 Paris, en 16S6)
âgé de foixante 8c quatorze ans.
( 2 7 ) Louis Lérambert, né à Paris en
16 14, entra d’abord dans l’école du Vouet,
& y reçut les principes du deffin ; mais le
goût qu’il conçut pour la fculpture le fit pal- l 1er dans l’aitejier de Sarrazin. Elève des arcs,
il étoit en même temps courtifan.-Fils du.
garde des antiques de Louis X III , & filleul
de ce roi, il avoit auprès de lui un accès,
qu’ il conferva dans la fuite auprès de fon fuc-
céflèur. Au talent de la fculpture, il joignent
des talens agréables; il étoit muficien, il fai-
foit des vers , & danfoit allez bien pour tenir
place dans les ballets de la Cour : il plaifoit
par la gaieté de fon imagination, par la vivacité
de fes réparties. Avec des talens moins
variés, il auroit peut-être î ai fie un nom plus
célèbre, mais il auroit éprouvé moins d’agré--
mens- pendant fa vie.
Les premiers ouvrages dont il fut chargé
ne dévoient pas le conduire au grand : c’é-
toient des bulles 8c des médaillons repréfentant
les portraits des perfonnes les plus dif-
tinguées de !a cour & de la ville. On s’ im-
morraltfe rarement par de femblables travaux,
mais on plaît à lès contemporains.
I l obtint. enfin une enrreprife plus confi-
dérable, celle du tombeau du marquis de
Dampierre qfiacé dans la paroifiè de ce fei-
gneur, à trois lieues de Gien. Auteur des
fculptures, il le futaufii de l’épitaphe , 8c la fit
en vers.
Il exécuta pour Verfailles les figures en
marbre de Pan , d’ un faune,. d’une hamadtyade
dan-ante, d’ une nymphe jouant du tambour
de bafque. Ces figures placées autour du baf-
fin d’Apollon , én furent retirées dans la fuite ,
parce qu’elles n’étoient que de pierre , 8c ttan-f-
portées au jardin du palais-royal d’où elles ont
été encore déplacées. Elles étoiènt dégradées
par le temps, mais on eftimoit furtout l’ha-
sn a dryade , qui plaifoit par un expreflion de
gaieté & par la légèreté de fa draperie. I l fit \
encore, pouf - la terrafiè près de l’orangeri, j
deux fphinx en marbre blanc, montés par des i
enfans de bronze jouant avec des guirlandes, &
quatre grouppes de trois enfans'dans l’allée d’eau
qui defeend à la fontaine du dragon. Ces
grouppes plurent tellement à Louvois, qu’ il
voulut qu’ ils fuflent jettés en bronze.
Lérambert av.ec du. mérite n’eft pas capable
de tenir un rang entre les grands artiftes ;
mais, dit Dandré Bardon, lès ouvrages pré-
fente nt beaucoup de goût, de vérité & une
_ bonne manière. Il eft mort à Paris e n '1670,
âge de cinquante fix ans. Il eft utile aux artiftes
d’avoir des manières polies , de l’efprit,
& même un éfprit très-cultivé; mais il eft
Tome II. Beaux*Arts,
bien difficile qu’ils ne perdent pas du-côté de
l ’art, quand ils veulent, ainfi que Lérambert,
faire profeftion de: counifaris 8c de beaux-
efprits.
(28) Pierre-Paul Puget, peintre, architecte
8c fculpteur, naquit à Marfèille en 1622. Son
père qui etoit fculpteur & architecte, ne s’eft
fait ,dë'réputation ni dans l’ un ni dans l’autre
de ces arts. Il contribua peu à la première
éducation dè Ton fil . , & le plaça, dès l’âge de
quatorze ans, chez un fculpteur médiocre ,
qui écoit en> même temps conftruéteur de ge-
lères, 8c que fon élève eut bientôt furpal-.
fé. L’éléve engagea le maître à lui confierai
confhru&ion & la^fculpture d’un bâtiment,
8c ce fut le meilleur ouvrage qui eût pafle
fous le nom de cet artifte obfcur.
Le Puget étoit peut-être dès lors le premier
artifte de Marfeille : mais l'on génie lui ap-
prenoic qu’ il .favoit encore à peine les premiers
élémens de l’ art, & que c’étoit en Italie
que les inyftères lui en feroient dévoilés : il
enter.doit nommer les habiles maîtres de cette
contrée, & il brûloir de voir leurs ouvrages
& de recevoir les leçons de ceux qui vivoient
encore. Il partit fans calculer fes moyens , &
arrivé à Florence, à l’âge de quinze ans, il
fe trouva fans argent, fans amis, fans reflour-
c e s , demandant de l’ouvrage à des artiftes
qui ne lui répondoient qu’avec mépris. Il parvint
enfin à ê re employé par un fculpteur
en bois qui lui confia d’abord quelques mu-?
vragés de peu d’importance , 8c qui bientôt
après rèconnoifiant fon maître dans le compagnon
qu’ il foudoioir, luiabandona la compofi-
tion de fes ouvrage« les plusmonfidérables. I l
perdit un an entier dans ces ;occaparions, peu
dignes de lu i, & pafia enfuite’ à Rome où
quelques deflins qu’ il fit voir à Pierre de
Cortone lui méritèrent l’eftime & l’amitié de
ce maître. Alors il fe confacra principalement
à la peinture, prit pour modèles les ouvrages
du Cortone , & les .imita de fi près ique les
liens lui furent plufieurs fois attribués. Que
ne feroit pas- devenn le Puget fi, ouifant ia
feiençe de l’art dans une fourcé plus pure, il
avoit employé le même temps à fonder, à
pénétrer les principes des artiftes de la Grece
à étudier profondément ceux de leurs chefs-
d’oeuvre qui ont échappé à la deftru&ion ?
Les modernes n’auroiént pas eu de ftatuaires
qu’ ils euflènt pu oppofer au Puget. Mais on
peut dire aufli que les artiftes qui n’ont pas
été entièrement contrariés par les circon-ftances
font devenus à peu-près ce qu’ ils dévoient
être. Puifque le Puget, à Rome, imita plutôt
le Cortone que l’antique & Raphaël, c’ell
que fon penchant l’ entraînoit à cette imitation.
Après fix ans de féjour en I ta lie , il revins
0 o