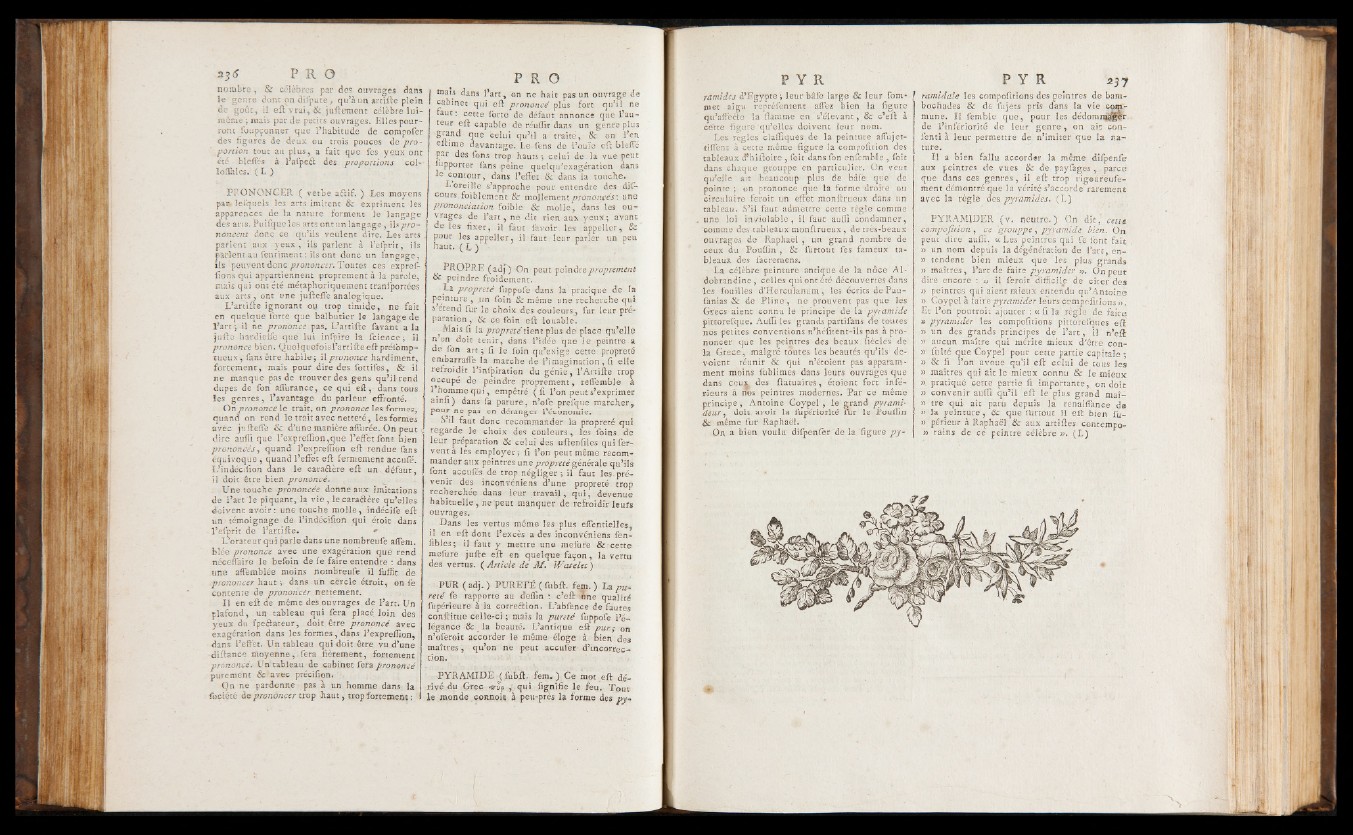
2 3 <î P R O
nombre , & célèbres par des. ouvrages dans
le genre dont on difpute , qu’ à un artifte plein
de goût, il eft vrai, & juftement célèbre lui-
même ; mais par de petits ouvrages. Elles pourront
ibupçonner que l’habitude de compofer
des figures ae deux ou trois pouces de proportion
tout au plus, a fait que fes yeux ont
été . b 1 elfes à l’afpect des proportions col--
îofEales. ( L )
PRONONCER ( verbe aétif. ) Les moyens
par- lefquels les arts imitent & expriment les
apparences de la nature forment- le langage
des ans. Puifqueles arts ont un langage,-ilsprononcent
donc ce qu’ils veulent dire. Les arts ,
parlent aux y e u x , ils parlent à l’efprit, ils
parlent au fentiment.: ils ont donc un langage,
ils peuvent donc prononcer. Toutes ces expref-
fions qui appartiennent proprement à la parole,
mais qui ont été métaphoriquement tranfportées
aux arts, ont une juftéffe analogique.
L’artifte ignorant ou trop timide, ne fait
en quelque forte que balbutier le langage de
l ’art ; il ne prononce pas. L’artifte favant a la
jufte hardieife que lui infpire la fcience ; il
prononce bien. Quelquefoisl’artifteeftprélomp-
tueux, fans être habile; il prononce hardiment,
fortement, mais pour dire des fottifes, & il
ne manque pas de trouver des gens qu’ il rend
dupes de fon aflurance, ce qui eft, dans tous,
les genres, l’avantage du parleur effronté.
On prononce le trait, on prononce les formes,
quand on rend le trait avec netteté, les formes
avec jnftefle 8c d’une manière affurée. On peut v
dire aufïi que l’expreffion,que l ’effet font bien
prononcés, quand l’expreffion eft rendue fans
équivoque , quand l’effet eft fermement accufé.
L’ indécifion dans le cara&ère eft un. défaut,
il doit être bien prononcé.
. Une touche prononcée donne aux imitations
de l’art le piquant, la v ie , lecara&ère qu’elles
doivent avoir : une touche m olle , indécife eft
un témoignage de l’ indécifion qui étoit dans
l ’efprit de l’artifte.
L’orateur qui parle dans une nombreufe affem.
bîée prononce avec une exagération que rend
néceffaire le befoin de fe faire entendre : dans
une affemblée moins nombreufe il fuffit de
prononcer haut ; dans un cercle étroit, on fe
contente de prononcer nettement.
I l en eft de même des ouvrages de l’art.Un
plafond, un tableau qui fera placé loin des
yeux du fpeéïateur, doit être prononcé avec
exagération dans les formes, dans l’expreffion,
dans l’effet. Un tableau qui doit: être vu d’une ..
diftance moyenne, . fera fièrement, fortement ;
prononcé. Un tableau de cabinet fera prononcé'
purement & avec précifion*
On ne pardonne pas à un homme dans la
fociété de prononcer trop haut, trop fortement :
P R O
mais dans l ’art, on ne hait pas un ouvrage de
cabinet qui eft prononcé plus fort qu’ il ne
faut: cette forte de défaut annonce que Hauteur
eft capable de réufïir dans un genre plus
£tand que celui qu’ il a traité, & on l ’en
eftime davantage. Le lèns de l’ouïe eft bleffé
par des fon s trop hauts*, celui de la vue peut
fupporter fans peine quelqu'exagération dans
le contour, dans l ’effet - 8c dans la touche.
L’oreille s’approche pour entendre des dif*
cours foiblemenc & mollement prononcés : une
prononciation foible & molle, dans les ouvrages
de l’a r t , ne dit rien aux yeux; aVant
de les fixer, il faut favoir. les . appell.er, &
pour les appeller, il faut leur parler un peu
haut. ( L ) •
PROPRE (ad j) On peut peindre proprement
& peindre froidement.
La propreté fuppofe dans la pratique de la
peinture , un foin & même une recherche qui
s étend fur le choix des couleurs, fur leur préparation
& ce foin eft louable.
Mais fi la propreté tient plus de place qu’elle
n en doit tenir, dans l’ idée que îe peintre a
de fon art ; fi le foin qu’exige cette propreté
embarrafîe la marche de l’ imagination, fl elle
refroidit l’ infpiration du génie, l’At'tifte trop
occupé de peindre proprement, reffemble à
l ’homme q u i, empêtré ( fi l’on peut s’exprimer
ainfi) dans fa parure, n’ofe prefque marcher,
Pour ne pas en déranger l ’économie.
S il faut donc recommander la propreté qui
regarde le choix des couleurs, les foins de
leur préparation & celui des uftenfiles qui fervent
à les employer; fi l’on peut même recommander
aux peintres une propreté générale qu’ ils
font accufés de trop négliger; il faut les.pré-
■ venir des inconvéniens d’une propreté trop
recherchée dans leur travail, q u i, devenue
habituelle , ne'peut manquer de refroidir leurs
ouvrages.
Dans les vertus même les plus effentielles
il en eft dont l’excès a des inconvéniens fen-
fibles; il faut y mettre une mefure & cette
mefure jufte eft en quelque façon, la vertu
des vertus. ( Article de M . Watelet) -.
PUR ( adj. ) PURETÉ ( fubft. fem. ) La pu*
reté fe rapporte au d'effin : c’eft âne qualité
fupérieure à la corre&ion. L’abfence de fautes
conftitue celle-ci ; mais la pureté fuppofe l ’élégance
& la beauté. L’antique eft pur,; on
n’oferoit accorder le même/éloge à bien des
maîtres, qu’on ne peut acculer d’incorrec-«
tion.
PYRAMIDE ( fubft. fem. ) Ce mot ,eft dérivé
du Grec fsrvp • qui fignîfie le feu. Tout
le monde connoit à peu-près la forme des »y-
P Y R
ramides d’Egypte ; leur bâfe large & leur Commet
aigu repréfentent affez bien la figure
qu’affeéte là flamme en s’élevant, & c’eft à
cette figure qu’elles doivent leur nom.
Les règles claffiques de la peinture affujet-
tiffent à cette même figure la compofition des
tableaux cfhiftoire , foit dans fon enfemble , l'oit
dans chaque grouppe en particulier. On veut
qu’elle ait beaucoup plus de bâfe que de
pointe ; on prononce que la forme droite ou
circulaire feroit un effet monftrueux dans un
tableau. S’ il faut admettre cette règle comme
, une loi inviolable, il faut aulfi condamner,
comme des tableaux monftrueux, de très-beaux
ouvrages de Raphaël , un grand nombre de
ceux du Pôulfin , & furtout fes fameux tableaux
des lac remens. •
La célèbre peinture antique de la noce Al-
dobrandine, celles qui ont été découvertes dans
les fouilles d’Herculanum, les écrits de Pau-
fanias & de Pline , ne prouvent pas que les
Grecs aient connu le principe de la pyramide
pittorefque. Aulfi les grands partifans de toutes
nos petites conventions n’héfitent-ils pas à prononcer
que les peintres des beaux, liècles de
la Grece, malgré toutes les beautés qu’ ils dévoient
réunir & qui n’étoient pas apparam-
ment moins fublimes dans leurs ouvrages que
dans ceux des ftatuaires, étoient fort inférieurs
à nos peintres modernes. Par ce même
principe, Antoine Coypel, le grand pyrami-
deiir, doit, avoir la fupériorité fur le Poulfin
8c même fur Raphaël.
On a bien voulu difpenlèr de la figure py-
P Y R 237
I ramidale les compofitions des peintres de bam-
bochades & de fujets pris dans la vie cçm-
mune. Il femble que, pour les dédomnjÿpîjph*
de l’ infériorité de leur g en re , on ait con-
fenti à leur permettre de n’ imiter que la nature.
Il a bien fallu accorder la même difpenle
aux peintres de vues & de payfages , . parce
que dans ces genres , il eft trop rigeureufe-
ment démontré que la vérité s’accorde rarement
avec la règle des pyramides, (L )
PYRAMIDER (v . neutre.) On di t ] cette
compofition, ce 'grouppe, pyramide bien. On
peut dire aufïi. « Les peintres qui fe l'ortt fait
» un nom depuis la dégénération de l’art, en-
» tendent bien mieux que les plus grands
» maîtres, l ’art de faire pyramider ». On peut
dire encore : u il feroit difficile de citer des
» peintres qui aient mieux entendu qu’Antoine
» Coypel à taire pyramider leurs compétitions ».
Et l’on pourroît ajouter : « fi la ,règle de faire
» pyramider .les compofitions pittofefiques eft
» un des grands principes de l’a r t, il n’eft
» aucun maître qui mérite mieux d'être con-
» fuite que Coypel pour cette partie capitale ;
» & fi l’on avoue qu’il eft celui de tous les
» maîtres qui ait le mieux connu & le mieux
». pratiqué cette partie fi importante, ondoie
» convenir aufïi qu’ il eft le plus grand maî-
» tre qui ait paru depuis la renaiflance de
» la peinturé, & que furtout il eft bien fu-
» périeur à Raphaël 8c aux artiftes contempo-
» rains de ce peintre célèbre ». (L )