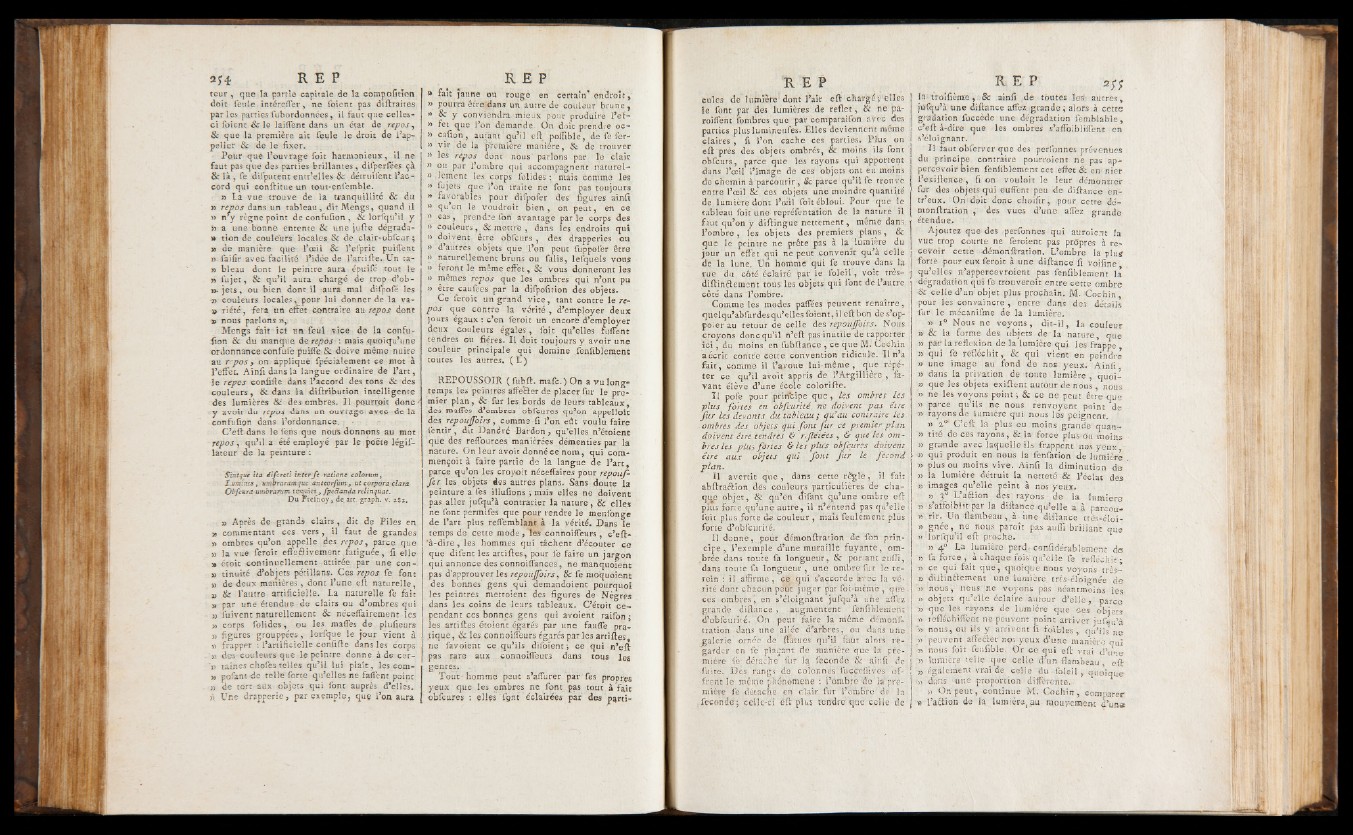
2 J 4 R E P
te u r , que îa partie capitale de la compofitïon
doit feule. intércffer, ne foienc pas diftraites
par les parties fubordonnées, il faut que celles-
c i foient & le laiffent dans un état de repos,
& que la première ait feule le droit de l ’appel
1er 8c de le fixer.
Pour que l’ouvrage foit harmonieux, il ne
faut pas que des parties brillantes , difperfées çà
& là , fe dil’putent entr’elles & détruilenc l ’a c cord
qui conftitue un tout-enfemble.
» La vue trouve de la tranquillité & du
» repos dans un tableau, dit Mengs, quand il
» n’y règne point de confufion , & lorfqu’ il y
» a une bonne entente & une jufte dégrada-
» tion de couleurs locales 8c de clair-obfcar ;
» de manière que l’oeil 8c l’efprit puilfent
» faifir avec facilite l’ idée de l’artifte.Un ta-
» bleau dont le peintre aura. épuifé tout le
» fu je t, & qu’ il aura chargé de trop d’ob-
>vjets, ou bien dont il aura mal dilpofé les
-» couleurs locales v pour lui donner de la va-
» riété, fera un effet contraire au repos dont
» nous parlons»,.
Mengs fait ic i un feul vice de la confufion
& du manque àerepàs-'. mais .quoiqu’ une
ordonnance confufe puiffe 8c doive même nuire
au rrpos, on appliqué; fpécialement ce mot à
l’ effet. Ainfi dans la langue ordinaire de l’ar t,
le repos confifte dans l’accord des tons 8c des
couleurs , &. dans la diftribution intelligente
des lumières 8c des: ombres. Il pourrait donc •
y avoir du repo y dans un ouvrageî avec de la
confufion dans l’ordonnance. >
C’eft dans le fens que nous donnons au mot'
repos, qu’ il a été employé par le poëte légif-
lateur de la peinture :
Sintqué ita difcreti interJe ratione colorum,
î,irmzius, nmbrarumque lanteorfumut corpora clara
Obfcura umbrarum reauies fpectanda relinquat.
Du r refn oy , 4 e art.-graph. y; 282.
» Après de grands c lairs, dit de Piles en
» commentant ces vers, il faut de grandes
» ombres qu’on appelle des repos, parce que
» la vue feroit effeôivement fatiguée, fi elle
» étoit continuellement attirée par une con-
» tinuité d’objets pétillans. Ces repos fe font
» de deux manières , dont l’ une elt naturelle ,
» 8c l’autre artificielle. La naturelle fe fait
» par une étendue de clairs ou d’ombres qui
» fuivent naturellement & néceffairement les
» corps folides, ou les maffes de plufieurs
» figures grouppées, lorfque le jour vient à
» frapper : l’artificielle confifte dans les corps
» des couleurs que le peintre donne à de cer-
'» laines chofes telles qu’ il lui plaît, les com-
» pofant de telle forte qu’elles ne faffent point
» de tort aux objets qui font auprès d’elles.
>\ Une drapperie, par exemple, que l ’on aura
R E P
» fait jaune ou rouge en certain' endroit,
» pourra être dans un autre de couleur brune,
» & y conviendra mieux pour produire l’ef-
» fet que l’on demande. On doit prendre oc-
» cafion, autant qu’ il eft poffible, de fe ler-
>5 vir de la première manière, & de trouver
» les repos dont nous parlons par le clair
w ou par l’ombre qui accompagnent nacurel-
» lement les corps folides : mais comme les
» fujets que l’on traite ne font pas toujours
» favorables pour difpofer des figures ainfi
» qu’on le voudrait bien, on peut, en ce
» cas, prendre fon avantage parle corps des
» couleurs, & mettre , dans les endroits qui
» doivent être obfcurs , des drapperies ou
» d’autres objets que l ’on peut fuppofer être
» naturellement bruns ou falis, lefquels vous
» feront le même effet, 8c vous donneront les
» mêmes repos que les ombres qui n’ont pu
» etre caufees par la difpofition des objets.
Ce feroit un grand v ic e , tant contre le repos
que contre la vérité , d’employer deux
jours égaux : c’en feroit un encorfe d’employer
deux couleurs égales , foit qu’elles fufTenc
tendres ou fiéres. Il doit toujours y avoir une
couleur principale qui domine .fenfiblement
toutes les autres. ( L )
REPOUSSOIR ( fubft. mafe.) On a vu longtemps
les peintrès afleéter de placer fur le premier
plan, & fur les bords de leurs tableaux,
des maffes d’ombres obfcures qu’on appelloic
des repoujfoitrs, comme fi l’ on eût voulu faire
Ternir, dit Dandré Bardon, qu’èlles n’étoient
que des reflources maniérées démenties par la
nature. On leur avoir donné ce nom, qui com-
mençoit à faire partie de la langue de l ’art,
parce qu’on les croy-oit néceffaires pour repouffe
r les objets des autres plans. Sans doute la
peinture a fes illufions -, mais elles ne doivent
pas aller jufqu’ à contrarier la nature, & elles
ne font permifes que pour rendre le menfonge
de l’art plus reffemblanr à la vérité. Dans le
temps de cette mode 3 le s connoiffeurs , c’eft-
*à-dire, les hommes qui tâchent d’écouter ce
que difent les artiftes, pour fe faire un jargon
qui annonce des connoiffances, ne manquoient
pas d’approuver les repouffoirs, & fe moquoient
des bonnes gens qui demandoient pourquoi
les peintres mettoient des figures de Nègres
dans les coins de leurs tableaux. C’étpit cependant
ces bonnes gens qui avoient raifbn i
les artiftes étoient égarés par une fauffe pratique
, & les connoiffeurs égarés par les artiftes
11e favoient ce qu’ ils diloient-, ce qui n’eft
pas rare aux connoiffeurs dans tous les
genres; .
Tout homme peut s’affurer par fes propres
yeux que les ombres ne font pas tout à fait
obfcures ; ellçs *fgnt éclairées par des parti-
R E P
eûtes de lumière dont l’air eft chargé belles
ie font par des lumières de reflet , & ne pa-
roiffent fombfes que par comparaifon avec des
parties pluslumineufes. Elles deviennent même
claires, fi l’on cache ces parties. Plus on
eft près des objets ombrés, & moins ils font
obfcurs, parce que les rayons qui apportent
dans l’oeil l’ image de ces objets ont eu moins
de chemin à parcourir, & parce qu’ il fe trouvé
entre l’oeil 8c ces objets une moindre quantité
de lumière dont l’osil foit ébloui. Pour que le
tableau foit une repréfentation de la nature il
faut qu’on y diftingue nettement, même dans,
l ’ombre, les objets des premiers plans, &
que le peintre ne prête pas à la lumière du
jour un effet qui rie peut convenir qu’a, celle
de la lune. Un homme qui fe trouve dans la
rue du côté éclairé par le fo le il, voit très-
diftinélement tous les objets qui font de l’autre
côté dans l’ombre.
Comme les modes paffëes peuvent renaître,
quelqu’abfurdesqu’ellesfoient, il eft bon de s’opposer
au retour de celle des repouffoirs. Nous
croyons donc qu’il n’eft pas-inutile de rapporter
i c i , du moins en fubftance , ce que M. Crachin
aécrit contre Cette convention ridicule. Il n’a
fa it, comme il l’avoue lui-même, que répéter
ce qu’ il avoit appris de l’Argillière , fa-
vant élève d’une école colorifte.
I l pofe pour pfitfcipe que, les ombres les
plus fortes en obfcurité, ne doivent pas être
fu r les devants dû tableau ,• qu’au contraire les.
ombres des objets qui font fu t ce premier plan,
doivent être tendres & reflétées , & que les ombres
les plus fôrtes & les plus obfcures doivent
être aux objets qui font fu r le. fécond
plan.
Il avertit q u e , dans cette règle, il fait
abftraétion dés couleurs particulières de chaque
objet, & qu’èn cîifant qu’ une ombre eft
plus forte.qu’ une autre, il rt’éntehd pas qu’ elle
foit plus.forte de Couleur , mais feulement plus
forte d’obfcurité. 11 donne, pour démonftration de fon princ
ip e , l’exemple d’une muraille fuyante , ombrée
dans toute fa longueur, & ponant aufîi,
dans toute fa longueur, urte ombre fur le te-
rein : il affirme , ce qui s’accorde avec la vérité
dont chacun peut juger par foi-mème , que
ces ombres j en s’éloignant jufqu’à uhè affez
grande diftance , augmentent fenfibiémerit
d’obfcurité. On peut faire la même demonf-
tration datis une allée d’arbres, ou darisune,
galerie ornée de ftatues qu’ il faïit alors' regarder
en fe plaçant de manière que la première
fe détaché fur la fécondé. & ainfi de :
fuite. Des rangs de color.nès .fuçccfiîves- offrent
le même phénomène : l’ombre ^de'la1 première
fe détacne en clair fur 'l ’ombre: de la
.fécondé} celle-ci ëft plus ferrdréque celle-de
R E P
la troifièjire, & ainfi de toutes les. autres,
jtifqu’ à une diftance affez grande ; alofs à cette
gradation fuccède une dégradation femblable,
c’eft à-dire que les ombres s’affoib liftent en
s’éloignant.
Il faut obferver que des perfonnes prévenues
du principe contraire pourraient ne pas ap-
percevoir bien fenfiblement cet effet & en nier
l’exifterfee , fi on vouloir le leur démontrer
fur des objets qui euffent peu de diftance en-
cr’eux. Ori doit donc choifir, pour cette démonftration
, des vues d’une affez grande
étendue.
Ajoutez que des .perfonnes qui auraient la
vue trop courte ne feraient pas propres à recevoir
cette démonftration. L’ombre la plué
forte pour eux feroit à une diftance fi voifine
qu’elles n’appercevroient pas fenfiblement la
•dégradation qui fe trouverait entre cette ombre
& celle d’ un objet plus prochain. M. Cochin
pour les convaincre , entre dans des détails
fur le mécanifme de la lumière.
iy i° Nous ne voyons, d it- il, la couleur
» 8c la forme des objets de la nature, que
» par la réflexion de la lumière qui les frappe ,
» qui fe réfléchit, 8c qui vient en peindre
» une image au fond de nos yeux. Ainfi
» dans la privation de toute lumière , quôi-
» que les objets exiftent autour de nous , nous
» ne les voyons point ; & ce ne peut être que
» parce qu’ils ne nous renvoyant point de
» rayons de lumière qui nous les peignent. '
» 2.0’ C’eft la plus ou moins grande' quan-
» tité de ces rayons, & la force plus«ô'u moins
» grande avec laquelle ils frappent nos yeux
•» qui produit en nous la fenfation de lumière
» plus ou moins vive. Ainfi la diminution de
» la lumière détruit la netteté & l’éclat des
» images qu’elle peint à nos yeux.
» ‘ 3° a& i°n des rayons de la lumière
» ‘ s’aifoiblit par la diftance qu’ elle a à parcou-
» rir. Un flambeau , à iine diftance très-éloi-
» /gnée, ne nous paraît pas aufti briliant que
« !lorfqu’il eft proche,
» 4° La lum ière perdr con fid érab lem n n t d e
» fa f o r c e , à ch a q u e fo is qu’e lle fe réfléchit-*
»• c e q ui fait q u e , q u o iq u e nous v o y o n s très-
» d iftîn d ë in e n t une' lum ière, très-élo ig n ée d e
» n ou s y ' n ou s "ne v o y o n s pas n éantm oins le s
» o b jets qu ’e lle écla ire autour d’e l l è , parce
» q u e lé s ray on s d e lum ière q u e c e s o b jets
» refléch iffen t n e p eu v en t p o in t arriver ju fq u ’a
»• n o u s, ou ils y arriven t fi fo ib le s q u ’ils n e
» 'p e u v e n t a ffe â e r nos y eu x d’u n e m anière qui
-» nous foit fen fib le. Or c e q u i e ft vrai d ’u n e
;» lum ière te lle q u e c e lle d’un flam b eau e ft
» éga lem en t vrai de c e lle d u f o l e il , q u o iq u e
<» dans u n e proportion d ifféren te. 1
» On peut, continue M. Cochin, comparer
» l’aétion de la lumière, au mouvement d’un.®