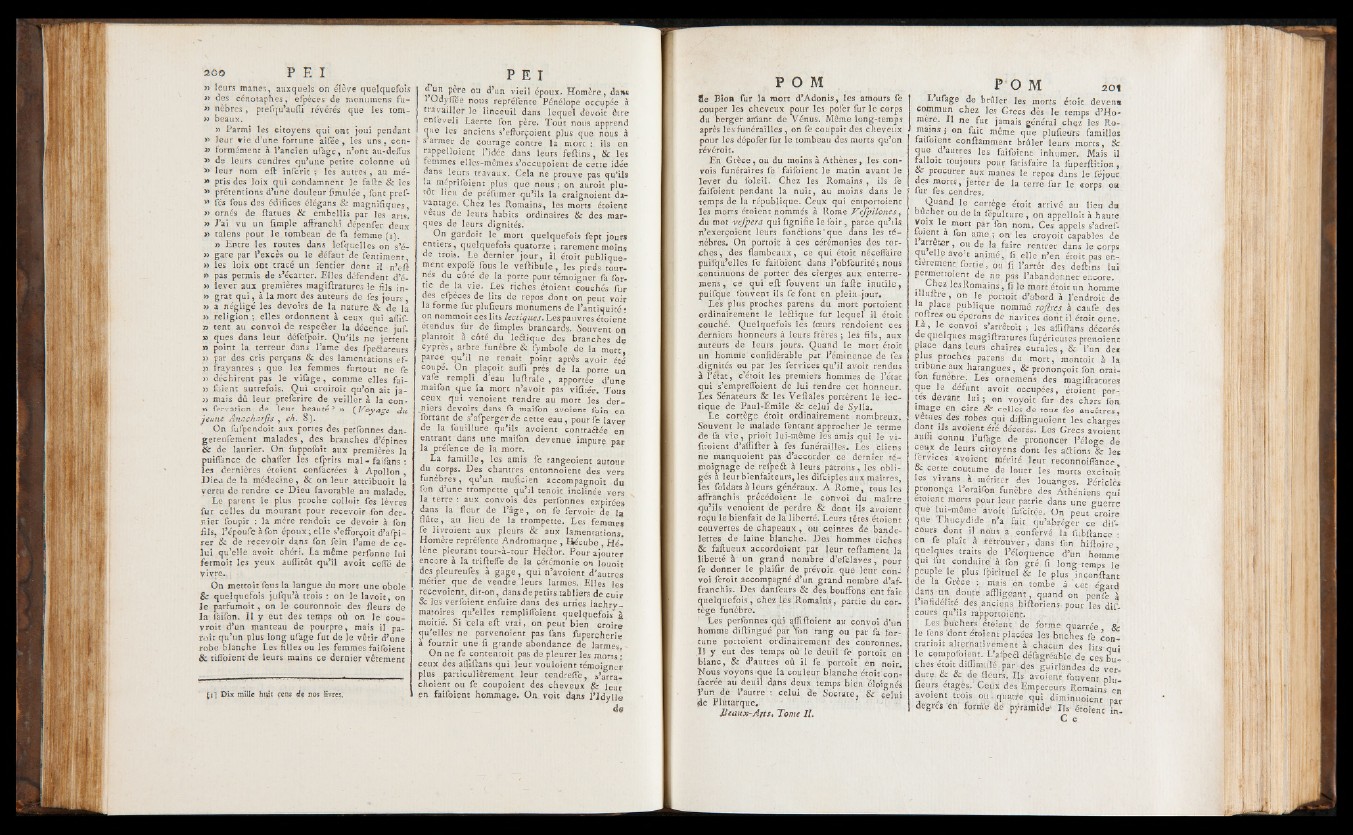
» leurs mânes, auxquels on élève quelquefois
» des cénotaphes, efpèçes de mo nu mens fu-
» nèbres, prefqu’aufii révérés que les tom-
» beaux.
» Parmi les citoyens qui ont joui pendant
» leur vie d’une fortune ai fée , les uns. con-
» formément à l’ancien ufage, n’ont au-deffus
» de leurs cendres qu’une petite colonne ©ù
» leur nom eft infcrit ; les autres, au mé-
» pris des loix qui condamnent le fafte & les
» prétentions d’une douleur fimulée , font pref-
» fés fous des édifices élégans & magnifiques
» ornés de ftatue? & embellis par les arts,
» J’ai vu un fimple affranchi dépenfer deux
» talens pour le tombeau de fa femme (i).
» Entre les routes dans lefquelles on s’é-
» gare par l’excès ou le défaut de fentiment
» les loix ont tracé un fentier dont ii n’eft
» pas permis de s’écarter. Elles défendent d’é-
» lever aux premières magiftratures le fils in-
» grat q u i, à la mort des auteurs de fes jours
» a négligé les devoirs de la nature & de la
» religion -, elles ordonnent à ceux qui afiif-
» tent au convoi de respeâer la décence juf-
» ques dans leur défcfpoir. Qu'ils ne jettent
» point la terreur dans l ’ame des fpeétareurs
» par des cris perçans & des lamentations ef-
p frayantes -, que les femmes furtput ne fe
» déchirent pas le v ifa g e , comme elles fai-
» foient autrefois. Qui croiroit qu’on ait ja-
» mats dû. leur prefcrire de veiller à la con-
» fervation de leur beauté ? » ( Voyage du
jeune A n a charfis , eh. 8).
On fufpendoit aux portes des perfonnes dan-
gereufement malades , des branches d’épines
& de laurier. On fuppofoit aux premières la ;
puiffance de çhafler les efprirs mal - faifans :
les dernières étoient confacrées à Apollon ,
Dieu de la médecine, & on leur attribuoit la
vertu de rendre ce Dieu favorable au malade.
Le parent le plus proche colloit fes lèvres
fur celles du mourant pour recevoir fon dernier
foupir ; la mère rendoit ce devoir à fon
fils, l ’époufeàfon époux; elle s’effbrçoit d’afpi-
rer & de recevoir dans fon fein l’ame de ce^
lui qu’elle avoit chéri. La môme perfonne lui
fermoit les yeux auflitôt qu’il avoit celfé de
vivre., j
On mettoit'fous la langue du mort une obole
& quelquefois jufqu’à trois : on le la voit, on
Je parfumoit, on le çouronnoit des fleurs de
la faifon. Il y eut des temps où on le çou-
vroit d’ un ipanteau ôe pourpre, mais il par
roîc qu’ un plus long ufage fut de le vêtir d’une
robe blanche Les filles ou les femmes faifoient
& tiffoient de leurs mains ce dernier vêtement
tv v i ^e'fe OU v ieil époux. Homère, dans 1 QdyfTee nous repréfente Pénélope occupée à
travailler le linceuil dans lequel devoit être
enlfeveli Laerte fon père. Tout nous apprend
c[lie les anciens s’efforçoient plus que nous à
s armer de courage contre la mort ils en
rappelloient l’ idée dans leurs feftins, & les
femmes elles-mêmes s’occupoient de cette idée
dans leurs travaux. Cela ne prouve pas qu'ils
plus que nous ; on auroit plutôt
lieu de préfumer qu’ils la craignoient davantage.
Chez les Romains, les morts étoient
vêtus de leurs habits ordinaires & des marques
de leurs dignités.
On gardoit le mort quelquefois fept jours
entiers, quelquefois quatorze ; rarement moins
de trois. Le dernier jour, il étoit publiquement
expofo ious le veftibule, les pieds tournés
du côté de la porte pour témoigner fa for-
tie de la vie. Les riches étoient couchés fur
des efpèces de lits de repos dont on peut voir
la forme fur plufieurs monumens de l’antiquité :
on nommoit ces lits lectiques. Les pauvres étoient
étendus fur de fimples brancards. Souvent on
planroit à côté du le âiq ae des branches dç
cyprès, arbre funèbre & iymbole de la mort
parce^ qu’il ne renaît point après avoir été
coupé. On plaçoit àufli près de la porte un
vafe rempli, d’eau luftrale , apportée d’une
maifon que la mort n’avoit pas vifitée. Tous
ceux qui venoient rendre au mort les derniers
devoirs dans fa maifon avoient foin en
fortant de s’afperger de cette eau, pour fe laver
de la fouillure qu’ils avoient contraélée en
entrant'dans une maifon devenue impure par
la préfence de la mort.
La famille, les amis fe rangeoient autour
du corps. Des chantres entonnoient des vers
funèbres, qu’ un muficien accompagnoit du
fon d’une trompette qu’ il tenoit inclinée vers
la terre : aux convois des perfonnes expirées
dans la fleur de l’âg e , on fe fervoit' de la
flûte, au lieu de la trompette. Les femme?
fe livroient aux pleurs & aux lamentations,
Homère repréfente Andromaque , Hécube Hélène
pleurant tour-rà-tour Heétor. Pour ajouter
encore à la triftelfe de la cérémonie on louoit
des pleureufes à gage , qui n’avoient d'autres
métier que de vendre leurs larmes. Elles les
recevoient, dit-on, dans depetirs tabliers de cuir
& les verfoient enfuite dans des urnes Jachry-
matoires qu’elles remplifîbient quelquefois à
moitié. Si cela eft vrai, on peut bien croire
qu'elles ne parvenoient pas fans fupercherie
à fournir une fi grande abondance de larmes -
On ne fe contentoit pas de pleurer les morts :
ceux des alfiftans qui leur vquloient témoigner
plus particulièrement leur tendreffe, s’arra-
choient ou fe coupoient des cheyeqx & leur
en faifoiçnt hommage. On. voit dans l ’Idylle
m
Dix mille huit cens de nos livres,
P O M
Se Bion fur la mort d’Adonis, les amours fe
couper les cheveux pour les pofer fur le corps
du berger aidant de Vénus. Même long-temps
après les funérailles , on fe coupoit des cheveux
pour les dépofer fur le tombeau des morts qu’on
révéroit.
En Grèce, qu du moins à Athènes, les convois
funéraires fe 'faifoient le matin avant le
lever du foleil. Chez les Romains , ils fe
faifoient pendant la nuit, au moins dans le
temps de la république. Ceux qui emportaient
les morrs étoient nommés à Rome Vefpilones,
du mot vcfpera qui lignifie le foir , parce qu’ ils,
n’exerçoient leurs fonélions'que dans les ténèbres,
On portoit à ces cérémonies des torches
, des flambeaux, ce qui étoit néceflaire
puifqu’ elles fe faifoient dans l’obfcurité; nous
continuons de porter des cierges aux enterre-
mens, ce qui eft fouvent un fafte inutile,
puifque fouvent ils fe font en plein qour.
Les plus proches parens du mort portoient
ordinairement le leélique fur lequel il étoit
couché. Quelquefois les foeurs rendoienc ces
derniers honneurs à leurs frères ; les fils, aux
auteurs de leurs jours. Quand le mort étoit
un homme confidérable par l’ éminence de fes
..dignités ou par les fervices qu’ il avoit rendus
à rétàt, c’étoit les premiers hommes de l’état
qui s’empreffoient de lui rendre cet honneur.
Les Sénateurs & les Veftales portèrent le tactique
de Paul-Émile & cèlui de Sylla.
Le cortège étoit ordinairement nombreux.
Souvent le malade fentant approcher le terme
de fa vie , prioit lui-même les amis qui le vï-
fitoient d’affifter à fes funérailles. Les cliens
ne manquoient pas d’accorder ce dernier témoignage
de refpeâ à leurs patrons, les obligés
a leur bienfaiteurs, les difciples aux maîtres,
les foldats à leurs généraux. A Rome , tous les
affranchis précédoient le convoi du maître
qu’ils venoient de perdre & dont ils avoient
reçu le bienfait de la liberté. Leurs têtes/étôient
couvertes de chapeaux, ou ceintes de bandelettes
de laine blanche. Des hommes riches
& faftueux accordaient par leur teftament. la
liberté à un grand nombre d’efclaves, pour
fe donner le plaifir de prévoir que leur convoi
feroit accompagné d’ un grand nombre d?af-
franchis. Des danfeurs & des bouffons ont fait
quelquefois , chez lés Romains, partie du çor-
tege funèbre. '
Les perfonnes qui affiftoient au convoi d’un
homme diftingué par Yen rang ou par fa fortune
portoient ordinairement des couronnes.
I l y eut des temps oùTe deuil fe, portoit en
blanc, & d’autr.es où il fe portoit en noir.
Nous voyons que la couleur blanche étoit con-
facrée au deuil dans deux temps bien éloignés
l ’ un de l’autre : celui de Socrate, & celui
làe Plutarque,.
i l eaux-Art s , Tome II.
P O M 2oi
L ufage de brûler les morts étoit. deven«
commun chez les Grecs dès le temps d’Ho-
mere. I l ne fut jamais général chçz les Ro-
mains î on fait même que plufieurs familles
faifoient conftamment brûler leurs morrs, &
que d autres les faifoient inhumer. Mais il
ralloit toujours pour fatisfaire la fuperftition ,
& procurer aux mânes le repos dans le féjour
des morts, jetfer de la terre fur le corps ou
lur fes cendres. ’
k^S,Uan^ cort®8e étoit arrivé au lieu dti
bûcher ou de la fépulture , on appelloit à haute
voix le mort par fon nom. Ces appels s’adref-
, l? lent a on’ les croyoit capables de
1 arrêter, ou de la faire rentrer dans le corps
q u e lle a v o ’t animé, fi elle n’en étoit pas entièrement
fortie, ou fi l’arrêt des deftins lui
permettoient de ne pas l’abandonner encore.
*îi lesRPmaihs, fi le mort.étqit un homme
illu ltr e , on le portoit d’abord à l ’endroit de
la place publique nommé rojlres à caufe des
roltres ou éperons de navires dont il étoit orne.
L a , le convoi s’arrêtoit ; les affiftans décorés
e quelques magiftratures fupérieutes prenoient
place dans leurs chaires curules, & l’un de*
plus proches parens du mort, montoit à la.
tribune aux harangues, & prononçoit fon orai-
lon funebre. Les ornemens des magiftratures
que le défunt avoit occupées, étoient portes
devant lu i ; on voyoit fur des chars fon.
image en cire & celles de tous fes ancêtres,
vetues des robes qui diftinguoient les charges
dont ils avoient été décorés. Les Grecs avoient
aulli connu l’ufage de prononcer l’éloge de
ceax de leurs citoyens dont les aélions & les
ftrvices avoient mérité leur reconnoiflance,
cette coutume de louer les morts excitoit
les yivans à mériter des louanges. Périclès
prononça Toraifon funèbre des Athéniens qui
etoient morts pour leur patrie dans une guerre
que lui-même avoit fufeitée. On peut croire
que Thucydide n’a fait qu’abréger ce dif-
cours dont i] nous a' confervé la iubltance •
en fe plaît à retrdùVéf, dans Ion hiftoire ’
quelques traits de l ’éloqtiénce d’ in homme
qm fut co n d u ira i fon gré fi longtemps le
peuple le ^ plus fpirituel & le plus inçonftant
de la Grèce. ; mais ;on tombe à 'cet égard
iSataW affligeant, quand on penfe à
1 infidélité dés anciens hiftoriens. pour les dif-
cours qu’ils rappottpient.
Lès bûchers étéient. dé forme quarrée &
le fens 'dont étoient placées les bnçhes fe con-
trarioit altetnativemènt à cbacun des lits
le cpmpofoient. l.’ aiprc: défagréable dp ces bu
ches'étoit difrimulé,par des guirlandes de ver"
dure. & & de fleurs. Ils avoient fouvent Dlu
fleurs étages. Ceux des Empereurs Romains en
avoient trois, oul.quatfe qui diminuaient car
degrés 'en' forme de pyramide’ Tls* Iroient fli