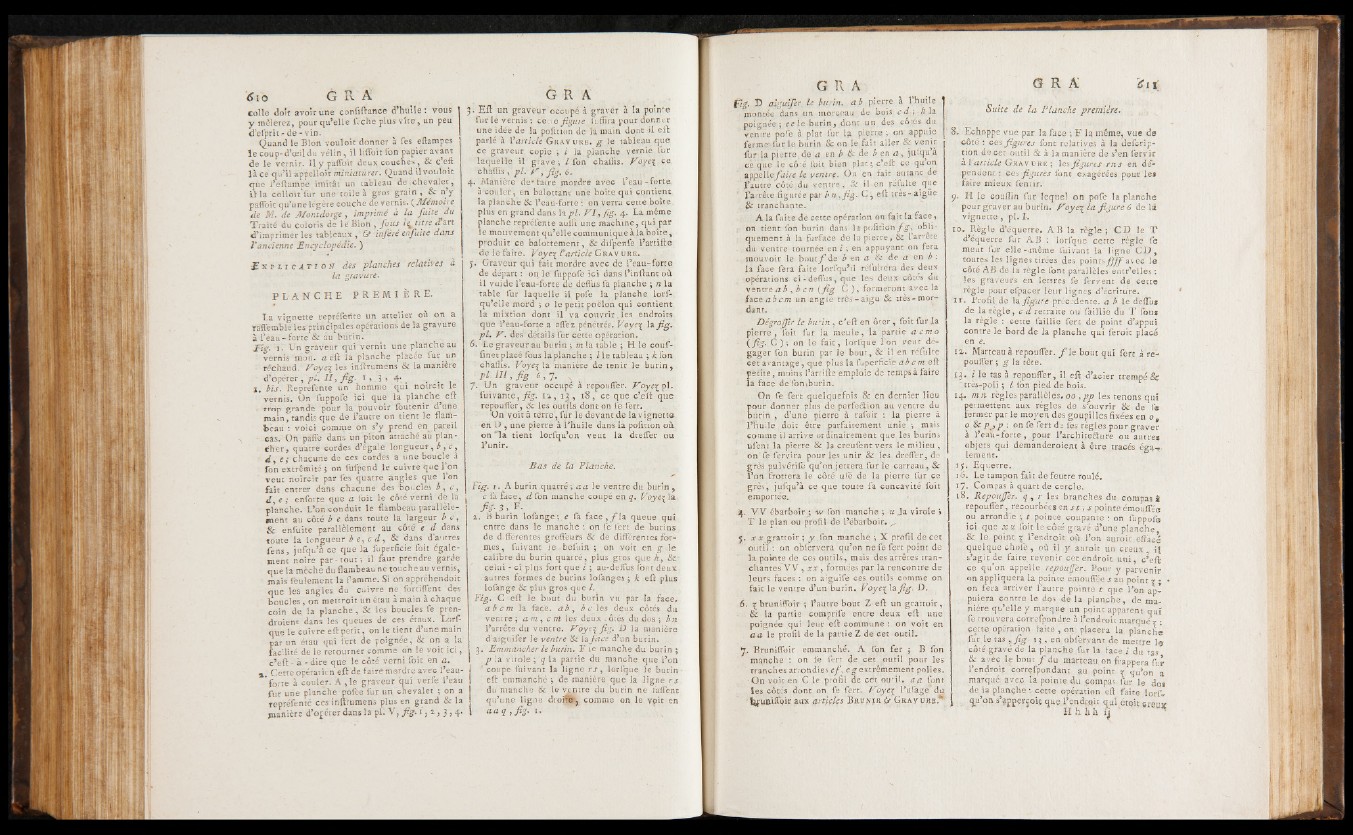
610 G R À
colle doit avoir une confiftance d’huile: vous
y mêlerez, pour qu’elle feclie plus v ite , un peu
d’efprit- de- vin.
Quand le Blon vouloit donner a Tes eftampes
le coup-d’oeil du vélin, il lifToit fon papier avant
de le vernir. Il y paffoit deux couches , & c eft
là ce qu’ il àppelloit miniatùrer. Quand il vouloit
que i’éftampe imitât un tableau de-.chevalet,
i l la colloit fur une toile à gros grain ,• & n’y
paffoit qu’une légère couche de vernis. ( Mémoire
de M. de Montdorge, imprimé à la fuite au
Traité du coloris de le Blon , fous îe^ titre il art
d’ imprimeries tableaux , G* inféré enfuite dans
Vancienne Encyclopédie. )
£ x p i i c 4 t i o n des planches relatives a
la gravure.
P L A N C H E P R E M I È R E .
La vignette repréfente un attelier où on a
raffemblé les principales opérations de la gravure
à l’eau-forte & au burin. Fig- i . Un graveur qui vernît une planche au
vernis mou. a éft la planche placée fur un
réchaud. Foye^ les inftrumens & la maniéré
d’opérer, pi. II, fig- 1 ». 3 ■» 4*.. s .
I . bis. Repréfente un homme qui noircit le
vernis. On fuppofe ici que la planche eft
• trop grande pour la pouvoir foutenir d une
main,tandis que de l’autre on tient le flambeau
: voici comme on s’y prend en pareil
cas. On pâffe dans un piton attaché au planch
e r , quatre cordés d’égale longueur, b., c , d, e; chacune de ces cordes a une boucle à
fon extrémité 5 on fufpend le cuivre que l’on
veut noircir par fes quatre angles que l’on
fait .entrer dans chacune' des boucles 3 , c ,
de; enforte que a foit le côté verni de là
planche. L’on conduit le flambeau parallèlement
au côté b e dans toute la largeur b c,
& enfuite parallèlement au côté e d dans
toute la longueur b e, c d, & dans d’autres
fens, jufqu’à ce que la fuperficie foit également
noire par-tout -, il faut prendre garde
que la mèche du flambeau ne touche au vernis,
mais feulement la flamme. Si on apprêhendoit
que les angles du cuivre ne. fortifient des
boucles, on mettroit un étau a main a chaque
coin de, la planche, & les boucles fe pren-
droient dans les queues de ces étaux. Lorf-
que le cuivre eft petit, on le tient d’ une main
par un étau qui fert de poignée, & on a la
facilité de le retourner comme on le voit i c i ,
c’ eft - à - dire que le côté verni foit en a.
a< Cette opération eft de fairé mordre avec l’eau-
forte à couler. A , 1e graveur qui verfe l’eau
fur une planche pofee fur un chevalet ; on a
repréfenté ces inftrumens plus en grand & la
jnanière d’operer dans la pl. V , fig. 1 ,2, 3 •> 4’
G R A
3 . E ft un gra veu r occu p é à graver à la pointe
fur le v ern is : c eae figure, luffira pour donner
u n e id ée d e la pofinon d e la m ain d on t i l eft
parlé à Varticle Grav u r e . g le tab leau q u e
ce gra veu r cop ie ; i la p lan ch e vern ie fur
la q u e lle il g ra v e ; /T o n ch aflis. Foye\ ce
châfiis pl. F , fig. 6.
4 . M anière de* faire m ordre a v ec Teau - fo r te
à c o u le r , en balottan t u n e b o îte q u i co n tien t
la p lan ch e & l’eau-forte i on verra c ette b o îte
plus en grand dans la pl. F I , fig. 4- La m êm e
p lan ch e repréfente auili u n e m a c h in e , q u i par
le m o u v em en t qu ’e lle com m u n iq u e à la b o îte ,
p rod u it c e b a lo ttem en t, & difpenfe l’a rtifte
d e lé faire. Voye\ Varticle Gravure.
5. G raveur q u i fait m ordre a v ec d e l’ea u -fo rte
d e départ : on le' fuppofe ic i dans l’in ftan t o ù
il v u id e l’eau -fo rte de deffus fa p lan ch e ; n la
ta b le fur la q u e lle il p ôle la p lan ch e lorf-
qü ’e lle m ord ; o le p etit p o êlo n q u i c o n tien t
la m ix tio n don t il va cou vrir , les endroits
q u e l’eau -forté a affez pénétrés.' Voÿe-% la. fig .
p l. F . d es'd éta ils fur cette op ération.
6 . Le graveu r au b u rin ; m la tab le ; H le c o u f-
fin et p lacé fous la p lan ch e ; l le tab leau ; k fon
ch affis. Voye\ la m anière d e ten ir le burin ,
■ pl. 111, f ig . '6 ',-J. \
7 . U n graveu r occup é à repouffer. Foye^ pl.
ffu iv a n te, fig. 1 2 , 13 , 1 8 , ce q u e c ’e ft q u e
reppuffer, & les o u tfls don t on fe fert.
O n v o it à tèrre, fur le d evan t de la v ig n e tte
en D , u n e pierre à l ’h u ile dans la pofition où.
on *na tie n t lorfq u ’on v e u t la dreffer ou
l’ unir.
B a s de la Planche.
Fig. t . A burin quarré ; a a le ven tre du burin ,
c fa face , d fon m a n ch e cou p é en q. Voye^ln,.
fig- 3 , F- ' 2. B burin lo fa n g e ;.e fa f a c e , /"la q u eu e q u i
en tre dans le m an ch e ; on le l'ert de burins
d e différentes groffeurs & dé d ifferentes form
e s , fu ivan t le b e f o in ; on v o it en g.-le
calib re du burin q uarré, plus gros q u e h, &■
c e lu i - c i p lu s fort q u e i ; au-deffus fon t d eu x
autres form es d e burins lofan ges ; k e ft plus
lofan ge & plus g ro s q u e l.
Fig. C e ft le bou t du burin v u par la fa ce.
a b cm la face, ah ^ b c les d eux côtés du
v e n tr e ; am , c nt le s d eu x ôtés du .dos ; b 71
l’arrête du v en tre. Foye\ fig. D la m anière
d'aigu ifer le ventre & Va. face d’un burin.
3. Emmancher le burin. F le m an ch e du burin ;
p la v iro le q la partie du m an ch e q u e l ’on
cou p e fu ivan t la lig n e r s , lorfq u e le burin
eft em m anch é ; d e m anière q u e la lig n e r s
du m a n ch e & le vgn tre du burin ne faffent
q u ’une lig n e droiflk,. com m e o n le v o it en
a a q , fig . 1.
fig . D aiguîfer le burin, a b pierre a 1 h u ile
m on tée dans un m orceau de b ois c d. ; /r la
poignée-; ee -le b u r in , .dont un des coçés du
ven tre pofe à p lat fur la pierre ; on appuie
ferme? fur le .burin & on le fait a ller & v en ir
fur la pierre, de a en b & d e .b en a., jufqu.a
ce que le côté foit b ien plat ; c’e ft ce qu on
appell e faire le ventre. O n e n , fait autanc d é
l ’autre côte .du- ventre y, Sc il en refu lte q u e
l ’a'rêce figurée par bnirfig. C , e ft tr e s-a ig iie
fc. tran ch an te.
A la fu ite dé c ette opération on fait la face j
; on tien t fon burin dans la pofition f,g\ o b liq
u em en t à la furface d e la p ierre, & l’arrête
du v en tre tournée en i ; en appuyant on fera
m ou voir le b o u ta d e b en a & d e a' en b :
là face fera faite lorfqu’il réfulréra des deux
• opérations c i- deffus , q u e les d eu x côtes ou
ven tre a b , en (fig C ) , form eront a vec la
fa ce abcm un angle- tr è s -a ig u & très-m o rdant.
Dégroffir le bicnn, c 'e ft en ô ter , foit fur la
p ie rr e , lbit fur la m e u le , la partie à em o
- {fig. C )-, on le fa it , lorfq u e I o n v eu t dég
a g er fon burin par le b o u t, & il en refaite
c e t a v a n ta g e, q u e plus la fuperficie abcm eft
p e tite , m oins l’arrifte em p loie de temps à faire
la face d e fon fou rin .
O n fe fert q u elq u efo is & en d ern ier lieu
pour donner plus d e perfe& ion au ven tre du
burin , d’une pierre à rafoir : la pierre à
l ’iiù ile d o it être p arfaitem ent u n ie ; mais
com m e il arrive o rd in airem en t q u e les burins
îifen t la pierre & la cre'ufe'nt v ers le m ilieu ,
’ on fe fervira pour les u n ir & les dreffer, de
grès p ulvérifé qu ’on jettera f u r ie carreau , &
l ’on frottera le cô té ufé de la pierre fur ce '
grès', jufqu’à c e q u e to u te fa co n ca v ité foit
em portée. ,
4 . Y V ébarboir g w fon m an ch e ; u J a v iro le i
. T le plan ou profil d e l’ébarb oir. f
5;. x x grattoir ; y Ton m an ch e ; X profil de c e t
o u til : on obfërvera qu ’on n e fe fert pofnt de
la pow ite d e ces o u tils, m ais des arrêtes tranch
a n tes V V , xx , form ées par la ren con tre de
leu rs faces : on a ig u ife ces o u tils com m e on
fa it le ven tre d’un bu rin . Voye\\zfig. D .
6 . ^b ru n iffoir ; l’autre b o u t,Z 'e ft un g ra tto ir,
& la partie com prife en tre d eu x e ft u n e
p o ig n ée q u i leu r eft com m u n e : on v o it en
a a le profil d e là partie Z d e c e t o u til.
7 . Bruniffoir em m an ch é. A fon fer ; B fon
m an ch e : on le fert de c e t ,o u til pour les
tran ch es arrondies e f . e g extrêm em en t p o lies.
O n v o it e n C le profil de ce't o u T l. aa fon t
le s côtés don t on le fert. Foye^ Tu Page du
^fuittiffoir aux articles B r u n j r ,Gr G r a w s e .^
Suite de la Planche première.
8 . E ch op p e v u e par la face ; F la m êm e, v u e d e
c ô té : ces figures fon t rela tiv es à la d eferip -
tio n de c e t o u til & à la m anière d e s’en fervir
kl'article G r a v u r e ; les figures rns en dép
en d en t : ces figures fon t exagérées pour le*
. faire m ieu x fencir.
9- H le cou ffin fur leq u el o n pofe la p lan ch e
pour g ra ver au bu rin . F o y e \ la figure 6 d e là
v ig n e tte , pl. L.
1 0. R è g le d’équ erre. A B la r è g le ; C D le T
d’éq u erre fur A B : lorfq u e cette r è g le fe
m eu t fur e lle -.m êm e fuivant la lig n e C D ,
tou tes les lig n e s tirées d es p o in tsf f f f a v ec le
côté A B de la r è g le fon t parallèles en tr’e lle s :
le s graveu rs en lettres fe ferven t d e c e tte
règ le pour efp acer leu r lig n e s d’écritu re.
11. F rofil.d e la figure p recedente, a b le deffus
d e la r è g le , c d retraite ou fa illië du T fous
la règ le : c e tte fa illie fert d e p o in t d’appui
con tre le bord d e la p lan ch e q u i feroit p lacé
en e.
12. Marteau à repouffer, ƒ le b ou t q u i fert à repouffer
; g la tête.
,13. i le tas à rep ou ffer, il eft d ’a cier trem p éS ç
'très-rpoli ; l fon p ied d e b ois.
14. mn règ les p a rallèles. 00 ,p p le s ten on s q u i
p erm etten t aux règ les d e s’ou vrir & d e fa
ferm er par le m o y en des g o u p ille s fixées en 0 ,
o & P,, p : on fe fert de fes règ les pour g ra ver
à l’e a ù -fo r te , pour T arch iteéiu re o u autres
o b jets q u i d em a n d ero ien t à être tracés éga-*-
.lem en t.
15. E q u erre.
16. Le tam pon fait d e feu tre rou lé.
17. C om pas à quart d e cer c le .
1 8. Repouffer, q , r les b ran ch es du com pas £
rep ou ffer, recou rb ées en s ( ; s pointe ém ou fféc
ou arrondie ; t p o in te cou p an te : on fuppofe
ic i q u e x ù foit le côté gravé d’u n e p la n c h e ,
& le poin t ■ { l’en d ro it où l’on auroir effacé
q u e lq u e ch o fe , où il y au roit un creu x il
s’a g it d e faire reven ir c e t en d ro it u n i, c’eft:
ce qu ’on ap p elle repôujfer. Pour y parvenir
on appliquera la pointe ém ouffée s au poin t v . .
on fera arriver l’autre pointe £ que Ton appuiera
contre le dos d e la p lan p h e, d e m a n
ière qu’e lle y m arque un point apparent q u i
fe trouvera correfpondre à l’en d ro it m arq u er :
ç e tte opération faite , o n placera la p la n ch e
fu r le tas ,,fig. 13 , en ob fervan t d e m ettre I9
côté gravé d e la planche fur la face i du tgs
& a v èç bout / du marteau on frappera fur
l’en d ro it 'correfpond ant au point r qu’on a
m arqué a v e c la p o in te du com pas for le d os
d e là pïançhe : c e tte opération eft fa ite lorfo
q u ’on.s’ap p çrçoit q u e l’cndr.qic q u i éto it creu x
H h h Ii n ' '
w m