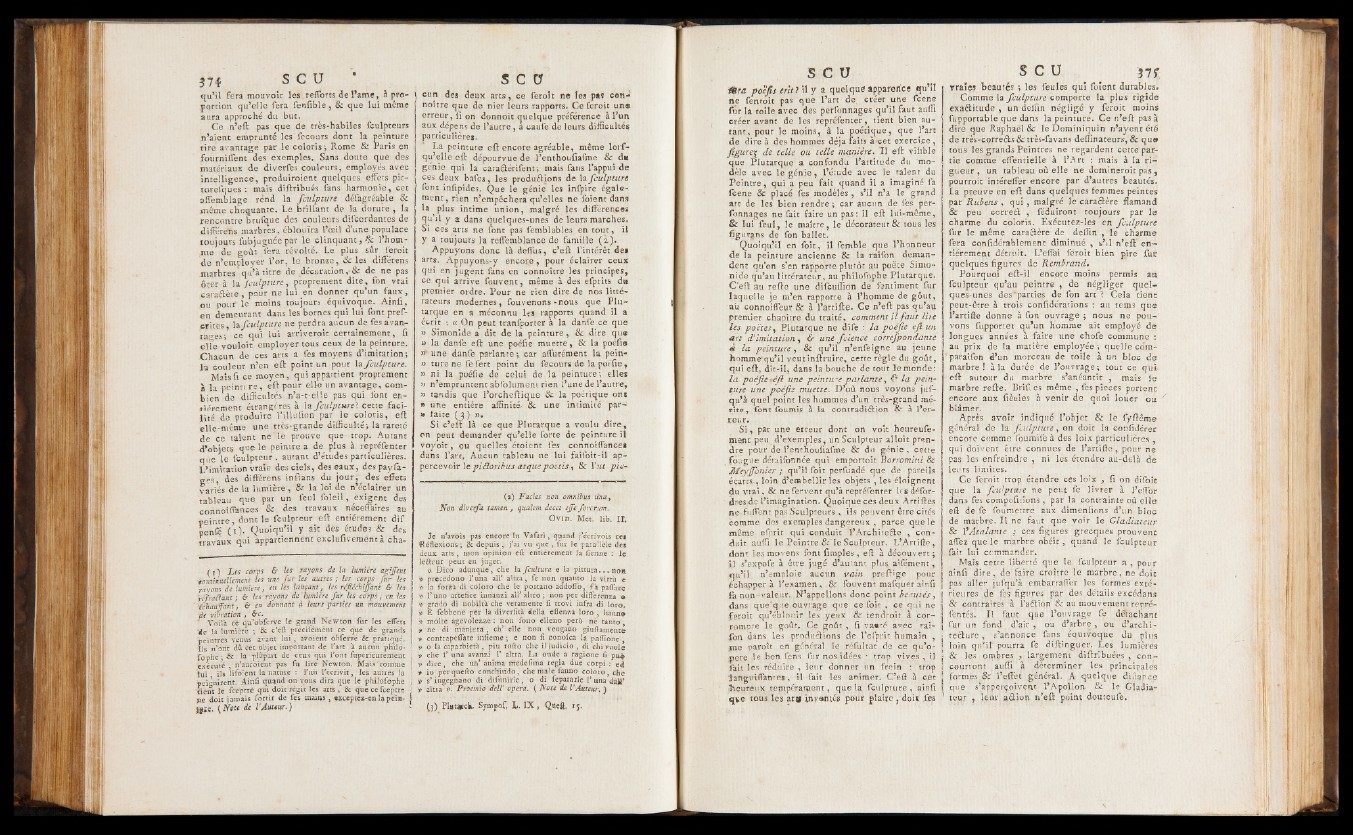
qu’ il fera mouvoir les refforts de l’ame, à pro- \
portion qu’elle fera fenfible, 8c que lui même
aura approché du but.
Ce n’eft pas que de très-habiles fculpteurs
n’aient emprunté les'fccours dont la peinture
tire avantage par le coloris*, Rome & Paris en
fournirent des exemples. Sans doute que des
matériaux de diverfes couleurs, employés avec
intelligence, produiraient quelques effets pit—
torefques : mais diftribués fans harmonie, cet
affemblage rend la fculpture défagréable 8c
même choquante. Le brillant de la dorure, la
rencontre brufque des couleurs difcordantes de
différées marbres, éblouira l’oeil d’une populace
toujours fubjuguée par le clinquant 9 8c l’hosn-
me de goût fera révolté. Le plus .sûr ferait
de n’ employer l’or, le bronze, & les différçns
marbres qu’ à titre de décoration de ne pas
ôter à la fculpture, proprement dite, ion vrai
caraélère, pour ne lui en donner qu’un faux,
ou pouf le moins toujours équivoque. Ainfi,
en demeurant dans les bornes qui lui font pref-
crites, la fculpture ne perdra aucun de fes avantages;
ce qui lui arriverait certainement, fi
elle vouloir employer tous ceux de la peinture.
-Chacun de ces arts a fes moyens d’ imitation;
la couleur n’en eft point un pour la fculpture.
Mais fi ce moyen, qui appartient proprement
à la peinture, eft pour elle un avantage, combien
de difficultés n’a-t-el!e pas qui font entièrement
étrangères à la fculpture? cette facilité
de produire l’ illufion par le coloris, eft
elle-même une très-grande difficulté; la rareté
de ce talent neffe prouve que tropi Autant
d’objets que le peintre a de plus à repréfenter
que le fculpteur, autant d’études particulières.
L’ imitation vraie des ciels, des eaux, des pay fiâmes
des oiftërens inftans du jour, des effets
variés de la lumière , & la loi de n’éçlairer un
tableau que par un feul fo le il, ^exigent des
connoiflances Sc des travaux néceffàires au
peintre, dont le fculpteur eft entièrement dif
penfé ( ï ) . Quoiqu’ il y ait des études & des
travaux qui appartiennent èxclufivemerità cha-
( i ) Le s corps &. les rayons de la lumière agijfeht
iontinuellèment les Uns fu r les autres ; les corps fu r les
rayons de lumière, en lés laüçaht, les réfiechijfànt & les
réfractant ; & tes rayons de lumière fu r lès corps, en les
‘échauffant, '& en donnant à leurs parties un mouvement
de vibration , ère.
' Voilà ce qu’oBferye le grand Newton fur les effets
'de la lumière ; 8c c’eft préciféihént ce què de grands
peintres Venus avant lui , àvoient obfervé & pratiqué.-
Ils n’ont dû cèt objet important de l’art a aucun pfiil.p- )
fopHe ; ■ & la plûpavt de ceux qui l’ont fûpcriêurêmènt j
exécuté n’auroiënt pas fu lire Newton. M a ïs 'comme
lui ils lifoient la nature : l?un l’é crivit, les autres la j
peignirent. Ainfi quand on vous dira que le philofbphe |
tient le feeptre qui doit régir les arts , 8c que ce fçeptre j
jie doit jamais forcir de fes ma ins, exceptez-en l^pein- j
J f is . {Note de VAuteur.)
cun des deux arts, ce ferait ne les pas con-î
noître que de nier leurs rapports. Ce ferait un»
erreur, fi on donnoit quelque préférence à l’un
aux dépens de l’autre, a caufe de leurs difficultés
particulières.
La peinture eft encore agréable, même lorf-
qu’elle eft dépourvue de l’enthoufiafme & du
génie qui la cara&érifent; mais fans l’appui de
ces deux bafes, les produ&ions de la fculpture
font infipides. Que le génie les infpire également
, rien n’empêchera qu’elles ne foient dans
la plus intime union, malgré les différences
qu il y a dans quelques-unes de leurs marches.
Si ces arts ne font pas femblables en tout, il
y a toujours la reffemblance de famille (à ) .
Appuyons donc là deffus, c’eft l’intérêt de»
arts. Appuyons-y encore , pour éclairer ceux
qui en jugent fans en connoîtrp les principes,
ce qui arrive fouvent, même à des efprits d»
premier ordre. Pour ne rien dire de nos littérateurs
modernes, fouvenons-nous que Plutarque
en a méconnu les rapports quand il a
écrit : « On peut tranfporter à la danfe ce que
» Simonide a dit de la peinture, & dire que
» la danfe eft une poéfie muette, & la poéfie
>* une danfe parlante ; car affurément la pein-
» ture ne fe fert point du fecours de la poéfie ,
» ni la poéfie de celui de la peinture; elles
>j n’ëmpruntent abfolument rien l’ une de l’autre,
» tandis que l’orcheftique & la poétique on*
» une entière affinités & une intimité par-
» faite (a ) ».
Si c’eft là ce que Plutarque a voulu dire ,
on peut demander qu’elle forte de peinture il
v o y o it, qu quelles étoient fes connoiffattees
dans l ’are, Aucun tableau ne lui faifoit-il ap-
percevoir le picloribus atquepoètis, & Ÿut pic»
(a) Fades non omnibus lina,
on dlveifa tamen , qualem decet ejfe forcrum.
O v id . Met. lib. IL
Je n’avois pas encore lu V afari, quand j ’écrivois ce*
Réflexions; §c depuis j’ai vu q u e , iur le parallèle des
deux arts , mon opinion eft entièrement la fienne : le
lëfteur peut en juger.
« Dico adunque, che la fcultura e la pittura. . . non
» precedonô i’ una all’ aitra , fe non quanto la virtù t
yi la Forza di colbro che le portano aadolTo, f à paflare
» l’ uno artefice innânzi ail* altro ; non per differenza »
<if grado di nobiltà che veramente fi trovi infra di loro.
» E febbene pèr la diverfità della éflenza loro , lianno
» moite agevolezze : non fono elléno perô ne tanto
» ne di mandera , ch:’ elle bon vengano giuftamente
# contrapêflate infieme ; e non fi conofca la paflïone
» 6 là caparbretà, piu tôfto che il ju d ic io , di d u ruble
» ehe 1’ una avanzi 1’ aitra. La onde a ragione fi pnè
» d ir e , che un’ anima mede-fima regia due corpi : ed
# io perquéfto cbnchiiîdo, che male fanno colo ro, che
# s’ ingegïiano di difunirle ,'-o' di fepararle 1’ una dàjl’
» aitra ». Proémto delV opera. ( Note de l'Auteur, )
(3) Plut* ch. Sympof, J*. I X , Qucft. 15.
Vktai poefis e r ît ïil y a quelque apparence qu’ îl
ne fentoit pas que l ’art dev créer une feene
fur la toile avec des perfonnages qu’il faut aufti
créer avant de les repréfenter, tient bien autant,
pour le moins, à la poétique, que l’ art
de dire à des hommes déjà faits à*cet exercice ,
fgure\ de telle ou telle manière. I l eft vifible
que Plutarque a confondu l’attitude du modèle
avec le g én ie , l’ étude avec le talent du
Peintre, qui a peu fait quand il a imaginé fa
fçene & placé fes modèles, s’ il n’a le grand
art de les bien rendre; car aucun de fes personnages
ne fait faire un pas: il eft lui-même,
& lui feul, le maître, le décorateur & tous les
figurons de fon ballet.
Quoiqu’ il en foit, il femble que l ’honneur
de la peinture ancienne & la raifon demandent
qu’on s’en rapporte plutôt au poëte Simo-
nide qu’au littérateur, au philofophe Plutarque.
C ’eft au refte une difeuffion de f?ntiment fur
laquelle je m’en rapporte à l’homme de gôut,
au connoiffeur & à l’artifte. Ce n’eft pas qu’ au
premier chapitre du traité, comment il faut lire
les poètes, Plutarque ne dife : la poéfie ejl uti
art d'imitation, & une fcience correfpondante
à la peinture, & qu’ il n’enfeigne au jeune
homme*qu’ il veut inftruire, cette règle du goût,
qui eft, dit-il, dans la bouche de tout Je monde:
la poéfie *éfl une peinture parlante, & la pein-
tiire une poéfie muette. D’où nous voyons jufi-
qu’ à quel point les hommes d’un très-grand mér
ite , font fournis à la contradiélion & à l’erreur.
S i , par une erreur dont on voit heureufe-
ment peu d’exemples, un Sculpteur alloit prendre
pour de l’enthoufiafme & du génie , cette
fougue déraifonnée qui emportoit Borromini &
JMeyffonier ; qu’ il foit perfuadé que de pareils
écarts., loin d’embellir les objéts , les éloignent
du v ra i, & ne fervent qu’ à repréfenter 1rs défor-
dresjde l’ imagination. Quoique ces deux Arriftés
ne fuffenr pas Sculpteurs , ils peuvent être cités
comme des exemples dangereux , parce que le
même efprit qui conduit l’Architeéle , conduit
aufti le Peintre & fle Sculpteur. L’ Artifte,
dont les movens font fimpies , eft à découvert ;
il s’ expofe à être jugé d’autant plus aifément,
qu’ il n’ emploie aucun vain preftige pour
échapper à l’examen , & fouvent mafquer ainfi
fa non-valeur. N’appelions donc point beautés,
dans que'que ouvrage que ce foit , ce qui ne -
ferait qu’éblouir les yeux & tendrait à corrompre
le goût. Ce goût , fi va»té avec raifort
dans les productions de l’ efprit humain , j
me paroît en général le réfultat de ce qu’o- j
.pere .le .ben Cens fur nos.idées trop vives , il <
fait les réduire , leur donner un frein : trop !
languiffantes, il fait les animer. C’eft à cet j
heureux tempérament, que la fculpture , ainfi x
q te tous les ari$ inyantés pour plaire , doit Xes
vraies bèautés ; les feules qui foient durables.
Comme la fculpture comporte la plus rigide
exactitude , un defïin négligé y ferait moins
fupportable que dans la peinture. Ce n’eft pas à
dire que Raphaël & le Dominiquin n’ayent été
de très-corre&s&très-favans deffinateurs, 8c qu®
tous les grands Peintres ne regardent cette partie
comme effentielle à l’Art : mais à la rigueur
, un tableau où elle ne dominerait pas ,
pourrait intéreffçr encore par d’autres beautés.
La preuve en eft dans quelques femmes peintes
par Rubens , qui , malgré le caractère flamand
& peu corred , fédûiront toujours par le
charme du coloris. Exécutez-les en fculpture
fur le même caractère de defïin , le charme
fera confidérablement diminué , s’ il n’eft entièrement
détruit. L’ effai fëroit bien pire fur
quelques figures de Rembrand,
Pourquoi eft-il encore moins permis ao.
fculpteur qu’au peintre , de négliger quelques
unes des*parties de fon art ? Cela tiens
peut-être à trois confidérations : au tems que
l’artifte donne à fon ouvrage ; nous ne pouv
vons fupporter qu’un homme ait employé de
longues années a ffaire une chofe commune :
au prix de la matière employée ; quelle corn-
’ paratfon d’ un morceau de toile à un bloc de
majrbre ! à la durée de l’ouvrage ; tout ce qui.
eft autour du marbre s’ anéantit , mais le
marbre refte. BriC. es même , fes pièces portent
encore aux fièeles à venir de quoi louer ou
blâmer.
Après avoir indiqué l ’objet & le fyftême
général de la fculpture, on doit la confidérer
encore comme foumife à des loix particulières ,
qui doivent être connues de l’artifte, pour ne
pas les enfreindre , ni les étendre au-delà de
leurs limites.
Ce ferait trop étendre ces loix , fi on difoît
que la fculpture ne peut fe livrer à l ’effor
dans fes eompofitions , par la contrainte où elle
eft de fe fou mettre aux dimenfions d’ un bloc
de marbre. Il ne faut que voir 1 q Gladiateur
& VAtalante ,• ces figures grecques prouvent
affez que le marbre obéit, quand le fculpteur
fait lui commander.
Mais cetre liberté que le fculpteur a , pour
ainfi dire, de faire croître le marbre, ne doit
pas aller jul'qu’ à embarraffer les formes extérieures
de fes figures par des détails excédans
& contraires à l’a&ion & au mouvement re pré-
fentes. Il faut que l’ouvrage fe détachant
fur un fond d’air , ou d’ arbre , ou d’ archi-
teclure , s’annonce fans équivoque du plus
loin qu’ i ! pourra fe diftinguer. Les lumières
& les ombres , largement diftrlbuées , concourront
pufli à déterminer les principales
formés.& l ’effet général. A quelque diftance
que s’àpperçoivent l’Apollon- 8c le Gladiateur
5 lenr. ^âion n’eft point douteufe.