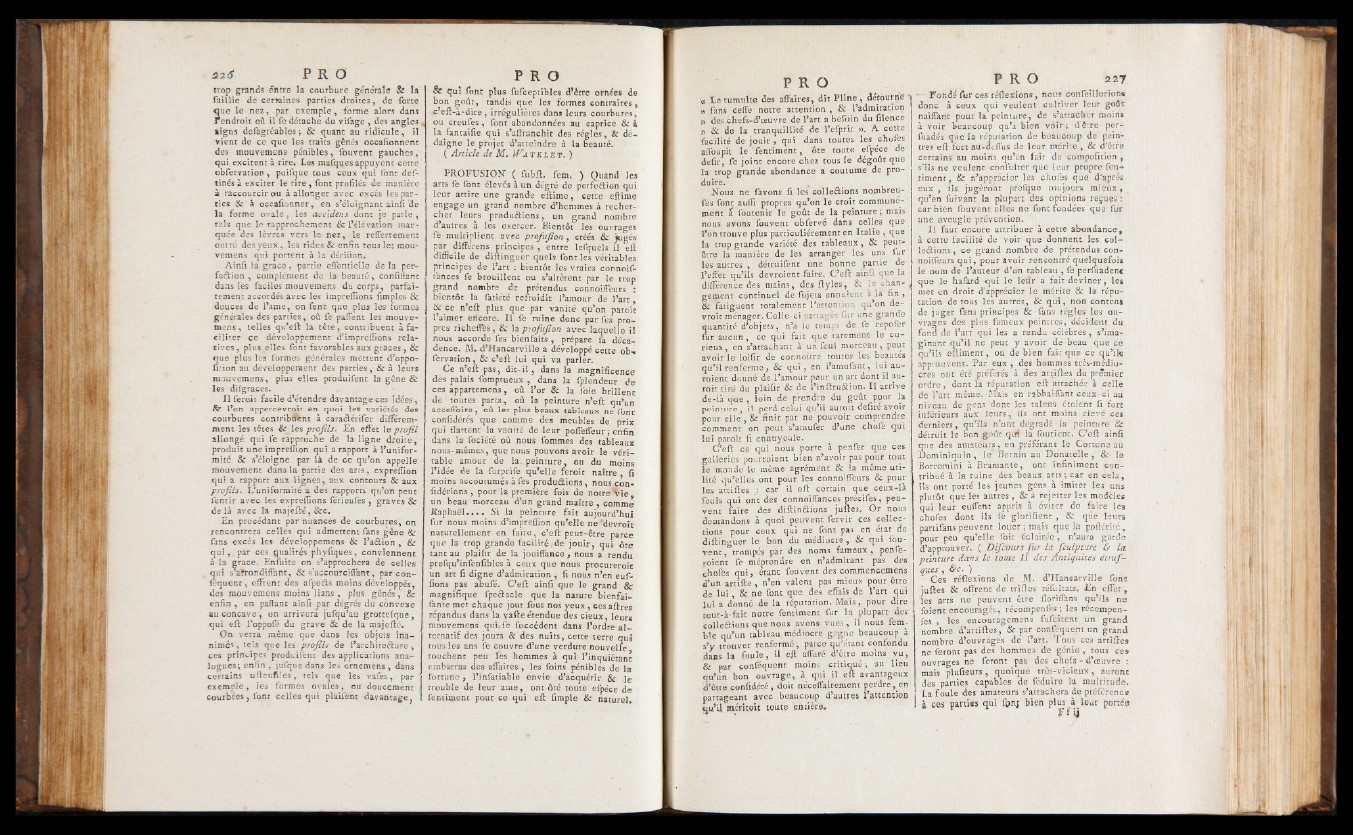
trop grands entre la courbure générale & la
faillie de certaines parties droites , de forte
ue le nex, par exemple, forme alors dans
endroit où il fe détache du vifage , des angles *
aigus defagréables -, & quant au rid icule, il
vient de ce que les traits gênés occafionnent
des mouvemens pénibles, fouvent gauches,
qui excitent à rire. Les mafques appuyent cette
obfervation , puifque tous ceux qui font def-
tinés à exciter le rire , font profilés de manière
à raccourcir ou à allonger avec excès les parties
& à oçcafionner, en s’éloignant ainfi'de
la forme o v a le , les accïdens dont je parle ,
tels que le rapprochement & l’élévation marquée
des lèvres vers le nez, le refferrement
outré des y e u x , lés rides & enfin tous les mouvemens
qui portent à la dérifion.
Ainfi la g râ ce , partie effentielle de la per-
feélion , complément de la beauté, confmant
dans les faciles mouvemens du corps, parfaitement
accordés avec les impreflions fimples &
douces de l’ame, on fent que plus les formes.
générales des parties, où fe paffent les mouvemens
, telles qu’eft la tê te , contribuent à faciliter
ce développement d’impreflions relatives
, plus .elles font favorables aux grâces , &
que plus les formes générales mettent d’oppo-
firion au développement des parties, & à leurs
mouvemens, plus elles produifent la gêne &
les difgraces.
I l feroit facile d’étendre davantage ces idées,
& l’on appercevroit en quoi les variétés des
courbures contribuent à caradérifer différemment
les têtes & les profils. En effet le profil
allongé qui fe rapproche de la ligne droite,
produit une impreflion qui a rapport à l’uniformité
& s’éloigne par là de ce qu’on appelle
mouvement dans la partie des arts, expreflion
qui a rapport aux lignes, aux contours & aux
profils. L’uniformité a des rapports qu’on peut
fentir avec les expreffions férieufes , graves &
de là avec la majefté, & c .
En procédant par nuances de courbures^ on
rencontrera celles qui admettent fans gêne &
fans excès les développemens & l’aétion , &
q u i, par ces qualités phyfiques, conviennent,
à la grâce. Enfuite on s’approchera de celles
qui s’arrondiffant, & s’accourciffant, par confisquent,
offrent des afpecls moins développés,
des mouvemens moins lians , plus gênés, &
enfin , en paflant ainfi par dégrés du convexe
au concave , on arrivera jufqu’ au grotteique,
qui eft l’oppofé du grave & de la majefté.
On verra même que dans les objets inanimés
, tels que les profils de l’architeélure ,
ces principes produifent des applications analogues;
enfin, jufque dans les ornemens , dans
certains uftenfiîes, tels que les vafes, par
exemple, les formes ovales, ou doucement
courbées, font celles qui plaifent davantage,
& qui font plus fufceptibles d’être ornées de
bon goût, tandis que les formes contraires,
•c’eft-à-dire, irrégulières dans leurs courbures,
ou creufes, font abandonnées au caprice & à
la fantaifie qui s’affranchit des régies, & dédaigne
le projet d’atteindre à la beauté.
( Article de M. VfrAt e l e t . )
PROFUSION ( fubft. fem. ) Quand les
arts fe font élevés à un degré de perfeélion qui
leur attire une grande eftime, cette eftime
engage un grand nombre d’hemmes à rechercher
leurs produâions, un grand nombre
d’autres à les exercer. Bientôt les ouvrages
fe multiplient avec profufion, créés & jMgés
par différens principes , entre lefquels il eft
difficile de diftinguer quels font les véritables
principes de l’art : bientôt les vraies connoif-
îànces fe brouillent ou s’altèrent par le trop
grand nombre de prétendus connoiffeurs :
bientôt la fatiété refroidit l’amour de l’a r t ,
& ce n’eft plus que par vanité qu’on paroît
l’aimer encore. I l fe ruine donc par fes propres
richeflhs , & la piofufion avec laquelle il
nous accorde fes bienfaits, prépare fa décadence.
M. d’Hancarville a développé cette ob-«
fervation, & c’eft lui qui va parler.
Ce n’eft pas, d it - il, dans la magnificence
des palais Comptueux , dans la fplendeur de
ces appartemens, où l ’or & la foie brillent
de toutes parts, où la peinture h’eft qu’ un
acceffoire, où les plus beaux tableaux ne font
confidérés que comme des meubles de prix
qui flattent la vanité de leur poffeffeur; enfin
dans la lociété où nous fommes des tableaux
nous-mêmes, que nous pouvons avoir le véritable
amour de là. peinture, ou du moins
l’ idée de la furprife qu’ elle feroit naître , fi
moins accoutumés à fes produ&ions, nous con-
fidérions , pour la première fois de notre ^ ie
un beau morceau d’ un grand maître , comme
.Raphaël.... Si la peinture fait aujourd’hui
fur nous moins d’impreflion qu’ elle ne'devroit
naturellement en faire, c’eft peut-être parce
que la trop grande fac ilitétde jouir, qui ôte
tant au plaifir de la jouiffance , nous a rendu
prefqu’ infenfibles à ceux que nous procureroit
un art fi digne d’admiration , fi nous n’en euf-
fions pas abufé. C’eft ainfi que le grand &
magnifique fpeétacle que la nature bienfai-
fante met chaque jour fous nos y eu x , ces aftres
répandus dans la vafte étendue des cieux, leurs
| mouvemens qui.fe fuccédent dans l’ordre alternatif
des jours & des nuits, cette terre qui
tous les ans fe couvre d’une verdure nouvelle
touchent peu fes hommes à qui l ’inquiétanc
embarras des affaires , les foins pénibles de la
fortune, l’ infatiable envie d’acquérir & j e
trouble de leur ame, ont ôté toute efpéce de
fentimeiK pour ce qui eft fimple & naturel.
« Le tumulte des affaires, dit P lin e , détourne ’i
» fans ceffe notre attention , & l’admiration
» des chefs-d’oeuvre de l’ art a befoin du filence
» & de la tranquillité de l’efprit ». A cette
facilité de jouir , qui dans toutes les chofes
affoupit l e .Tendaient, ôte toute efpéce de
defir, fe joint encore chez tous le dégoût que
la trop grande abondance a coutume de produire.
Nous ne favons fi les colleéiions noinbreu-
fes font aufli propres qu’on le croit communément
à foutenir le goût de la peinture; mais
nous avons fouvent obfervé dans celles que
Pon trouve plus particuliérement en Italie , que
la trop grande variété des tableaux, & peur-
être la manière de les arranger les uns fur
les autres , détruifent une bonne partie de
l ’effet qu’ ils devroient faire. C’eft ainfi que la
différence des mains, des ftyle s, & le chan- .
geip.cnt continuel de fujets ennuient à là fin*
& fatiguent totalement l’attention qu’on de-
vroit ménager. Celle-ci partagée fur une grande
quantité d’objets, n’a le temps de fe repofer
fur aucun, ce qui fait que rarement* le curieux,
en s’attachant à un feul morceau, peut
avoir le loifir de connoîcre toutes les beautés
qu’ il renferme j & q u i, en l’ amufant, lui au-
roient donné de.i’amour pour un art dont il au-
roit tiré du plaifir & de i’ inftruétion. I l arrive
de-là que , loin de prendre du goût pour la
peinture, il perd celui-qu’ il auroit defireavoir
pour elle , & finit par ne pouvoir comprendre
comment on peut s’amufer d’ une chofe qui
lui paroît fi ennnyeufe.
C’eft ce- qui nous porte à penfer que ces
g aller Les pourroient bien n’avoir pas pouf tout
le monde le même agrément & la même utilité
qu’elles ont pour les connoiffeurs & pour
les artiftes ;. car il eft certain que ceux-là
feuls qui ont des connoiffances précifes, peuvent
faire des diftinélions jultes» Or nous
demandons à quoi peuvent fervir ces collections
pour ceux qui ne font pas en etat^ de
diftinguer le bon du médiocre, & qui fouvent
, trompés par des noms fameux, penfe-
roient fe méprendre en n’admirant pas des
chofes q ui, étant fouvent des commencemens
d’ un artifte, n’ en valent pas mieux pour être
de lu i , & ne font que des effais de l’art qui
lui a donné de la réputation. Mais, pour dire
tout-à-fait notre fentiment fur la plupart des
çolleélions que nous avons vues , il nous fem-
ble qu’ un tableau médiocre gagne beaucoup à
s’y trouver renfermé , parce qu’étant confondu
dans la foule, il eft affuré d’ être moins vu ,
& par çonféquent moins critiqué; au lieu
qu’un bon ouvrage, à qui il elt avantageux
d’ être çonfid^ré, doit néceffairement perdre, en
partageant avec beaucoup d’autres l’attentiojci
gu’U jn,éritoit toute entière.
- • Fondé fur ces réflexions, nous confeillerion«
donc à ceux qui veulent cultiver leur goût
naiffant pour la peinture, de s’attacher moins
à voir beaucoup qu’à bien vo ir ; dètre per-
fuadés que la réputation de beaucoup de peintres
eft fort au-dtffus de leur mérite , & d’être
certains au moins qu’ en fait de compofition ,
s’ils ne veulent confulter que leur propre fen>
timent, & n’apprécier les chofes que d'après
eux , ils jugèrent prefque toujours mieux,
qu’en fuivant la plupart des opinions reçues :
car bien fouvent elles ne font fondées que fur
une aveugle prévention.
U faut encore attribuer à cette abondance,
à cette facilité de voir que donnent, les collections,
ce ,grand nombre de prétendus connoiffeurs
q ui, pour avoir rencontré quelquefois
le nom de l’auteur d’ un tableau , fe perfuadenc
que le hafard <jui le leiîr a fait deviner, les
met en droit d’apprécier le mérite & la réputation
de tous les autres, & qui* non contens
de juger fans principes & fans régies lès ouvrages
des plus fameux peintres, décident du
fond de l’art qui les a rendu célèbres, s’imaginant
qu’ il ne peut y avoir de beau que ce
qu’ ils elliment, ou de bien fait que ce qu’ ils
approuvent. Par e u x , des hommes très-médiocres
ont été préférés à des arçiftes du premier
ordre, dont la réputation eft attachée à celle
de l’ art même. Mais en rabbaîffant ceux-ci au
niveau de gens dont les talens étoient fi fort
inférieurs aux leurs, ils ont moins élevé c es
derniers, qu’ ils n’ont dégradé la peinture &
détruit le boa,goût qui la foutient. C’eft ainfi
que des amateurs, en préférant le Corrone au
Dominiquin, le Bernin au Donateile , &- la
Borromini à Bramante, ont infiniment contribué
à la ruine des beaux arts; car en cela,
ils ont porté les jeunes gens à imiter les uns
plutôt que les autres, & à rejetter Iss modèles
qui leur euffent appris à éviter de faire les
chofes dont ils fe glorifient , & que leurs
partifans peuvent louer ; mais que la poflérité,
pour peu qu’elle Toit éclairée, n’ aura garde
d’approuver. ( D i f cour s fur lu fculpture & lu
peinture dans le tome IL des Antiquités étruf -
ques , &c. )
Ces réflexions de M. d’Hanearville font
juftes & offrent de triftes réfultats. En e ffet,
les arts ne peuvent être floriffans qu’ ils ne
foient encouragés, récompenfés ; les récompen-
fes , les encouragemens fufeitent un grand
nombre d’artiftes, & par çonféquent un grand
nombre d’ouvrages de l’ art. Tous ces artiftes
ne feront pas des hommes de génie , tous ces
ouvrages ne feront pas des chefs - d’oeuvre :
mais plufieurs, quoique très-vicieux, auront
des parties capables de féduire la multitude.
La foule des amateurs s’attachera de préférence
à ces parties qui fonj bien plus ^ leur portée