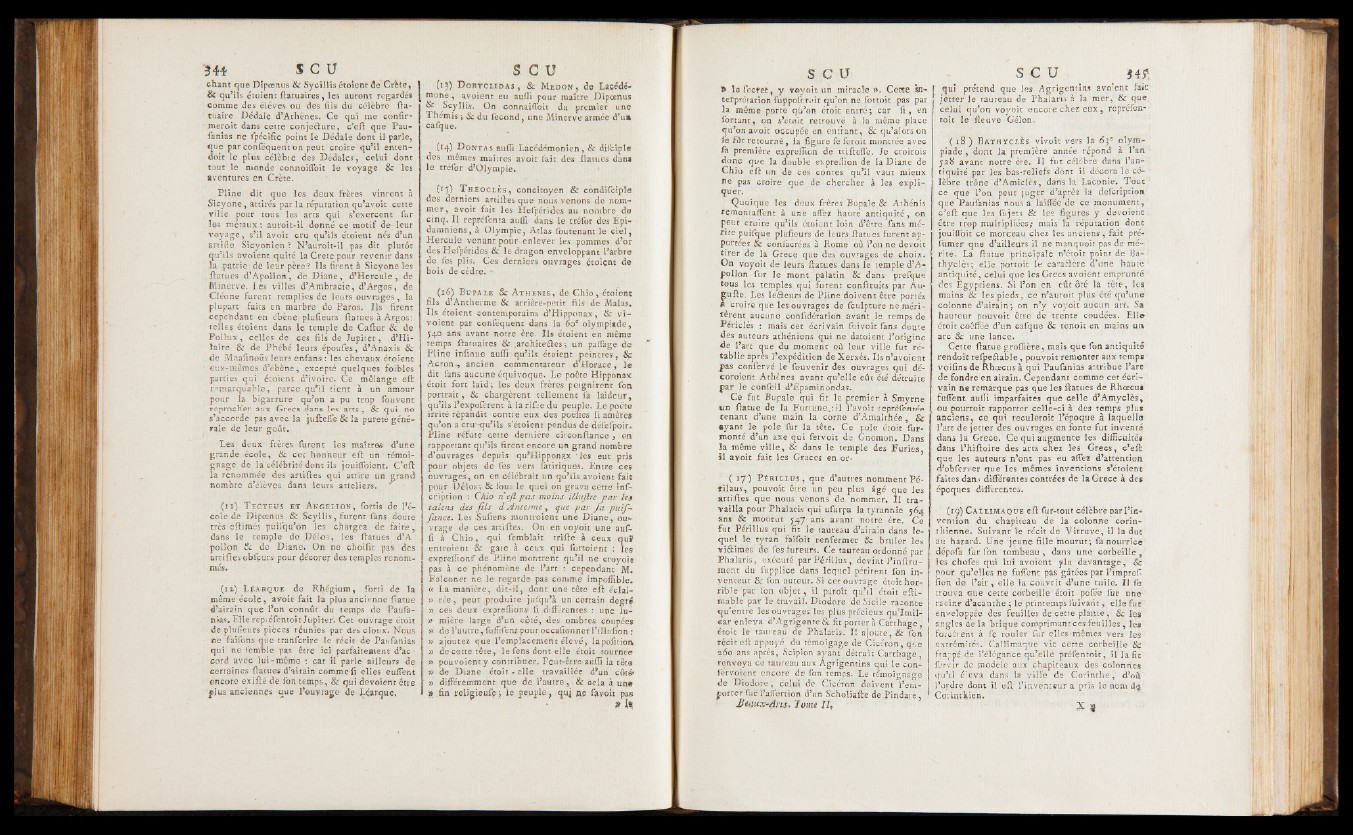
'344; S C U
ch a n t q u e Dïpcem is & S y c illis éto ien t d e C rète,
& qu’ils éto ie n t fta tu a ires, le s auront regardés
com m e d es élèv es ou des fils du célèb re fta-
tu a ire D éd ale d’A th èn es. C e q u i m e con fir-
m e r o it dans c e tte c o n je c tu r e , c’e ft q u e P a u -
fan ias n e Jpécifie point le D éd a le dont il parle,
q u e par co n féq u en t on peut croire qu’il e n te n -
d o it le plus célèb re des D é d a le s , c e lu i dont
to u t le m o n d e con n oiffoit l e v o y a g e & lés
a ven tu res en C rète.
P lin e d it q u e le s d eu x frères v in ren t à
S ic y o rie , attirés par la réputation qu’a v o it c ette
v ille pour tous les arts q u i s’e x ercen t fur
le s m é ta u x : a u ro it-il d on né ce m o tif de leu r
v o y a g e , s’il a v o it cru qu’ils éto ien t nés d’un
arrifle S ic y o n ie n ? N ’a u roit-il pas d it p lutôt
qu’ils a v o ie n t q u ité la C rete pour rev en ir dans
la patrie d e leu r père? Ils firen t à S icy o n e les
ftatu es d’A p o llo n , d e D ia n e , d’H e r c u le , de
M in erve. Les v ille s d’A m b ra cie, d’A r g o s , de
C léo n e fu ren t rem p lies de leu rs o u v r a g e s , la
plupart faits en m arbre de P aros. Ils firent
cep en d a n t en éb èn e plufiëurs ftatu es à A rg os:,
te lle s éto ien t dans le tem p le d e C aftor & de
P o llu x , c e lle s de ce s fils de J u p iter, d’H i-
la ir e & de P h éb é leu rs ép o u fes, d’A n ax is &
d e M nafinoüs leurs enfan s : les ch ev a u x éto ien t
' eu x -m êm es d’é b è n e , excep té q u elq u es fo ib les
parties q u i éto ie n t d’iv o ire. C e m éla n g e eft
r em a rq u a b le, parce q u 'il tie n t à un amour
pour la bigarru re q u ’on a pu trop fou ven t
reproçh'er aux G recs dans les a r ts, & q u i ne
s’a cco rd e pas a v e c la ju ftefie & la pureté g én érale
d e leu r g o û t.
L es d eu x frères furen t le s m aîtres d’une
g ra n d e é c o le , 8t c e t h on neur e ft un tém oig
n a g e d e la célébrité don t ils jou iffoien t. Ç*eft
la ren om m ée des a rtiftes q u i attire un grand
n om bre d’élèv es dans leu rs a tteliers. y -
(11) T e c t e u s e t A n g e i i o n , fiortis d e l’éc
o le de D iposnus & S c y llis , fu ren t fans doute
très-eftim és p uifqu’on les ch a rg ea d e fa ir e ,
dans le tem p le d e D e l o s , le s ftatu es d’A
p o llo n & d e D ia n e . O n n e ch o îfit pas des
a rtiftes o bfçu rs pour décorer des tem p les ren om m
és.
(12) L é a r q u e de R h é g iu m , forti d e la
m êm e é c o le , a v o it fa it la plus a n cien n e ftatu e
d ’airain q u e l’on con n û t du tem ps de Paufa-
n ias. E lle repi éfen to it J upiter. C et o u vra ge étroit
d e plufiëurs p ièces réun ies par des d o u x . N o u s
n e faifons q u e tranfcrire le récit d e Paufanias
q u i ne fem b le pas être ic i parfaitem ent d’ac*
. çord a v e c lu i-m êm e : car il parle a illeu rs de
certain es ftatu es d’airain com m e fi e lle s enflen t
en co re e x ifté de fon tem p s, & q u i d év o ien t être
p lu s a n cien n es q u e l’o u vra ge de Léarque,
s c u (13) Doryclidas, & Medon, de tacéd4-
mone, avoient eu aufii pour maître Dipoenus
& Scyllis. On connaifioit du premier une
Thémis ; & du fécond, une Minerve armée d’ un
cafque.
(14) D ontas aufii Lacédémonien, & difcipl®
des mêmes maîtres avoit fait des ftatues dan*
le tréfor d’Olympie.
(x5) T b éo c l è s , concitoyen & condifciple
des derniers artiftes que nous venons de nommer,
avoit fait les Hefpérides au nombre de
cinq. I l repréfenta aufii dans le tréfor des Épi—
damniens, à Olympie, Atlas foutenant le c ie l,
Hercule venant pour enlever les pommes d’or
des Hefpérides & le dragon enveloppant l’arbre
de fes plis. Ce^ derniers ouvrages étoient de
bois de cèdre. -
(16) B u pale & Athenis, de Chio , étoient
fils d’Antherme & arrière-petit fils' de Malas.
Ils étoient contemporains d’Hipponax, & v i-
voient par conféquent dans la 6oé olympiade,
540 ans avant notre ère. Ils étoient en même
temps ftatuaires & .architeâes; un pafiage de
Pline infinue aufii qu’ ils étoient peintres, &
Acron., ancien commentateur d’Horace, le
dit fans aucune équivoque. Le poète Hipponax
étoit fort laid; les deux frères peignirent fou
portrait, & chargèrent tellement fia laideur,
qu’ils l’expofèrent à la rifte du peuple. Le poète
irrité répandit contre eux des poëfies fi amères
qu’on a cru-qu’ ils s’étoient pendus de défefpoir.
Pline réfute cette dernière circonftance j en
rapportant qu’ ils firent encore un grand nombre
d’ouvrages depuis qu’Hipponax les eut pris
pour objets de fies vers fiatiriques. Entre ces
ouvrages, on en célébrait un qu’ ils avoient faits
pour Délos; & fous le quel on grava cette inf-
cription : Chio n e f i pas moins illufire par les
talens des f ils dAnterme, que par fa puif-
fin c e . Les-Sufiens montroient une Diane, ou*:
vrage de ces artiftes. On en voyoit une aufi»
fi à C h io , qui femblait trifte à ceux quÿ
entroient & gaie à ceux qui fiortoient : les
expreflionf de Pline montrent qu’ il ne croyoia
pas à ce phénomène de l’art : cependant M.
F al eo net ne le regarde pas comme impofiible.
« La manière, d it- il, dont une tête eft éclai-
» rée, peut produire jufiqu’à un certain degré
» ces deux expreflions1- fi différentes • une lu-
» mière large d’un côté, des ombres coupées
» de l’autre, fuffifentpouroccafionnerl’illufion :
» ajoutez que l ’emplacement élevé, lapofitiôn.
» de cette tête, le fens dont elle étoit tournée
» pou voient y contribuer. Peutrêtre aufii la tête
» de Diane étoit - elle travaillée d’ un côté»
» différemment que de l’autre, & ©ela à un®
».fin religieufçj le peuple, quj flç ftyoit pas
S C U
é le f e e f e t , y V o y o it un m iracle » . C ette in terprétation
fuppoleriiit q u ’on n e fortoit pas par
la m êm e porte q ü ’on éto it entré ; car fi , en
fo r ta n t, on s’é te ît retrou vé à la m êm e place
q u ’on a v o it occu p ée en e n tr a n t, & q u ’a lo rso n
fie fû t reto u rn é, la fig u re fie feroit m ontrée a vec
la p rem ière exp refiion d e trifteffe. Je croirois
d o n c q u e la d o u b le exprefTion d e la D ia n e de
C h io e ft un d e ces co n tes qu’il vau t m ieu x
n e pas croire q u e d e ch erch er à le s e x p liq
u er.
Q u o iq u e les d eux frères Bu pale & A th én is
rçm on taflen t à u n e a fiez h a u te a n tiq u ité , on
p eu t croire qu’ils éto ien t lo in d’être fans m en
t e puifque plufiëurs de leu rs ftatu es fu ren t apportées
& con làcrées à R om e où l’on n e d ev o it
tirer d e la G rece q u e des o u vra ges d e c h o ix .
O n v o y o it de leu rs ftatu es dans le tem p le d’A p
o llo n fur le m o n t palatin & dans prefque
tou s les tem p les q u i fu ren t con ftru its par Au-
Ç u fte. Les lecteu rs d e P lin e d o iv en t être portés
croire q u e les o u vra ges d e fcu lp tu re n e m éritèren
t a u cu n e con fidération a van t le tem ps de
P ériclès : mais c e t écriv a in fui v o it fans d ou te
d es auteurs a th én ien s q u i n e d atoien t l ’o rigin e
d e l’art q u e du m om en t où leu r v ille fu t réta
b lie après l’exp éd ition d e X erx ès. I ls n ’a v o ien t
jpas con ferv é le fo u v en ir des ou vrages q u i dé-
co ro ien t A th èn es avan t qu’e lle eû t été d étruite
p ar le c o n feil d’E pam inondas.
C e fu t B upale q u i fit le prem ier à Sm yrn e
u n ftatu e d e la F o rtu n ea: il l’a v o it repréfentée
ten a n t d’une m ain la corn e d’A m a lth é e , &
a y a n t le p ô le fur la tête. C e p ôle étoit fur-
m o n té d ’un a xe q u i fervo it d e G nom on. D an s
la m êm e v ille , &: dans le tem p le des F u r ie s,
i l a v o it fa it les G râces en or-
( 17 ) P é r i l l u s , q u e d’autres n om m en t P é-
r ila u s, p o u vo it être un peu plus â gé q u e le s
a rtiftes q u e nous v en on s de, nom m er. IJ trav
a illa pour Ph alaris q u i ufurpa la tyran n ie 564
ans & m ourut 5 47 an s a va n t n otre ère. C e
fu t P érillu s q u i fit le taureau d’airain dans le q
u e l le tyran faifioit ren ferm er & b rû ler les
v i& im es d e fies fureurs. C e taureau ord on n é par
P h a la ris, exécu té par P é r illu s , d ev in t l’in ftru -
m e n t du fu p p lice dans le q u e l périrent lbn in v
en teu r & fon auteu r. Si c e t o u vra gé é te it horr
ib le par fon o b j e t , il paroît q u ’il éto it e fti-
m a b le par le trav ail. D io d o re d e S ic ile raconte
q u ’en tre les o u v ra g es'les plus p récieux qu ’Im il-
ear e n lev a d’A g r ig e n r e& fit portera C a rth a g e,
é to it le taureau d e P h alaris. Il a jo u te, & fon
récit e ft appuyé du tém o ig a g e d e C icéron , q;,e
2,60 ans après, Scipion ayant détruit C a rth a g e,
ren vo y a ce taureau aux A g rig en tin s q u i le co n -
fiervoient en core d e fon tem ps. L e tém o ig n ag e
d e D io d o r e , c e lu i d e C icéron d o iv en t l’em -
jporter fur l’affertion d’un S ch o iia fte d e P in d a re,
Jome U f
s c u qui prétend que les Agrigentins avoient fait
jetter le taureau de Phalaris à la mer, & que
celui qu’on voyoit encore chez eu x , repréfen-
toit le fleuve Gélon.
( 18 ) B a th y c l è s vivoît vers la 63e olympiade
, dont la première année répond à 1 an
528 avant notre ère. I l fut célèbre dans l’antiquité
par les bas-reliefs dônt il décora le célèbre
trône d’Amiclcs, dans la Laconie. Tout ’
ce que l’on peut juger d’après la defeription
que Paufanias nous a laiffée de ce monument,
c'eft que les fujets & les figures y devôienc
être trop multipliées,* mais la réputation dont
jouifloit ce morceau chez les anciens, fait pré-
lumer qne d’ ailleurs il ne manquoit pas de mérite.
La ftatue principale n’étoic point de Bathyclès;
elle portoit le cavaélère d’ une haute '
antiquité, celui que les Grecs avoient emprunté
des Egyptiens. Si l’on en eût ôté la tête, les
mains & les pieds, cé n’auroit plus été qu’ une
colonne d’airain; on n’y voyoit aucun art-. Sa
haureur pouvoit être de trente coudées. E lle
étoit coêffée d’un cafque & tenoit en mains ur*
arc & une lance.
Cette ftatue grofiière, mais que fon antiquité
rendoit refpeâable , pouvoit remonter aux temps
voifinsde Rhoecusà qui Paufanias attribue l’are
de fondre en airain. Cependant comme cet écrivain
ne remarque pas que les ftatues de Rhoecus
fuflent aulfi imparfaites que celle d’Amyclès,
ou pourroit rapporter celle-ci à des temps plus
anciens, ce qui reculeroit l ’époque à laquelle
l’art de jetter des ouvrages en fonte fut inventé
dans la Grece. Ce qui augmente les difficultés
dans l ’hiftoire des arts chez les Grecs, c’eft
que les auteurs n’ont pas eu affez d’attention
d’obferver que les mêmes inventions s’étoienc
faites dan> différentes contrées de la Grece à des
époques différentes.
- (19) C aleimaque eft fur-tout célèbre par l ’invention
du chapiteau de la colonne corinthienne.
Suivant le récit de Vitruve , il la duc
au hazard. Une jeune fille mourut; fa nourrice
dépofa fur fon tombeau , dans une corbeille ,
les chofes qui lui avoient plu davantage, &
pour qu’elles ne fuflent pas gâtées par l’impref
fion de l’ a ir , elle la couvrit d’ une tuile. I l fe.
trouva que cette corbeille étoit pofée fur une
rscine d’acanthe ; le printemps fuivant, elle fut
enveloppée des feuilles de cette plante, & les
angles de la brique comprimant ces feuilles , les
forcèrent à fe rouler fur e.lles-mêmes vers les
extrémités. Callimaque v it cette corbeillè &
frappé de l’élégance qu’ elle préfentoit, il la fit
fcTvir de modèle aux chapiteaux des colonnes
qu’ il éleva dans la v ille de Corinthe, d’où
l’ordre dont il eft l’ inventeur a pris le nom d$
Corinthien.