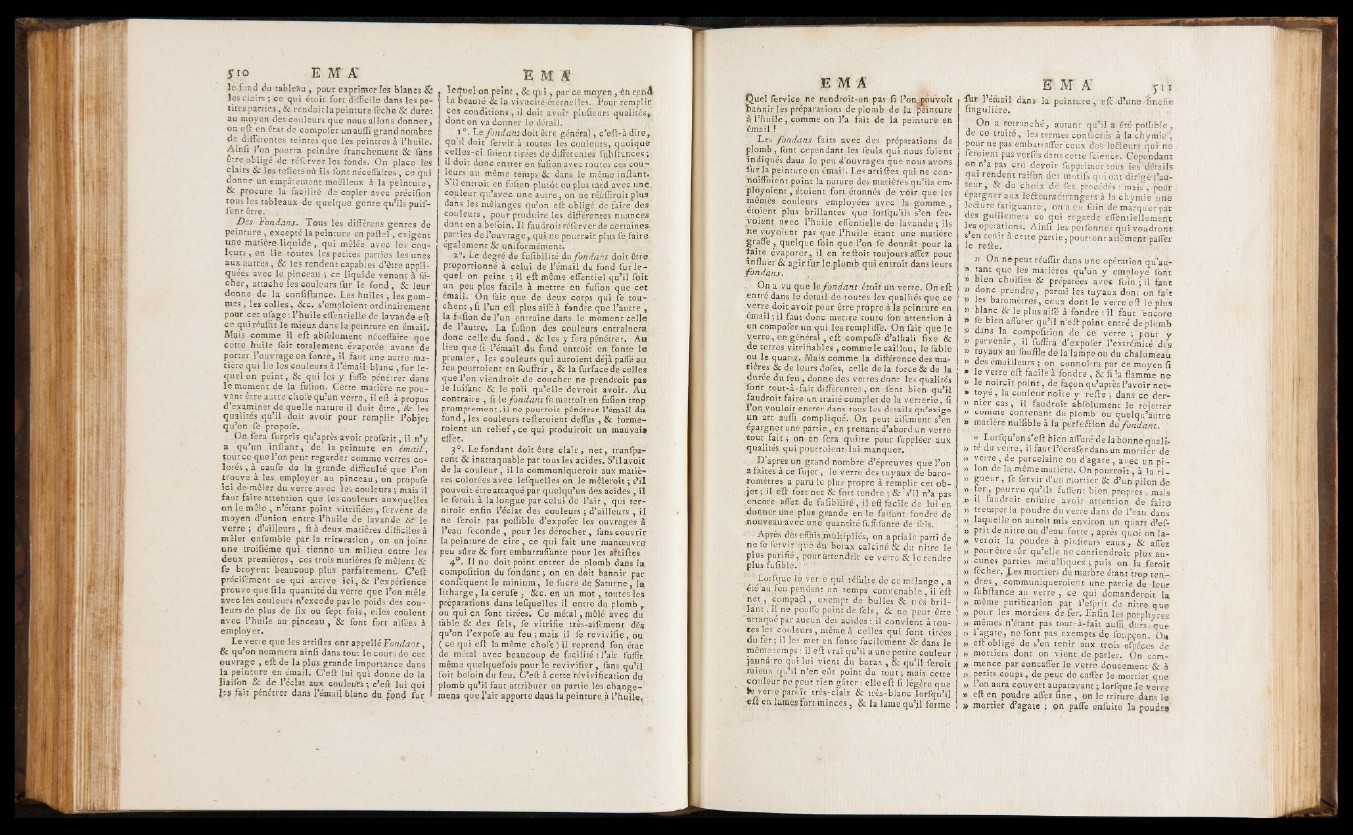
ESTAT
le fond du tableau , pour exprimer les blancs
les clairs ; ce qui étoit fort difficile dans les petites
parties, & rendoitla peinture leche 8c dure:
au moyen des couleurs que nous allons donner/
on eft en état de compofer un auffi grand nombre
de différentes teintes que les peintres à l’huile.
Ainfi l’on pourra peindre franchement & fans
être obligé de réferver les fonds. On place les
clairs è£. lps reflets où ils fopt néceffaires, ce qui
donne un empâtement moelleux à la peinture,
& procure la facilité de copier avec précifion
tous les tableaux de quelque genre qu’ ils puif-
fent être. y
I)ss Fondans. Tous les différens genres de
peinture , excepté la peinture en paftel, exigent
une matière liqu id e , qui mêlée avec les cou- ,
leurs , en lie toutes les petites parties les unes
aux autres , & les rendent capables d’être appli- ;
quées avec le pinceau ; ce liquide venant à fé-
cher, attache les couleurs fur le fond, & leur'
donne de la confiftance. Les huiles , les gommes,
les colles, & c . s’emploient ordinairement
pour cet ufage: l’huile effentielle de lavande eft
ce quiréuffic le mieux dans la peinture en émail.
Mais comme il eft abfolument néceffaire que
Cette huile foit totalement évaporée avant de
porter l’ouvrage en fonte,-il faut une autre matière
qui lie les couleurs à l’émail blanc , fur lequel
on peint, & qui les y faffe pénétrer dans
le moment de la fulion. Cette matière ne pouvant
être autre chofe qu’ un verre, il eft à propos
d’examiner de quelle nature il doit être, & des
qualités qu’il doit avoir pour remplir l’objet
qu’on fe propofe.
On fera furpris qu’après avoir proferit, il n’y
a qu’un inftant, de la peinture en émail,
tout ce que l’ on peut regarder comme verres colorés
, à caufe de la grande difficulté que l’ on
trouve à les employer au pinceau, on propofe
ici de-mêler du verre avec les couleurs ; mais il
faut faire attention que les couleurs auxquelles
ori le mêle , n’étant point vitrifiées, fervent de
moyen d’union entre l’ huile de lavande të* le
verre ; d’ailjeurs , fl à deux matières difficiles à
mêler enfembie parla trituration, on enjoint
une troifiéme qui tienne un milieu entre les
deux premières, ces trois matières fe mêlent 8c
fe broyent beaucoup plus parfairement. C’eft
précifément ce qui arrive ic i, & l’expérience
prouve que fila quantité du verre que l ’on mêle
avec lés couleurs n’excede pas le poids des couleurs
de plus de fix ou fept fois , elles coulent
avec i’huiîe au pinceau , & font fort aifées à
employer.
Le verre que les artiftes ont appellé Fondant,
& qu’on nommera ainfi dans tout le cours de cet
çuvrage , eft de la plus grande importance dans
la ppintnre en émail. C’eft lui qui donne de la
liaiion 8c de l’éclat aux couleurs-, c’eft lui qui
Je? fifit pénétrer dans l’émail blanc du fonçl fur
B M R
lequel on peint, & q u i , par ce moyen ,è n rend
la beauté 8c la vivacité-éternelles. Pour remplir
ces conditions, il doit avoir plufieurs qualités*
dont on va donner le détail.
i ° . Le fondant doit être général, c’eft-à-dire,
qu il doit fer vit à toutes les couleurs, quoique
celles-ci (oient tirées de diffère nies fubusnces;-
il doit donc entrer en fufion avec toutes ces cou-
i leurs au même temps & dans le fiiême inftant.
i S il entroit en fufion plutôt ou plus tard avec une.
i couleur qu’avec une autre, on ne réuffiroit plus
dans les mélanges qu’on eft obligé de faire des
couleurs, pour produire les différentes nuances
dont on a befoin. I l faudroit-réferver de certaines
parties de l’ouvrage, qui ne pourrait plus fe faire
egalement.& uniformément.
2°. Le degré de fufibilité du fondant doit être
proportionné à celui de l’émail du fond fur le quel
on peint -, il eft même effentiel qu’il foit
un peu plus facile à mettre en fufion que cet
eihail. On fait que de deux corps qui fe touchent
, fi l ’ un eft plus aifé à fendre que l’autre ,
la fufion de l’ un entraîne dans le moment celle
de l’ autre. La fufion des couleurs entraînera
donc celle du fond, & les y fera pénétrer. A«
lieu que fi l’émail du fond entroit en fonte le
premier, les couleurs qui auroient.déjà paffé au
feu pourroient en fouffrir , & la furface de celles
que l’on viendroit de coucher ne prendroit pas
le luifant & le poli qu’elle devroit avoir. Au
contraire , fi le fondant fe mettoït en fufion trop
promptement,il ne pourroit pénétrer l’émail du
fond, les couleurs relieraient deffus , 8c forme-
roient un re lie f, ce qui produirait un mauvais
effet.
3°. Le fondant doit être c la ir , net, tranfpa-
rent & inattaquable par tous les acides. S’ ilavoit
de la couleur , il la communiquerait aux matières
colorées avec lefquelles on le mêlerait ; s’ il
pouvoit être attaqué par quelqu’un des acides , il
■ le ferait à la longue par celui de l’air , qui ternirait
enfin l’éclat des couleurs ; d’ailleurs , il
ne ferait pas poffible d’expofer les ouvrages à
l’ eau fécondé, pour les dérocher , fans couvrir
la peinture de c ir e , ce qui fait une manoeuvrç
I peu sûre 8c fort embarraffante pour les aftiftes
4°. Il ne doit point entrer de plomb dans la
compofition du fondant ; on en doit bannir par
conséquent le minium, le fucre de $atùrne, la
litharge, la cerufe 3 & c . en un mot, toutes le?
préparations dans lefquélles il entre di* plomb y
ou qui en font tirées. Ce métal, mêlé avec du
iablo 8c des fels, fe vitrifie très-aifcqient dès
qu’on l’expofe au feu ; mais il fe revivifie, ou
( ce qui eft la même chofc) il reprend foq état
de métal avec beaucoup de facilité : l’air fuffit
même quelquefois pour le revivifier, (ans qu’il
foit befoin du feu. C’ eft à cette revivification du
plomb qu’ il faut attribuer en partie les change-'
mens que J’air apporte dans la peinture, à l ’huile,
Quel (ervice ne rendroic-on pas fi l’ompouvoït
bannir les préparations de plomb de la peinture
à i’huiié, comme on l’a fait de la peinture en
émail !
Les fondans faits avec des préparations de
plomb, font cependant les leuls qui nous foient
indiqués daus le peu d’ouvrages que nous avons
fur la peinture en email. Les artiftes, qui ne con-
noifioient point la nature des matières qu’ ils employaient
, étoient fort étonnés de voir que les
înênieS' couleurs employées avec la gomme.,
etoient plus brillantes que lorfqu’ils s’ en fer-
voient avec l’huile effentielle de lavande ; ils
ne voyaient pas que l’huile étant une matière
graffe , quelque foin que l’on fe donnât pour la
faire évaporer,, il en reftoit toujours affez pour
influer 8c agir fur le plomb qui entrait dans leurs
fondans. s
On a vu que le fondant étoit un verre. On eft
entre dans le detail de toutes les qualités que ce
. verre doit avoir pour être propre à la peinture en
email , il faut donc mettre toute fon attention à
en compofer un qui les rempliffe. On fait que le
y erre-, en général, eft compofé d’alkali fixe &
de terres vitrifiables , comme le caillou, le fable
ou le quartz. Mais comme la différence des mai
r e s & de leurs dofies, celle de la force & de la
durée du feu, donne des verres dont les qualités
font tout-à-fait différentes , on fent bien qu’ il
faudrait faire un traité complet de la verrerie, fi
Fon vouloit entrer dans tous les détails qu’exige
un art auffi compliqué. On peut aifément s’ en
épargner une partie, en prenant d’abord un verre
tout fait ; on en fera quitte pour fuppléer aux ■
qualités qui pourroient^lui manquer.
D après un grand nombre d’épreuves que l’on
a faites à ce fiijet, le verre des tuyaux de barô-
rometres a paru le plus propre à remplir cet obje
t ; il eft fort net & fort tendre ; & s’ il n’a pas
encore affez de fufibilité , il eft facile de lui' en
donner une plus grande en le faîfant fondre de
nouveâu'avec une quantité fuffifante de féls.
A près dés effàîsjinùltiplfés, on a pris le parti de
ne fe (ervir'q'uè du borax calciné & du nitre le
plus purifié , pour attendrir ce verre & le rendre
plus fufiblé. î
;. . verre qui refulte de ce mélange, a
été au feu pendant un temps convenable , il eft
net , compaft,, ; exempt de bullei & très brillant
; il ne pouffq point de.iels, & ne peut être
attaqué par aucun des acides : il convient à toutes
les couleurs, même à celles qui font tiré.es
du fer; il les met en fonte facilement & dans le
même temps : il eft vrai qu’il a une petite couleur
jaunâtre qui lui vient du borax , & qu’ il ferait
mieux qu’ il n’en eût point du tout; mais cette
couleur ne peut rien gâter: elle eft fi légère que
te verre paraît très-clair & très-blanc lorfqu’ il
« û en lamesfort minces, & la lame qu’il forme
fur l’éfhail dans la peinture , 'eft-d’une £neffe
fingulière.
On a retranché, aurant qu’ il a, été pollible,
de ce traite, les termes confactés' à la chymie',
pour ne pas embarraffer ceux des leéleurs qui ne ■.
feraient pas verfés dans cette fcience. Cependant
on n a pas cru devoir fupprinier tous ies détails
qui rendent raifon des motifs qui ont dirigé l’aû-
teur, & du choix de (es procédés : mais , pour
épargner aux lè&eurs étrangers à la chymie une
le&ure fatiguante , on a eu foin de marquer par
des guillemets ce qui regarde eflentiellement
les opérations. Ainfi les petlonnes qui voudront
s en tenir à cette partie, pourront aifément paffêr
le relie.
» On ne peut réuflir dans une opération qu’au-
» tant que les matières qu’on y employé font
» bien choifies & préparées ave« foin ; il faut
» donc prendre,, parmi les tuyaux dont on fait
» les baromètres, ceux dont le verre eft le plus
» blanc 8c le plus aile à fondre : il faut encore
» fe bienaffurer qu’ il n’eft point entré de plomb
» dans la compofition de ce verre ; pour y
» parvenir, il fuffira d’expofer l’ extrémité des
» tuyaux au fouffle de la lampe ou du chalumeau
» des émaiJlelirs ; on connoîtra par ce moyen fi
* le verreraft facile à fondre , 8c fi la flamme ne
m le noircit point, de façon qu’après l’avoir net-
» toyé , la couleur noire y rèfte ; dans ce der*
» nier cas, il faudrait abfolument le rejetrer
» comme contenant du plomb ou quelqu’autre
» matière nuifible a la perfeftion du fondant.
>V Lorfqu’on s’eft bien affuré.de la bonne qualî-
» té du verre, il faut l’écrafer dans un mortier de
» verre , de porcelaine ou d’agate , avec un pi-
» Ion de la même matière. On pourroit, à la r i-
» gueur, fe fervir d’un mortier & d’un pilon de
n fe r , pourvu qu’ ils fuffenr bien propres ; mais
» f l faudrait enfùite avoir attention de faire
» tremper la poudre du verre dans de l ’eau dans
» laquelle on aurait mis environ un quart d’ef-t
» prit de nitre ou d’eau forte ," après quoi on la-
». veroit la poudre à plufieurs eaux, & allez
» pour être sûr qu’ elle ne contiendrait plus au-
» cunes parties métalliques ; puis on la ferait
» fécher. J.es mortiers de marbre étant trop ten-
» dres, communiqueraient une partie de leur
» fubftance au verre , ce qui demanderait la
» même purification par l ’efprit de nitre que
>, pour les mortiers, de fer. Enfin les porphyres
» mêmes n’étant pas tout-à-fait auff/durs, que
» l ’agate, ne font pas exempts de foupçon. O»
» eft obligé de s’en tenir aux trois efpéces de
» mortiers dont on vient de parler. On com-
» mence par concaffer le verre doucemenc 8 c à
» • Petirs coups , de peur de cafter le mortier que
» l ’on aura couvert auparavant ; lorfque je verre
» eft en poudre affez fine , on le triture dans le
» mortier d’agate ; on paffe enfuite la poudr©