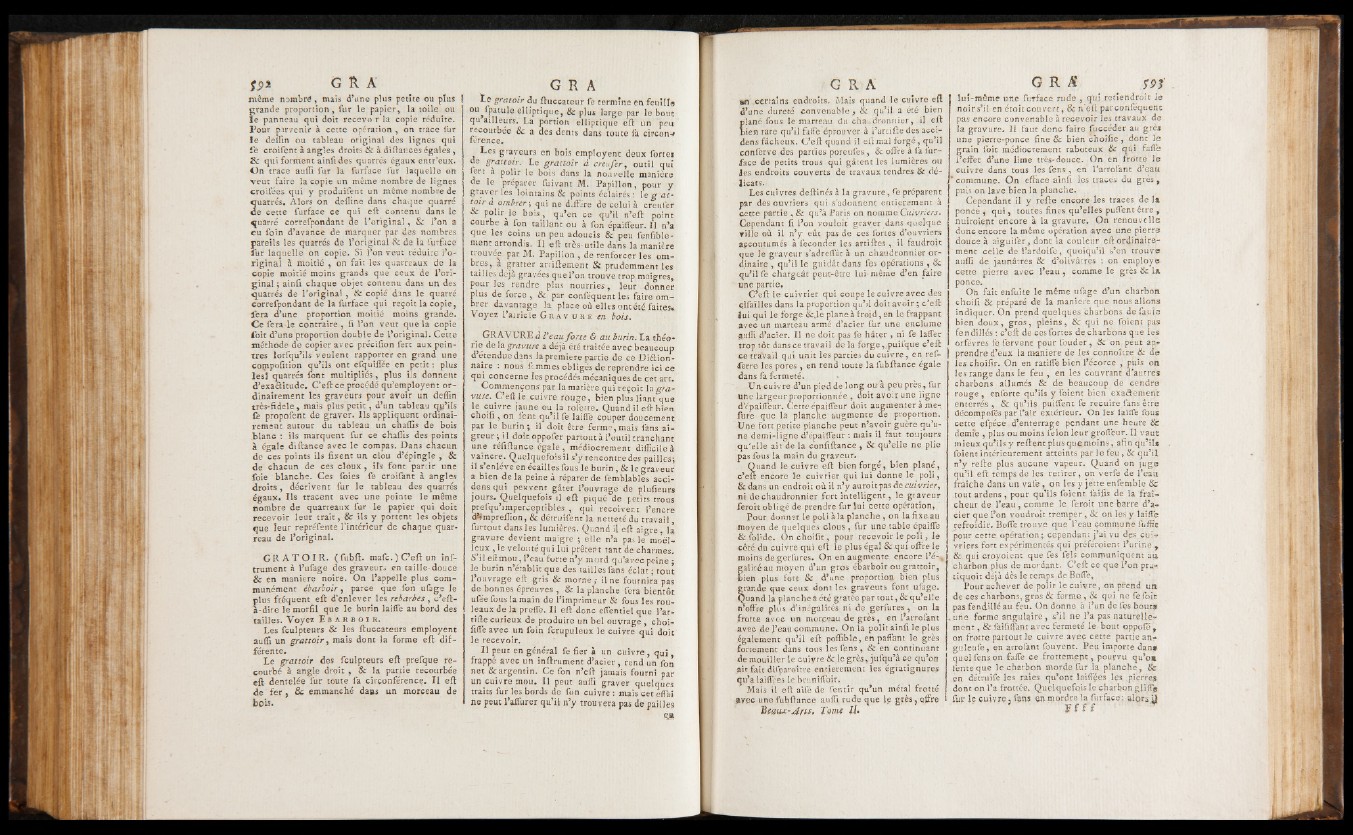
m êm e n om b r é , m ais d’un e p lus p etite ou plus |
g ra n d e p ro p ortion , fur le pap ier, la to ile ou
l e panneau q u i d o it recev o f la cop ie réd u ite.
P o u r parvenir à c e tte opération , on trace fur
l e d eîïin ou tab leau o rig in a l des lig n e s q u i
l e cro ifen t à a n g les droits 8c à d iftan ces é g a les ,
& q u i form en t ainfi des quarrés égau x en tr’eu x .
O n trace aufli fur la fu rface fur la q u e lle on
v e u t faire la co p ie un m êm e nom bre d e lig n e s
croifées. q u i y prod uifen t un m êm e n om b re de
quarrés. A lors on d eflin e dans ch a q u e quarré .
d e c e tte fu rface c e q ui e ft con ten u dans le
quarré correfpondant d e l ’o r ig in a l, 8c l’on a
e u fo in d’avan ce d e m arquer par des nom bres
p a reils les quarrés d e l’o rig in a l 8c d e la furface
fur la q u e lle o n co p ie. Si l’on v eu t réduire l’o r
ig in a l à m o itié , on fait les quarreaux d e la
c o p ie m o itié m oin s grands q u e ceu x d e l’orig
in a l ; ain fi ch a q u e o b jet con ten u dans un des
quarrés d e l ’o r ig in a l, 8c cop ié dans le quarré
correfpondant de la fu rface q u i reçoit la c o p ie ,
fera d’u ne proportion m o itié m o in s gran d e.
C e fe r a le con traire , fi l’on v eu t q u e la cop ie
fo it d’un e proportion d o u b le d e l’o r ig in a l. C ette
m éth o d e d e cop ier a v e c précifion fert au x p ein tr
e s lorfqu’ils v eu le n t rapporter en grand u n e
com pofition qu ’ils o n t efq u iflee en p etit : plus
le s ! quarrés fon t m u ltip lié s, plus ils d o n n en t
d’exa& itu d e. C ’e ft c e procédé qu’em p lo y en t o r d
in a irem en t les graveu rs pour a vo ir u n deflin
tr è s-fid e le , m ais plus p e t it , d’un tab leau qp ’ils
£é propofent de g ra v er. I ls a p p liq u en t ord in airem
en t autour du tab leau un chaflis d e bois
■ blanc : ils m arqu ent fur c e chaflis d es p oin ts
à ég a le d ifta n ce a v ec le com pas. D a n s ch a cu n
d e ces p oin ts ils fix e n t u n clo u d’ép in g le , &
d e ch a cu n de ces d o u x , iîs fo n t partir u n e
fo ie b la n ch e. C es fo ies fe croifan t à a n g les
d r o its , d écriv en t fur le tab lea u d es quarrés
ég a u x . I ls tracen t a vec u n e p o in te le m êm e
n om b re de quarreaux fur le papier q u i d o it
r e c e v o ir leu r tr a it, & ils y porten t le s o b jets
q u e leu r repréfente l’intérieur d e ch aq u e quar-
reau d e l’o rig in a l.
G R A T O I R . ( fu b ft. m afc. ) C’e ft un in f-
trum en t à l’ufage des graveu rs .en ta ille -d o u ce
& en m aniéré n o ire. O n l ’ap pelle plus com m
u ném en t ébarboir, parce q u e fon u fage le
p lu s fréq u en t e ft d’en lev e r les rebarbes, c’e ft-
a -d ire le m orfil q u e le burin laifle au bord des
ta ille s. V o y e z E b a r b o i r .
L es fcu lp teu rs & les ftu ccateu rs em p lo y en t
aufli un grattoir, m ais d on t la form e e ft d ifféren
te.
L e grattoir d es fcu lp teu rs e ft prefque recou
rb é à a n gle droit , 8c la partie recourbée
eft d e n te lée fur tou te fa circo n féren ce. I l e ft
d e f e r , 8c em m an ch é da&s un m orceau d e
b o is.
l e gratoir du ftu ccateu r fe term in e en fe u ille
ou ^ fpatule e llip tiq u e , & plus large par le bouc
qu a illeu rs. La portion ellip tiq u e e ft un peu
recou rb ée 8c a des dents dans tou te fa circon-« ieren ce.
L e s graveu r s en b o is em p lo y en t d eu x fortes
d e grattoir. Le grattoir à créa fe r , o u til qui
fert a p olir le b ois dans la n o u v e lle m anière
d e le préparer fu ivan t M . P a p illo n , pour y
graver les loin tain s & points éclairés : lé g a t -
rotr ù ombrer-, qui n e d .ffire de c e lu i à creu fer
& p olir lé b o is , qu ’en ce qu’il n’e ft point
cou rb e a fon taillan t ou à fon épaifleur. I l n ’a
q u e le s co in s un peu ad ou cis & peu fen fib le-
m en t arrondis. I l e ft très-u tile dans la m anière
tto u v ee par M . P ap illon , de renforcer les o m -
b res, a gratter arciftem en t & prudem m ent les
ta ille s déjà gravées q u e l’on trou ve trop m aigres,
pour les ren d re plus nourries , leu r don n er
plus d e fo r c e , & par co n fé q u e n tle s faire om brer
davan tage la p lace où e lle s on t été faites*
V o y ez l’a ir ic le Grav ure en bois.
G R A V U R E à Veau forte & au burin. La th éo rise
d e la gravure a déjà été traitée a v e c b eau cou p
d’éten d u e dans la prem ière partie de ce D ic tio n n
a ire : nou s fem m es o b lig és d e reprendre ici ce
q u i co n ce r n e les procédés m écaniq ues de c e t art.
C om m en çon s- par la m atière q u i r e ç o it la gravure.
C ’èft le cu ivre r o u g e , b ien plus lia n t q u e
le cu iv re jau ne ou la ro iette. Q uand il e ft b ien
ch oifi , on le n t qu’il fe laifle couper d ou cem en t
par le b u r in ; il d o it être fe rm e ,m a is fans aig
re u r ; il d o ito p p o fer partout à l’o u til tran ch an t
u n e réfiftan ce é g a le , m éd io crem en t difficile à
v a in cre. Q u elq u efo is il s’y ren con tre des pailles;
il s’en lèv e en é c a ille s fous le b u rin , & le graveu r
a b ien d e la p ein e à réparer d e fem blab les a cci-
den s q u i p eu v en t g âter l’ou vra ge de plufieurs
jo u rs. Q u elq u efois il e ft piqué d e petits trous
p relq u ’im p ercep tib les , q u i reço iv en t l’en cre
c^m p reflion , & d étru ifen t la n etteté du tr a v a il,
fu rtou t dans les lum ières. Q uand il eft a ig r e , la
gravu re d ev ien t m aigre ; e lle n’a pas le m o elleu
x , le v elo u té q u i lu i prêtent tan t d e charm es.
S ’il eft m o u , l’eau forte n’y m ord qu ’a v ec peine ;
le burin n’étab lit q u e des ta ille s fans écla t ; to u t
l’o u v ra g e eft g ris & m orné ,* il n e fou rn ira pas
d e b on n es épreuves , & la p lan ch e fera b ien tô t
ufée fous la m ain d e l’im prim eur & fou s le s roulea
u x d e la prefle. I l e ft d o n c eflen tiel q u e l’ar-
tifte cu rieu x de produire un b el ou vra ge , c h o i-
fifle a v e c un foin fcru p u leu x le cu ivre q u i d o it
le recevo ir.
I l peut en gén éral fe fier à un c u iv r e , q u i,
frappé a v ec un in ftrum en t d’a c ie r , rend un fon
n et & a rg en tin . C e fon n ’e ft jam ais fou rn i par
un c u iv re m o u . I l peut aufli g ra ver q u elq u es
traits fur les bords d e fon cu ivre : m ais cet effai
n e peut l’affurer qu’il n ’y trou vera pas d e p a illes
«d certain s en d roits. M ais quand le cu ivre eft
d ’une dureté co n v en a b le 9 8c qu’il a été bien
îané fous le m arteau du ch a u d ro n n ier, il eft
ien rare qu’il fafle éprouver à i’a rtifte d es a cci-
dens fâ ch eu x . C ’e ft quand il eft m al fo r g é , q u ’il
con ferv e des parties poreufes , & offre à fa fu r-
fa c e d e p etits trous q u i g â ten t les lum ières ou
le s en d roits co u v erts d e travaux tendres & d élic
a ts .-
Les cu ivres d eftin és à la g ra v u re, fe préparent
par des ou vriers q u i s’ad on n en t en tièrem en t à
c ette partie , 8c qu ’à Paris on nomme. Cuivriers.
C ep en dant fi l’on v ou loir graver dans q u elq u e
v ille où il n’y eû t pas de ces fortes d’ouvriers
accoutum és à fécond er les artiftes , il fau droit
q u e le graveu r s’adreflat à un ch au d ron n ier o r dinaire
, qu’il le g u id â t dans fes opérations , 8c
qu’il fe ch a rg eât p eut-être lu i-m êm e d’en faire
u n e partie,
C’e ft le cu iv rier q u i cou pe le cu ivre a vec des
c.ifaîiles dans la proportion qu ’il d o it avo ir ; c ’e ft
lu i q u i le forg e oc, le plane à fro id , en le frappant
a v ec un marteau armé d’acier fur u n e en clu m e
aufli d’a cier. I l n e d o it pas fe hâter , ni fe lafler
trop tô t dans ce travail de la forg e „puii'que c ’eft
c e travail q u i u n it les parcies du c u iv r e , en ref-
ferre les pores , en rend tou te la fub ftan ce éga le
dans fa fe rm e té ..... -
U n cu ivre d’un pied d e lo n g ou a peu p rès, fur
u n e largeu r p ro p ortion n ée, d oit avo ir une lig n e
d ’épaifleur. C ette épaifleur d o it au gm en ter a me-,
fu re q u e la p lan ch e au gm en te d e proportion.
U n e fort p etite p lan ch e peut n’avo ir g u ère q u ’un
e d em i-lig n e d’épaifleur : mais il faut tou jours
q u 'e lle a it de la con fiftan ce , & qu’e lle n e plie
pas fous la m ain du graveu r.
Q u an d le c u iv re e ft b ien fo r g é , b ien p la n é,
c’eft encore le cu ivrier q ui lu i d o n n e le p o li,
& dans un en d ro it où il n’y auroitpas d e cuivrier,
n i de chaudronnier fort I n te llig e n t, le g ia v eu r
ferort o b lig é d e prendre fur lu i c e tte opération,
Pour donner le poli à la p lan ch e , on la fix e,a u
m o yen de q u elq u es clo u s , fur u n e tab le épaifle
& fo lid e. O n c h o ifit, pour recevo ir le p o li, le
côté du c u iv re q u i eft le plus éga l & q u i offre le
m oin s d e gerfures. O n en au gm en te en core l’é-*
g aliré au m o yen d’un g ro s ébarboir ou g ra tto ir,
b ien plus fort & d’une proportion b ien plus
grande que ceu x don t les graveurs fon t u fage.
Q uand la p lan ch e a été gratée par to u t, & qu’e lle
n’offre plus d ’in éga lités ni d e g er fu r e s, on la
frotte a v e c uij morpeau d e g r è s , en l’arrofant
a v ec d e l’eau com m u n e. O n la p o lit ainfi le p lu s
éga lem en t q u ’il eft p o ffib le, en pafiant le grès
fortem ent dans tous les Cens , & en con tin u an t
d e m o u iller le cu iyre & ,le g rè s, jufq u ’à ce qu’on
Ait fait difparoître en tièrem en t les égra tig n u res
qu’a la iflees le brunîfloir.
M ais il eft aifé de fen tir qu’un métal frotté
Avec une fu b ftan ce aufli rude q u e Je g r è s , qffre
fteéftw.-Arts* T oms II•
lu i-m êm e u n e fu rface rude , q u i retien d ro ît le
n o ir s’il en é to it c o u v e r t, & n ’eft p a rcon féq u en c
pas en core co n v en a b le à recev o ir les travaux d e
la g ra vu re. I l fau t d on c faire fu ccéd er au g rès
u n e pierre-ponce fin e 8c b ien c h o if ie , don t le
grain foie m éd iocrem en t raboteux 8c q u i fafle
l ’effet d ’u n e lim e très-d ou ce. O n en fro tte le
c u iv re dans tou s les C ens, en l ’arrofant d’eau
‘ com m u n e. O n efface ain fi les traces du grès ,
puis on la v e b ien la p lan ch e.
C ep en d an t il y r efte en co re les traces d e la
p o n cé , q u i, tou tes fin es qu ’e lle s puflent être ,
n u iroien t en core à la g ra vu re. O n r e n o u v e lle
d on c en core la m êm e opération a v e c u n e pierre
d ou ce à a ig u ife r , don t la cou leu r eft o rd in airem
en t c e lle d e l’a rd o ife, q u oiq u ’il s’en tro u v e
aufli de jaunâtres & d’olivâ tres : on em ployé-
c e tte p ierre a v ec l’e a u , com m e le grès & la
ponce-.
O h fait en fu ite le m êm e u fage d’un ch arb on
ch o ifi & préparé de la m aniéré q u e nous a llo n s
in d iq u er. O n prend q u elq u es charb ons d e fau îe
b ien d o u x , g r o s , p le in s , 8c q u i n e fo ien t pas
fe n d illé s : c’e ft d e ces fortes de c h a rb on s q u e le s
orfèvres fe ferv en t p o u r fo u d e r , & on p eu t ap-
J prendre d’eu x la m an iéré d e les con n oître & d e
les ch o ifir. O n en ratifie b ien l’écorcé , puis o n
le s ran ge dans le feu , en les cou vrant d ’au tres
charb ons a llum és & d e beau cou p d e cen d re
rou ge , en forte q u ’ils y fo ien t b ien ex a â em e n r
enterrés , & qu ’ils pu iflen t fe recu ire fans être
décom pofés par l’air extérieu r. O n les laifle fou s
ce tte efpéce d’en terrage p endant u n e heu re &
derme , plus ou m oin s félo n leu r grofleu r. Il vau t
m ieu x qu’ils y refirent plus q u e m o in s , afin qu’ils
foien t in térieurem ent a ttein ts par le feu , & qu ’il
n’y refte plus a u cu n e vapeur. Q u an d on ju g e
qu’il e ft tem ps de les r e tirer, on verfe d e l ’eau
fraîch e dans un vafe , on les y jette en fem b le &
tou t a rd en s, pour qu’ils fo ie n t faifis d e la fraîch
eu r de l’e a u , com m e le feroit u n e barre d’a-?
cier q u e l’on vou d roit trem p er, 8c on les y la ifle
refroid ir. B ofle trou v e q u e l’eau com m u n e fuffic
pour c e tte op ération ; cependant j’ai vu dçs cuis?
v riers fort exp érim entés q u i préféroient l’u rin e ,
8c- q u i cro y o ien t q u e fes fels com m u n iq u en t a u
charbon plus d e m ordant. C ’e ft c e q u e l’o n pra»
tiq u o it déjà dès le tem ps de B ofle.
P ou r a ch ev er d e polir le c u iv r e , on prend u n
d e ces ch arb on s, gros 8c ferm e , & q ui n e fe foit
pas fe n d illé au fe u . O n d on n e à l’un d e fes b o u ts
, une form e a n g u la ir e , s’il n e l’a pas n a tu rellem
en t , & faififlant a v ec ferm eté le b ou t oppofé ,
on frorte partout le cu ivre a v e ç cetre partie anr
g u le u fe , en arrofant fo u y en t. P e u im porte dan»
q u e lfe n so n fafle ce fr o ttem e n t, pourvu qu ’o »
len te q u e le ch arb on m orde fur la p la n c h e , &
ên détruife les raies qu’o n t laiflçes les, pierres
d on t on l’a frottée. Q u elq u efo is le charbon g liffg
fur le c u iv r e , fens en m ordre la furface ; a lo rs il
F f f f