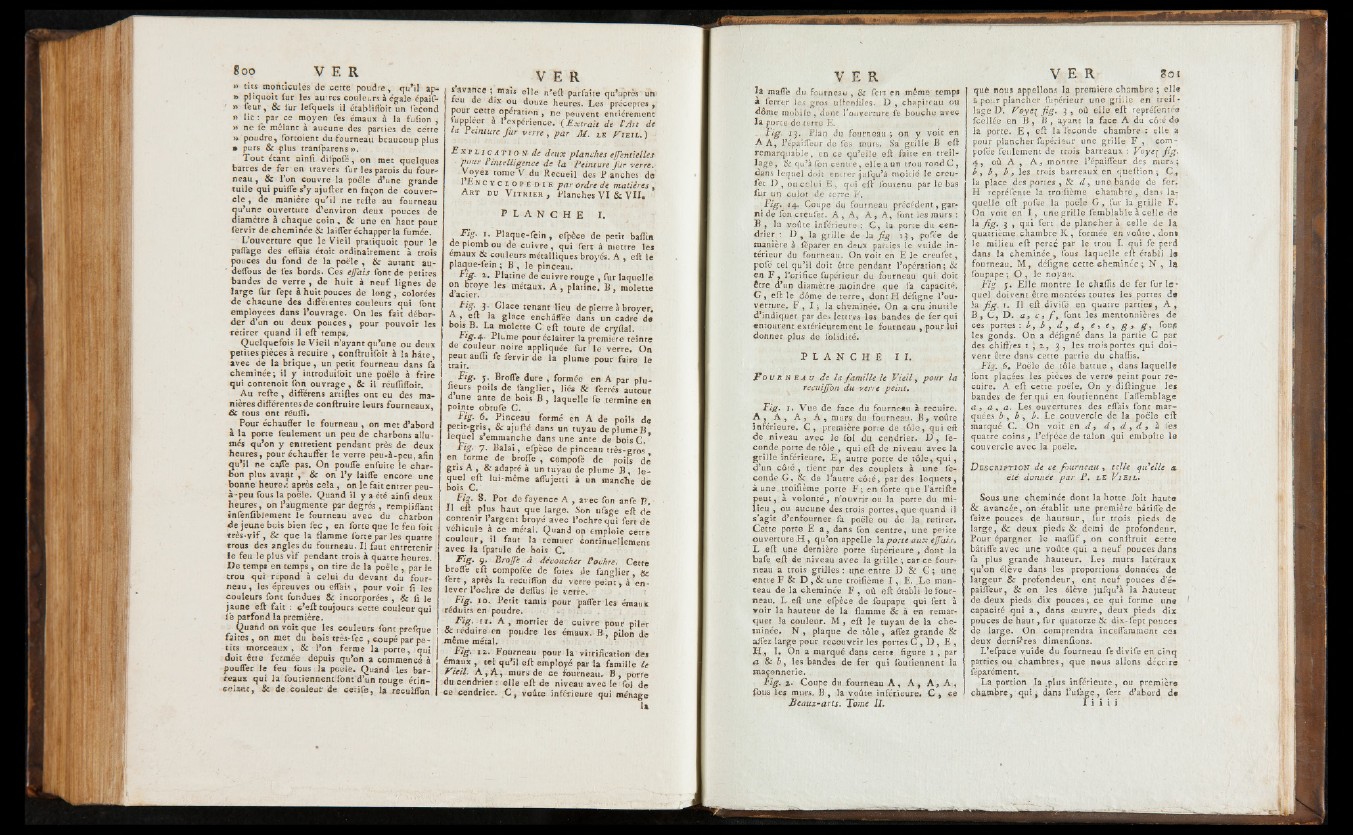
8 oo V F. R
» tirs monticules de cette poudre, qu’il ap-
» pliquoit (ur les aurres ' » feur, & fur lefquels ilc oéutalebulrifsl oài té guanl ef éécpoanifd- » lie: par ce moyen fes émaux à la fufion ; » ne Ce mêlant à aucune des parties de cette »» ppuorus d&re , pflourst otireanntf pdaur feonus r»n.eau beaucoup plus
Tout étant ainli difpofé, on met quelques barres de fer en travers fur les parois du four- neau, & l’on couvre la poêle d’une grande tuile qui puiffe s’y ajufter en façon de couvercle
, de manière qu'il ne refte au fourneau qu’une ouverture d’environ deux pouces de diamètre à chaque coin, & une en haut pour lerLv’ioru dvee rcthuerme iqnuéee &le lVaifiefeirl épcrhaatpiqpuero ilta fpuomuré e.le pa(Tage des effais était ordinairement à trois pouces du fond de la poêle , & autant au-
' deffous de fes bords. Ces e(fais font de petites bandes de verre , de huit à neuf lignes de
large fur fepe à huit pouces de long, colorées de chacune des difféi entes couleurs qui font demerp ldo’yuéne so ud andse ul’xo upvoruacgees. y Opno ulers pfoauitv odiérb olers
rétirer quand il eft temps.
Quelquefois le Vieil n’ayant qu’une ou deux petites pièces à recuire , conftruifoit à la hâte, avec de la brique, un petit fourneau dans fa cheminée; il y introduiloit une poêle à frire quAi uco nrteefnteo,i t dfioffné roenusv raargtieft, es& o nilt reéuu ffdifefso irm. a&
niè troeus sd ifofnért ernétuesfi di.e conftruire leurs fourneaux,
Pour échauffer le fourneau , on met d’abord à la porte feulement un peu de charbons allumés
qu’on y entretient pendant près de deux heures, pour échauffer le verre peu-à-peu, afin bqoun’i l plnues acavjEafne t pas.& O no np ol’uyf fela iefnfef uietnec loer ec huanre
àb-opnenue fhoeuusr lea* :p aopêrleè.s Qceulaa n, d oinl lye afa éitté e natinrefir dpeeuux- ihnefuenrûesb,l eomne ln’aru lgem feonutren epaaur daevgerécs ,d ur emchpalirffbaonnt de jeune bois bien fec , en forte que le feu foit
ttrroèuss- vdife,s &an gqluees dlau ffloaumrnmeea uf.o rIlt ef apuatr elenst rqeuteantrier le feu le plus vif pendant trois à quatre heures. De temps en temps , on tire de la poêle , par le tnreoauu ,q uleis réépproenudv esà ocue leufif adisu , dpeovuarn tv odiur ffio ulers
couleurs font fondues & incorporées & fi le ljea upnaer foenftd flaai tp r: emc’ieèfrte t.oujours cette couleur qui
faiQteus a,n odn o nm veto itd uq ueb olies st rcèosu-fleecu r, sc ofuonpté ppraerf pquee
j
tits morceaux, & l’on ferme la porte, qui doit être fermée . depuis qu’on a commencé à pouffer le feu fous . la poêle. Quand les barcreelaaunxt
,q u&i lad ef ocuotuielenunre ntifont d’un rouge étinde
cerife, la recuiffon
V E R
savance ; mais e lle n'eft parfaite qu’ a près un)
eu de dix ou douze heures. Les préceptes ,
pour cette opération, ne peuvent entièrement
iuppleer a 1 expérience. g E x tr a it de l'A n de
La Peinture fu r verre , p a r M . le V i e i l .)
E x p l i c a T l o u de deux planches effentielles
pour Vintelligence de la Peinture fur verre.
Voyez tome V du Recueil des P.anches de 1 E N c r c i o P É d i e par ordre de matières ,
A rt du V itr ier , Planches V I & V I I .
P L A N C H E I .
Fig. i . Plaque-fein , efpèce de petit balïin
de plomb ou de cuivre, qui fert à metrre les
émaux & couleurs métalliques broyés. A , eft le
plaque-fein ; B , le pinceau.
l . Platine de cuivre rouge , fur laquelle
on broyé les métaux. A , platine. B , molette
d acier.
3 ' Glace tenant lieu de pierre à broyer.
A , eft la glace enchâffée dans un cadre de
bois B. La molette C eft toute de cryftal.
Fôg» 4 - Plume pour éclairer la première teinte
de couleur noire appliquée fur le verre. On
peut auffi fe fervir de la plume pour faire le
trair. r
Fig. y. Broffe dure , formée en A par plusieurs
poils de langlier, liés & ferrés autour
d une ante de bois B , laquelle fe termine en
pointe obtufe C.
Fig. 6. Pinceau formé en A de poils de
petit-gris, & ajufté dans un tuyau de plume B ,
lequel s’emmanche dans une ante de boisC.
Fig. 7. Balai , efpèce de pinceau très-gros
en forme de broffe , compofé de poils de
gris A , & adapté à un tuyau de plume B , lequel
eft lui-même affujetti à un manche de
bois G. '
Fig. 8. Pot de fayence A , avec fon anfe B.
I l eft plus haut que large. Son ufage eft de
contenir l’argent broyé avec l’ochrequi fert dé
véhicule à ce métal. Quand on emploie cette
couleur, il faut la remuer Continuellement
avec la fpatule de bois C.
Fig. 9. Brojfe à découcher Pochre. Cetté
broffe eft compofée de foies *le fanglier, &
fe r t , après la recuiffon du verre peint, à enlever
l’ochre de deffus- le verre.
Fig» .10^ Petit tamis pour paffer les émaux
réduits en poudre. c .
Fig. \x. A , morrier de cuivre pour piler
! & réduire; en poudre les émaux. B , pilon de
même métal.
Fig. i z . Fpurneau pour la vitrification des
émaux , tel qu’il eft employé par la famille le
Vieil. A , murs de ce fourneau. B , porte
du cendrier : elle eft de niveau avec le fol de
ce cendrier. C , voûte inférieure qui ménage
V E R
la maffe du fourneau , & fert en même temps
a ferrer les gros uftenfiles. D , chapiteau ou
dôme mobile , dont l'ouverture fe bouche avec
la porte de terre E.
Fig- I 3- Elan du fourneau ; on y voit en
A A , l’épaiffeur de fes murs. Sa grille B eft
remarquable, en ce qu’elle eft faite en treillage
, & qu’à fon centre, elle a un trou rond C ,
dans lequel doit entrer jufqu’à moitié le creu-
fet D , ou celui E , qui eft fou.tenu par le bas
fur un culot de terre F, » .
Fig. 14. Coupe du fourneau précédent, garni
de fçui creufet. A , A , A , A , font Les murs :
B , la -voûte inférieure : Ç , la porte du cendrier
: D , la grille de - la fig 13 , pofée de
manière à réparer en deux parues le vuide intérieur
du fourneau. On voit eh È le creuiet,,
pôle tel qu’ il doit être pendant l’opération; &
en F , l’orifice fupérieur du fourneau qui doit
être d’ un diamètre moindre que fa capacité.
G , eft le dôme de terre, dont H défigne l’ouverture.
F , I ; la chemiriéé. On a cru inutile
d’indiquer par des lettres las bandes de fer qui
entourent extérieurement le fourneau , pour lui
donner plus de folidké.
P L A N C H E I I .
F o u r n e a u de la famille le V ie il, pour la
reçuijfon du verre peint.
Fig. 1. Vue de face du fourneau à recuire.
A , À , A , A , murs du fourneau. B , voûte
inférieure, C , première porte de tôle , qui efl
de niveau avec le fol du cendrier. D , fécondé
porte de tôle , qui eft de niveau avec la
grille inférieure. E , autre porte de tôle, q u i ,
d’ un côté , tient par des couplets à une fécondé
G , & de l'autre côté, par des loquets,
à une „troifième porte F ; en forte que l’artifte
peut, à volonté , n’ouvrir ou la porte du milieu
, ou aucune des trois portes, que quand il
s’agit d’enfourner fa poêle ou de la retirer.
Cette porte E a , dans l’on centre, une petite
ouverture H , qu’on appelle la porte aux e f ois.
L eft une dernière porte fupérieure , dont la
bafe eft de niveau avec la grille ; car ce fourneau
a trois grilles : ujie entre D & C ; une
entre F & D , & une troifième I , E. Le manteau
de la cheminée F , où eft établi le fourneau.
L eft une efpèce de ioupape qui fert à
voir la hauteur de la flamme & à en remarquer
la couleur. M , eft le tuyau de la cheminée.
N , plaque de tô le , affez grande &
affez large pour recouvrir les portes C , D , E ,
H. , I. On a marqué dans cette figure 1 , par
a & b , les bandes de fer qui foutiennent la
maçonnerie. .
Fig. Z- Coupe du fourheau A , A , A , A ,
(bus les murs. B , la voûte inférieure. C , ce
Beaux-arts. Tome IL
V E R Soi
què nous appelions la première chambre ; elle
à pour plancher fupérieur une grille en t re illage
D. Voyc{ fig . 3 , où elle- eft représentée
fcelléè en B , B , avant la face A du côté do
la porte. E , eft la réponde chambre : elle a
pour plancher fupérieur une grille F , çom-
pofée feulement de trois barreaux : Voyei fig.
4 , où A , A , montre l ’épaiffeur des murs ;
b y b , b , les trois barreaux en queftion ; C ,
la place des portes, & d , une bande de fer.
H repréfente la troifième ch am b red an s laquelle
eft pofée la poêle G , fur la grille F .
On voit en î , une grille femblable à celle de
la fig . 3 , qui fert de plancher à celle de la
quatrième, chambre K , formée en voûte , dont
le milieu eft percé par le trou L qui fe perd
dans la cheminée , fous laquelle eft érabli la
fourneau. M , défigne cette cheminée; N , la
Ioupape ; O , le noyau.
Fig y. Elle montre le chaflis de fer fur l e quel
doivent être montées toutes les portes de la. fig. 1. Il eft divifé en quatre parties, A ,
B , C , D. a» c 9 f f font les mentonnières de
ces portés : b t b , dy d , e , e , g y g , foo£
les gonds. On a défigné dans la partie C pair
des chiffres 1 } z , 3 , les trois portes qui doivent
être dans cette partie du chaffis.
Fig. .6, Poêle de tôle battue , dans laquelle
lont placées les pièces de verre peint pour recuire.
A eft cette poêle. On y diftingue les
bandes de fer qui en foutiennent l aflemblage a} a y a. Les ouvertures des effais font marquées
b , b , b. Le couvercle de la poêle eft
marqué C. On voit en dy d à fes
quatre coins, l ’efpèce de talon qui emboîte le
couvercle avec la poêle.
Descripéttiéo ndo nden écee fourneau , telle qu'elle a par P. le Vieil. .
Sous une cheminée dont la hotte foie haute
& avancée, on établit une première bâtiffe de
feize pouces de hauteur, fur trois pieds de:
large, & deux pieds & demi de profondeur.
Pour épargner le malfif , on conftruit cette
bâtiffe avec une voûte qui a neuf pouces dans
fa plus grande hauteur. Les ipurs latéraux
qu’on élève dans les proportions données de
largeur & profondeur, ont neuf pouces d’é-
paiffeur, & on les élève jufqu’à la hauteur
de deux pieds dix pouces ; ce qui forme une
capacité qui a , dans oeuvre, deux pieds dix
pouces de haut, fur quatorze & dix-fept pouces
de large. On comprendra inceffamment ces
deux dernières dimenfions.
L’ efpace vuide du fourneau fedivife en cinq
parties ou chambres, que neus allons décrire
féparément.
La portion la .plus inférieure, ou première
chambre, q u i, dans l ’ulàge, 1ère d’abord de
I i i i i