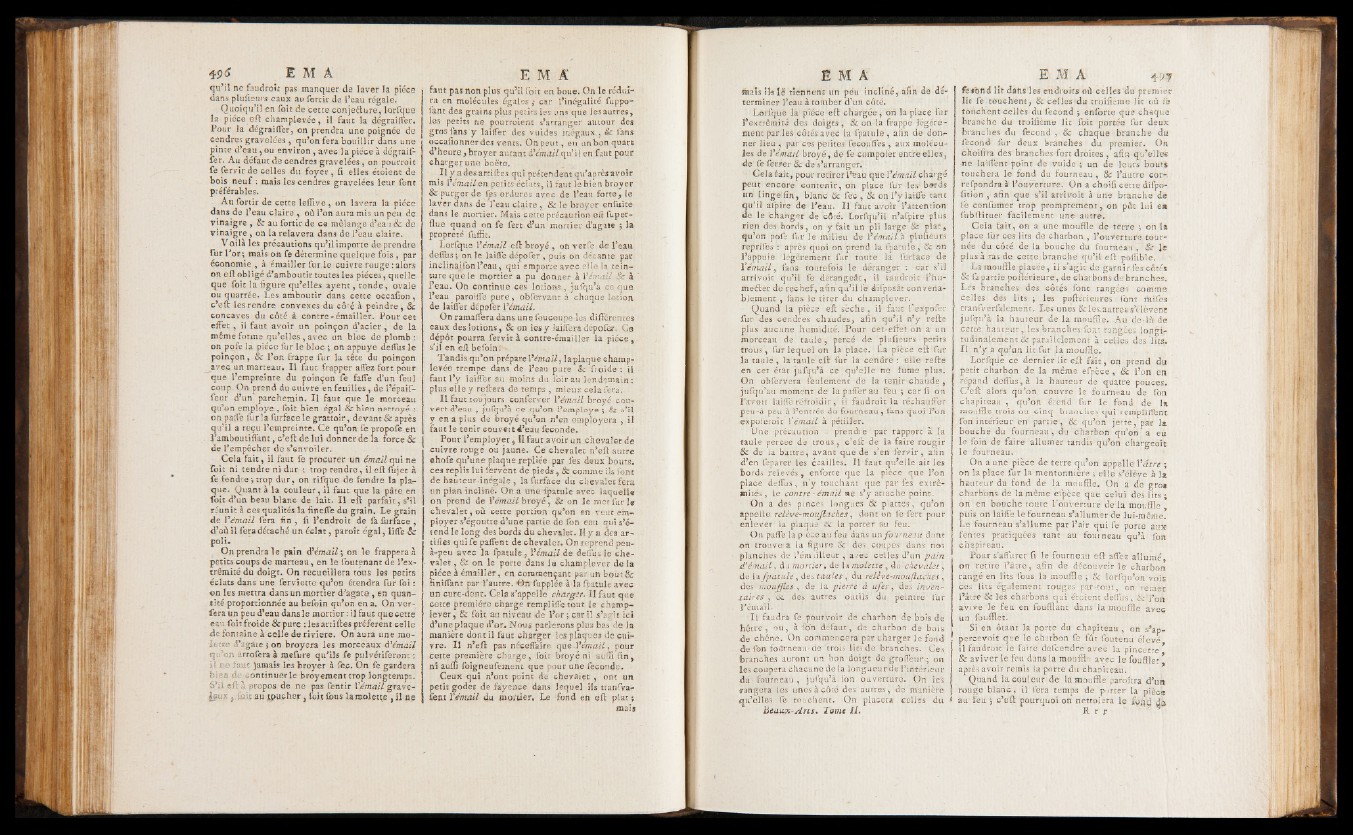
qu’ il ne faudroit pas manquer de laver la pièce
dans plufieurs eaux au fortir de l’eau régale.
Quoiqu’il en foit de cette conjeêlure, lorfque
la pièce eft champlevée, il faut la dégraîffer*
Pour la dégraiffer, on prendra une poignée de
cendres gravelées, qu’on fera bouillir dans une
pinte d’eau , ou environ, avec la pièce à dégraifi
fer. Au defaut de cendres gravelées , on pourroit
fe fervir de celles du foyer , fi elles étoîent de
bois neuf : mais les cendres gravelées leur font
préférables.
Au fortir de cette leflive , on lavera la pièce
dans de l’eau claire , où l’on aura mis un peu de
vinaigre , & au fortir de ce mélange d’ eau & de
vinaigre , on la relavera dans de l’eau claire.
Vo ilà les précautions qu’il importe de prendre
fur l ’or; mais on fe détermine quelque fois , par
économie , à émailler fur,4e cuivre rouge: alors
on eft obligé d’amboutir toutes les pièces, quelle
que foit la figure qu’elles ay en t, ronde, ovale
ou quarrée. Les amboutir dans cette occafion,
c’eft les rendre convexes du côté à peindre , &
concaves du côté à contre-émailler. Pour cet
e ffe t, ii faut avoir un poinçon d’a c ie r , de la
même forme qu’e lle s , avec un bloc de plomb :
on pofe la pièce fur le bloc ; on appuyé deffus le
poinçon, & l’on frappe fur la tête du poinçon
av ec un marteau. I l faut frapper affez fort pour
que l’empreinte du poinçon fe faffe d’un feul
coup. On prend du cuivre en feuilles, de l’épaif-
feur d’ un parchemin. I l faut que le morceau
qu’on employé , foit bien égal & bien nettoyé ;
on paffe fur la fiirface le grattoir, devant & après
qu’ il a reçu l ’empreinte. Ce qu’on fe propofe.en
l ’amboutiffant, c’eft de lui donner de la force &
de l’empêcher de s’envoiler.
Cela fa it, il faut fe procurer un émail qui ne
foit ni tendre ni dur •» trop rendre, il eft fujet à
fe fendre y trop dur, on rifque de fondre la planque.
Quant à la couleur ,41 faut que la pâte en
loit d’ un beau blanc de lait. I l eft parfait, s’ il
réunit à ces qualités la fineffe du grain. Le grain
de Yémail fera fin , fi l’endroit de fa furface ,
d ’où il fera détaché un é c lat, paroît égal, liffe 8c
poli.
On prendra le pain éYtmaiT, on le frappera à
petits coups de marteau, en le foutenant de l ’ex-
trêmité du doigr. On recueillera tous les petits
éclats dans une fervîette qu’on étendra fur foi :
on les mettra dans un mortier d’agate , en quantité
proportionnée au befoin qu’ on en a. On ver-
fera un peu d’eau dansle mortier : il faut que cette
eau foit froide &pure :lesartiftes préfèrent celle
de fontaine à celle de riviere. On aura une molette
d’agate j on broyera les morceaux à'émail
qu’on arroferaà mefure qu’ ils fe pulvériferont :
il c e faut jamais les broyer à fée. On fe gardera
bien de continuer le broyementtrop longtemps.
S’il eft à propos de ne pas fentir Témail graveleux
j . foit au jtpucher} foit Cous la molette, il ng
faut pas non plus qu’ il foit en boue. On le réduira
en molécules égales ; car l’ inégalité fuppo-
fant des grains plus petits les uns que les autres,
les petits ne pourraient s’ arranger autour des
gros fans y laiffer des vuides inégaux, 8c fans
occafionner des vents. On peut, en an bon quart
d’heure, broyer autant Cl émail qu’ il en faut pour
charger une boëte.
Il y a des artiftes qui prétendent qu’après avoir
mis Vémail en. petits éclats, il faut le bien broyer
& purger de Ijss ordures avec de l’eau forte, le
laver dans de l’eau claire , & le broyer enfuite
dans le mortier. Mais cette précaution eft fuper-
flue quand on fe fert d’un mortier d’agaie ; la
propreté fuffit.
Lorfque l'émail eft broyé , on verfe de l’eau
deffus ; on îe laiffe dépofer , puis on décante par
inclinajfonl’eau, qui emporte avec elle la teinture
que le mortier a pu donner à Vémail ,& à
Peau. On continue ces lotions, iulqu’à ce que
l’eau, paroiffe pure, obfervant à chaque lotion
de laiffer dépofer 1yémail.
On ramaffera dans une foucoupe les différentes
eaux des lotions, & on les y laiffera dépofer. Ce
dépôt pourra fervir à contre-émail 1er la pièce,
s’il en eft befoinT^
Tandis qu’oriprépareŸèmaif laplaque champ-
levée trempe dans.de l’ eau pure 8c froide: il
faut l ’y laiffer au moins du loir au lendemain:
plus elle y reftera de temps , mieux cela fera.
I l faut toujours conferver Y émail broyé couvert
d’eau , jufqu’ à ce qu’on l’empîoye ; 8c s’il
y en a plus dé broyé qu’on n*en employera , il
faut le tenir couvert d’eau fécondé.
Pour l’employer , il Faut avoir un.chevalet de
cuivre rouge ou jaune. Ce chevalet n’eft autre
ehofe qu’une plaque repliée par fes deux bouts,
ces replis lui fervent de pieds, & comme ils font
de hauteur .inégale , la furface du chevalet fera
un plan incliné. On a une fpatule avec laquelle
on prend de l'émail broyé, & on Je met lur le
chevalet, où cette portion qu’ori en veut employer
s’égoutte d’une partie de fon eau qui s’étend
le long des bords du chevalet. Il y a des artiftes
quife paffent de chevalet. On reprend peu-
à-pe'u avec la fpatule , Vémail de deffus le chevalet
, & on le porte dans ie champlever de la
pièce à émailler, en commençant par un bout &
finiffant par l’autre. Ori fuppîéè à la fpatule avec
un cure-dent. Cela s’appelle charger. Il faut que
cette première charge rempliffe tout le champ-
lever , & foit au niveau de l’or ; car il s’agit ici
d’une plaque d’or. Nous parlerons plus bas de la
manière dont il faut charger les plaques de cuivre.
Il n’ eft pas néceffaire que l ’email, pour
cette première charge, foit broyé ni auffi fin,
ni aum foigneufement que pour une fecon.de.
Ceux qui n’ont point d'e chevaiet , ont un
petit godet de fàyence dans lequel ils tranfva*
jfeüî 1 émail du mortier. Le fond en eft plat ;
mais
Mais ils lé tiennent un peu incliné, afin de déterminer
l’ eau à tomber d’un côté.
Lorfque la pièce eft chargée, on la place fur
l’ extrémité des doigts, & on la frappe légèrement
par,les côtés avec la fpatule , afin de donner
lieu , par ces petites fecopffes , aux molécules
de l ’émail broyé, de fe composer entre elles,
de fe ferrer 8c de s’arrangea
Gela fait, pour retirer l’eau que Vémail chargé
peut encore contenir, on place fur les: b#rds
un linge fin, blanc & fec , & oi) l’y laiffe tant
qu’il afpire de l ’eau. Il faut avoir l’attention
de le ’changer de côté: Lorfqü’ il n’afpire plus,
rien des bords, on y fait un pli large & plat,
qu’on pôle fur le milieu de ŸémaiLa. plufièurs
reprifes : après quoi on. prend la fpatule, & on
l ’appuie légèrement fur toute la furface de
Y émail, fans toutefois le déranger : car s’ il
arrivoit qu’il fe dérangeât, ii faudroit l’hu-
meéter de rechef, afin qu’ il le difposât convenablement
, fans le tirer du champlever.
Quand la pièce eft sèche, il faut l’expofer
fur des cendres chaudes, afin qu’il n’y refte
plus aucune humidité.;Pour cet'effet on a un
morceau de taule, percé de plufieurs petits
trous, fur lequel on la place. La pièce ell: fut
la taulë | la taule eft: fur la cendre : elle refte
en cet état jufqu’ à ce qu’ elle ne fume plus.
On obfervera feulement de la tenir chaude,
jufqn’au moment de lapafferau feu ; car fi on
l ’arvoin laiffe refroidir, il faudroit la réchauffer
peu-à peu à l’entrée du fourneau , fans quoi l’on
■ ex p o le toit Y émail à pétiller.
Une précaution prendre par rapport a la
taule percée de trous,, c’eft de la faire rougir
& de la battre, avant que de s’en fervir, afin
d’en leparer les écailles. Il faut qu’ elle ait les
bords relevés, enforte que la pièce que l’on
place deffus ^ n’y touchant que par fes extrémités,
le contre - émail ne s’ y attache point-.
On a des pinces longues & plattes, qu’on
appelle relève-mouftaches\ dont on fe fert pour
enlever la plaque 8c la porter au feu.
On paffe la pièce au feu dans unfourneau dont
on trouvera la figure Sc des coupes dans nos
planches de l’émiilleur , avec celles d’ un pain
■ d’émail, du mortier, de la molette , du chevalet,
de la fp a tule , des taules, du relève-mouftaches,
des rhoiiffLes , de la pierre à ufer, des inventaires
oc des autres outils du peintre fur
l ’émail.
Il faudra fe pourvoir de charbon de bois de
hêtrè , ou, à Ton défaut, de charbon de bois
de chêne. On commencera par charger le fond
de fon foiîrneau-devrais lits de branches. Ces .
branches auront un bon doigt de groffeur ; on
les coupera chacune de la longueur'de l’intérieur
du fourneau , ju (qu’à-fon ouverture. On les
«rangera les unes à côté des aurres, de manière
qu’elles fe touchent. On placera celles du
Beaux-Arts. Tome II.
fe#ond lit dans les endroits où celles du premier
lie fe.touchent, 8c celles-du troifième lit où fe
touchent celles du fécond ; enforte que chaque
branche du troifième lit foit portée fur deux
branches du fécond , 8c chaque branche du
fécond fur deux branches du premier. On
choifira des branches fort droites , afin qu’ elles
-ne laiffent point de vuide ; un de leurs bours
touchera le fond du fourneau , & l’autre cor-
refpondra à l’ ouverture. On a choifi cétte difpo-
fition , afin que s’ il arrivoit à une branche de
fe confumer trop promptement, on pût lui eit
iiabftituer facilement une autre.
Cela fait, on a une mouffle de terre ; on la
place lur ces lits de charbon , l’ouverture/toiir-
née du côté de la bouche du fournéau 8c Je
plus'à-ras de. cette.branche qu’ il eft poffible.
La raouffle placée, il s’agit de garnir fes côtés
& fa partie poftérieiire, de charbons débranchés.
Lés branches des. côtés font rangées comme
celles dés lits ; les poftérieures font miles
tranfverfalcment. Les unes & les.autres: s’élèvent
jufqu’ à la hauteur de la mouffle. Au defiè de
cette hauteur,. les.branches,font rangées longitudinalement
.& parallèlement à celles des lits.
I l n’y a qu’ un lit fur la mouffle.
Lorfque ce dernier lit eft fa it, on prend du
petit charbon de la même efpèce , & l ’on en
répand deffus , à la hauteur de quatre pouces.
C ’eft' alors qu’on couvre le fourneau de fon
chapiteau , qu’on étend fur le fond de la
mouffle trois ou cinq branches qui rempiiffent
fon intérieur en partie, & qu’on jette , par la
bouché du fourneau , du charbon qu’on a eu
le foin de faire allumer tandis qu’on chargeoit
le fourneau.
On a une pièce de terre qu’on appelle Vâtre ;
on la place fur la mentonnière y elle s’ élève à la
hauteur du fond de la mouffle. On a de gros
charbons de la même efpcce que celui des lits -
on en bouche toute l'ouverture de la mouffle ,
puis on laiffe le fourneau s’allumer de lui-même.
Le fourneau s’allume par l’air qui fe porte aux
fén tes pratiquées tant au fourneau qu’ à fon
chapiteau.
Pour s’affurer fi le fourneau eft affez allumé,
on retire Pâtre-, afin de découvrir le charbon
rangé en lits lbus la mouffle ; & lorfqa’on voie
ces lits également rouges par-tout, on remet
l’âtre 8c les charbons qui étçient deffus, & l’ on
a v iv e 'le feu en foufflant dans la mouffle avec
un fôufflet.
Si en ôtant la porte du chapiteau, on s’ap-
percevoit que le cfiarbon fe fût foutenii élevé
il fàüdroit le faire delcendre avec la pincetre
& aviver le feu dans la mouffb avec le fôufflet
après avoir remis la porte du chapiteau.
Quand la couleur de la mouffle paroîtra d’un
rouge blanc , il fera temps de porter la pièce
au feu y c’eft pourquoi on nettoiera le da
B r r