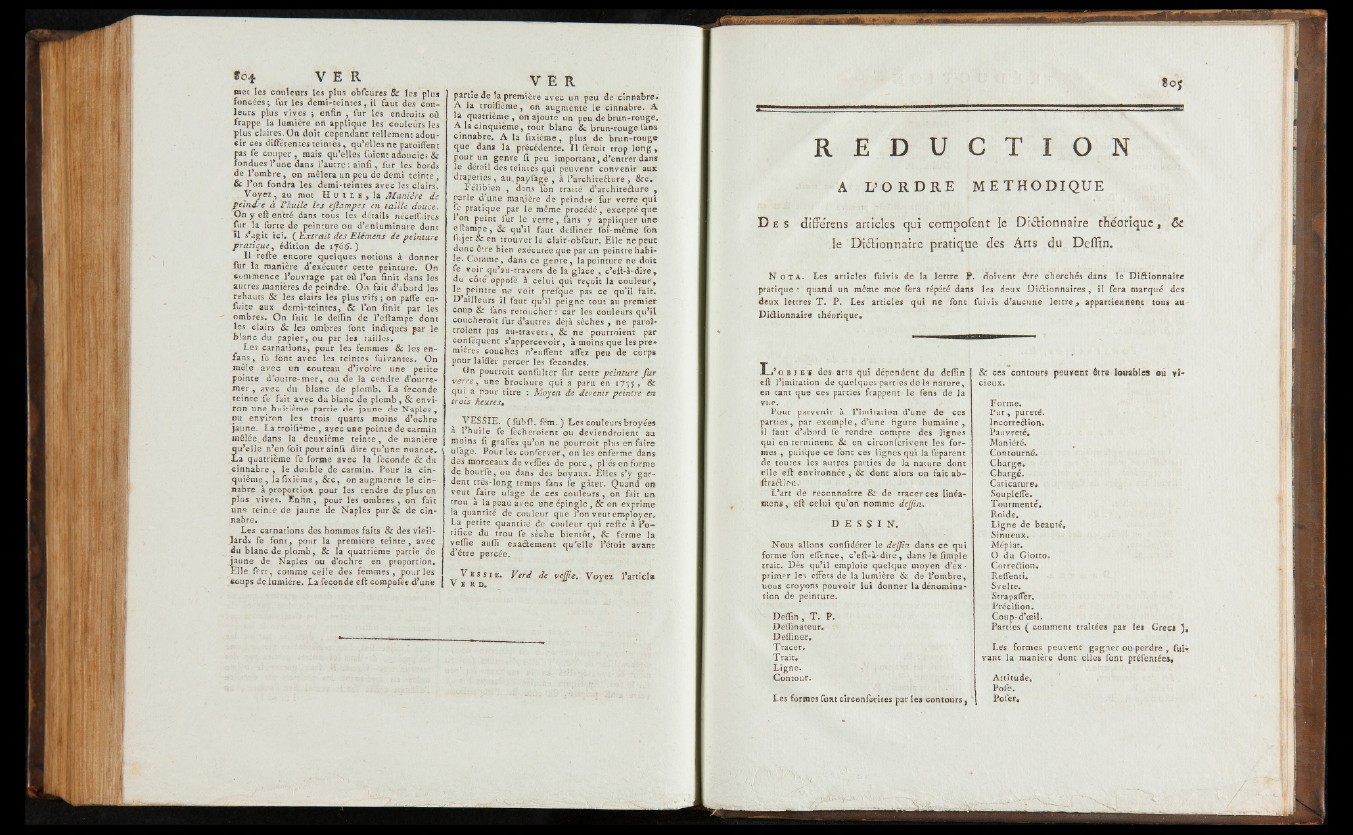
mec les couleurs les plus obfcures & les plus
foncées ; fur les demi-teintes , ii faut des couleurs
plus vives ; enfin , fur les endroits où
frappe la lumière on applique les couleurs les
plus claires. On doit cependant tellement adoucir
ces différentes teintés, qu’elles ne paroiffenc
pas fe couper, mais qu’elles fuient adoucies &
jondues-l’ une dans l’autre: ainfi, fur les bords
de l’ombre, on mêlera un peu de demi teinte
& V 'on fondra les demi-teintes avec les clairs. I
V o y e z , au mot H u i l e , la Manière de
feindre à ‘1*huile Us ejlampes en. taille douce.
On y eft entré dans tous les details nécéffirirés
fur la forte de peinture ou d’enluminure dont
il s’agit ici. [Extrait des Jilèmens de peinture
pratique, édition de i j 6G.)
Il refte encore quelques notions à donner
fur la manière d’exécuter cette peinture. On
commence l’ouvrage par où l’on finit dans les
autres manières de peindre. On fait d’abord les
rehauts & les clairs les plus vifs ; on paffe en-
fuite aux demi-teintes, Sc Ton finit par les
ombres. On fuit le deffin de l’eftampe dont
les elairs & les ombres font indiqués par le
blanc du papier, ou par les railles.
Les carnations, pour les femmes & les en-
fans, fe font avec les teintes fuivantes. On
mele avec un couteau d’ ivoire une petite
pointe d’outre-mer, ou de la cendre d’outremer
, avec du blanc de plomb. La fécondé
teinte fe fait avec du blanc de plomb, & environ
une huitième partie de jaune de Naples,
ou environ les trois quarts moins d’ochre
jaune. La troifi®me , avec une pointe de carmin
mêlée^dans la deuxième teinte, de manière
qu’elle n’en foit pour ainfi dire qu’une nuance, i
£3 quatrième fe forme avec la feçohde & du
cinnabre , le double de carmin. Pour la cinquième,
lafixième, & c , on augmente le cinnabre
à proportion pour les rendre de plus en
plus vives. Enfin, pour les ombres , on fait
une teinte de jaune de Naples pur & de cinnabre.
Les carnations des hommes faits & des v ieillards
fe font, pour la première teinte, avec
du blanc de plomb, & la quatrième partie de
jaune de Naples ou d’ochre en proportion.
Elle fe r t, comme celle des femmes, pour les 1
coups de lumière. La fécondé eft compofée d’une
partie de la première avec un peu de cinnabre.
A la troifième, oh augmente le cinnabre. A
la quatrième , on ajoute un peu de brun-rouge.
A la cinquième, tout blanc & brun-rouge fans
cinnabre, A la iixième, plus de brun-rouge
que dans la précédente. I l feroit trop long y
pour un genre fi peu important, d'entrer dans
le détail des teintes qui peuvent convenir aux
draper'iés , au.payfage , à l’architefture , & c .
Félibien , dans fon traité d’architeélure
parle d’une marfière de peindre fur verre qui
fe pratique par le même procédé, excepté que
Ion peint fur le verre, lans y appliquer une
®^ampe > & qu’ il faut deffiner foi-même fon
fujet & en trouver le clair-obfcur, Elle ne peut
donc être bien exécutée que par un peintre habile.
Comme, dans ce genre, la peinture ne doit
fe voir qu’au-travërs dé la glace , c’eft-à-dire ,
du coté ôppofé à celui qui reçoit la couleur,
le peintre ne voit prefque pas ce qu’il fait.
D ailleurs il faut qu’ il peigne tout au premier
coup & fans retoucher : car les couleurs qu’il
coucheroit fur d’autres déjà sèches , ne paroî-
troïent pas au-travers, & ne pourroient par
confëquent s’ appercevoir, à moins que les premières
couches n’euflent affez peu de corps
pour laifler percer les fécondés.
On pourroit confulter fur cette peinture fur
verre, une brochure qui a paru en 1755, &
qui a pour titre : Moyen de devenir peintre en
trois heures•
. VESSIE. ( fubft. fém. ) Les couleurs broyées
a 1 huile fe fecheroient ou deviendroient au
moins fi grafies qu’on ne pourroit plus en faire-
ufage. Pour les conferver, on les enferme dans
des morceaux de veffies de po-rc , pliés en forme
de bouffe, ou dans des boyaux. Elles s’y gardent
très-long temps fans fe gâter. Quand on
veut faire ufage de ces couleurs, on fait un«
trou a la peau avec une épingle , & on exprime
la quantité de couleur que l’on veut employer»
La petite quantité de couleur qui refie à Po-
rifice du trou fe sèche bientôt, & ferme la
veflie auffi exa&ement qu'elle l’étoit avant
d’être percée.
V e s s 1 e. Verd de vejjie. Voyez. Partiels
V E R D.
R E D U C T I O N
A L’ O R D R E M E T H O D I Q U E
D es différens articles qui compofent îe Di£tionnaire théorique, ôc
le Di&ionnaire pratique des Arts du Deffin.
N o t a . Les articles fuivis de la lettre P. doivent être cherchés dans le Di&ionnaire
pratique : quand un même moc fera répété dans les deux Dictionnaires , il fera marqué des
deux lettres T. P. Les articles qui ne font fuivis d’aucune lettre, appartiennent tous au
Diûionnaire théorique.
ï_ i’ o b j e t des. arts qui dépendent du deffin
eft l’imitation de quelques-parties de la nature,
en tant que ces parties frappent le fens de Ja
vue.
Pour parvenir à l’imitation d’une de ces
parties, par exemple, d’une figure humaine,
il faut d’abord fe rendre compte des lignes
qui en terminent^ & en circonlcrivent les formes
, puiique ce font ces lignes qui la féparent
de toutes les autres parties de la naturedont
elle eft environnée, & dont alors on fait ab-
■ ftraéTiC'U.
L’art de reccnnoître & de tracer ces ünéa-
mens, eft celui qu’on nomme dejjin.
D E S S I N.
Nous allons confidérer le dejjin dans ce qui
forme fon eflenee, c’eft-à-dire, dans le fimple
trait. Dès qu’ il emploie quelque moyen d’e x primer
les effets de la lumière & de l’ombre,
nous croyons pouvoir lui donner la dénomination
de peinture.
Deffin , T . P.
Deffinateur.
Deffiner,
T racer.
T rait.
Ligne.
Contour.
Les formes font cireonfetites par les contours,
& ces contours peuvent être louables où v icieux.
Forme.
P u r , pureté.
Incorreâion.
Pauvreté.
Maniéré.
Contourné.
Charge,
Chargé.
Caricature#.
Souplefle.
Tourmenté.
Roi de.
Ligne de beauté.
Sinueux.
Méplat,
O du Ciotto.
Corredion.
Reflenti.
Svelte.
Strapafler.
Précifion.
Coup-ft’oeil.
Parties ( comment traitées par le* G réel
Les formes peuvent gagner oii-perdre , fuit
vanc la manière dont elles font préfemée*.
Attitude.
Pofe.
Pofer,