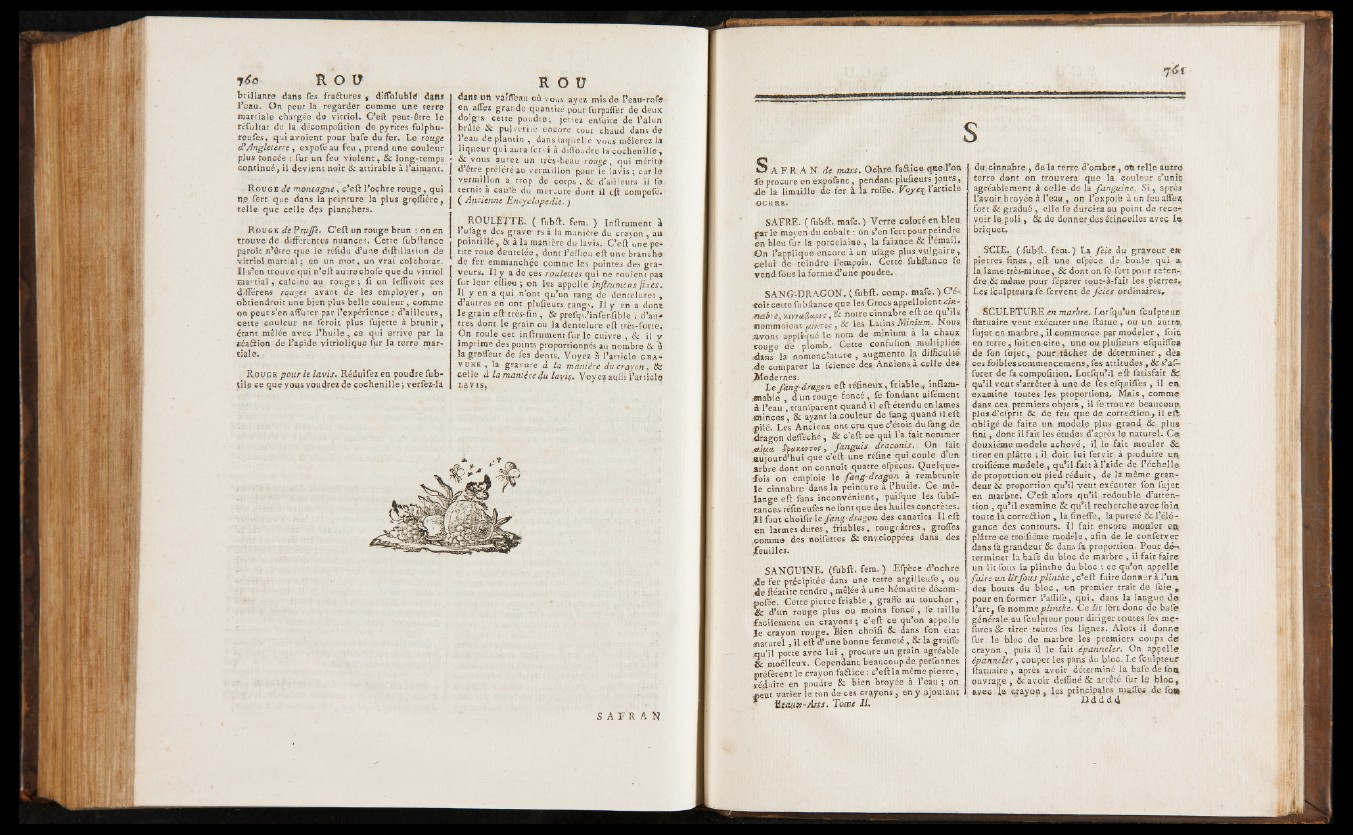
Hi 7<?o R O U
brillante dans Tes fraâures , difiolublé dans
l ’eau. On peut la regarder comme une terre
martiale chargée de vitriol. C’ eft peut-être le
rélultat de la décompofition de pyrites fulphu-
reufes, quiavoient pour b^afe du fer. Le rouge
à? Angleterre , expole au feu , prend une couleur
plus foncée : fur un feu v iolen t, & long-temps
continué, il devient noir & attirable à l’aimant.
R o ug e de montagne, ç’ eft l’ochre rouge, qui
fïj3 fert que dans la peinture la plus grçffière,
telle que celle des planchers.
R ouge de PrftJJe. C’eft up rouge brun ; on en
trouve de differentes nuances. Cette fubftance
parole n’ être que le réfidu d’une diftillarion d.e
vitriol martial ; en un mot, un vrai colchotar.
I l s’en trouve qui n’eft autre chofe que du vjtriol
martial, calciné au rouge -, fi on lefiivoit ces
diffère ns rouges avant de les employer, on
obeiendroit une bien plus belle couleur, comme
on peut s’en affurer par l’expérience ; d’ailleurs,
ç.ette couleur ne feroit plus fujette à brunir,
étant mêlée aveç l’h u ilç , ce qui arrive par la
«éafition de l’apide vitrioliqu,e ipr la terre martia
le i
R o ug e pour le lavis. Réduifez en poudre fub-
tile ce que vous voudrez de cochenille -, verfez-la
R O ü
dans un vaifleau où vous ayez mis de l’eau-rofe
euaflez grande quantité pour furpafler de deux
doigts cette poudre; jetiez enl’uite de l’alun
brûlé & pulvérife encore tout chaud dans de
1 eau de plantin , dans laquelle vous mêlerez la
liqueur qui aura fefvi a difloudre la cochenille ,
& vous aurez un trèç-beau rouge, qui mérite
d’etre préféré au vermillon pour le lavis ; car le
vermillon a trop de çorps , tk. d’ailleurs il fe
ternit à cau'fe du mercure dont il eft cojnpofé*’
( Ancienne Encyclopédie. )
f ROULETTE. ( fubft. fem. ) Infiniment à
I uPage des graveurs à la manière du crayon , au
pointillé, & à la manière du lavis. C’eft une pe»
tite roue dentelée, dont l’ efîieu eft une branche
de fer emmanchée comme les pointes des graveurs.
Il y a de çes roulettes qui ne roulent pas
fur leur ellieu ; on Jes appelle inflrumtns fixes»
II y en a qui n’ont qu’un rang de dentelures ,
d’autres en ont plusieurs rang'. Il y en a dont
le grain eft très-fin , & prefqu’infenfible ; d’au?
tre$ dont le grain ou la dentelure eft très-forte«'
On roule cet inftrument fur le cuivre , & il y
imprime des points proportionnés au nombre & ê
la groifeur de fe s dents. Voyez và l’article gravure
, la gravure à la manière du trayon, 8c
celle a la manière du lavis. V©y,e? aitlli l ’article
S A F R A N
7<îl
S a f r a n de mars. Ochre fa â iç e qttel’on
fe procure en expofant, pendant plufieurs. jours,
.de la limaille de fer à la rofée. l’article
oCH RE.
SAFRE. (fubft. mafe.) Verre coloré en bleu,
par le moyen du cobalt : on s’en fert pour peindre
en bleu fur la porcelaine, la faïance & l’émail.
On l’applique-encore-à un ufage plus vulga ire ,
celui de teindre l’empois. Cette fufaftance fe.
vend fous laforme-d’ une poudre.
SANG-DRAGON. ( fubft. comp. mafe.) C*é~
-toit cette fubftance que les Grecs appellpientui»-
■ nabre, mvvcl^ ç , & notre cinnabre eft ce.qu’ ils
«ommoient m/xt<*, & k s Udn^Minium, Nous
.avons appliqué le nom de minium a la chaux
rouge de plomb. Gette confufion multipliée,
dans la nomeaclatuce , augmente la éifueuke
,<ie comparer la fcience des Anciens a -celle, des,
Modernes. ,
Le fang-iragan eft réfin eux, triât l e , înflam-
-unable , d'un rouge foncé, fe fondant ai il ment
.à l’ eau ,.rranlparent quand il eft ecendu en lames
jnïnces , & ayant la couleur de iâng quand il eft
Ifilé. Les Anciens ont cru que c’étoit du fang de
dragon defféché, & c’elbce qui l’a, fait nommer
.«lit» SiüMrrof, frngius draconls. On fait
aujourd’hui que c’eft une refine qui coule d un
arbre dont on connolt quatre efpeces. Quelque,
“fois on emploie le fang-dra gon à -rembrunir-
le cinnabre dans la peinture à l’huile. Ce mélange
eft fans inconvénient, puilque les fubf-
tances réfineufes nefontque des huiles-cancre tes.
11 faut cho'iir le fa n f dragon des Canaries. II eft
en larmes dures, friables, rougrâtres, gtofles
.comme des noifettes & enveloppées dans des
feuilles.
SANGUINE, (fubft. fem. ) Efpèce d’ochre
.de fer précipitée dans une terre argilleufe, ou
de ftéatite tendre , mêlée à une hématite décom-
pofée. Cette pierre friable , grade au toucher,
& d’un rouge plus ou moins foncé , le taille
facilement en crayons ; c’eft ce qu’on appelle
ée crayon rouge. Rien c.hoifi & dans fon état
naturel , il eft d’ une bonne fermeté, & lagraiffe
qu’il porte avec lu i , procure un grain agréable
& moelleux. Cependant beaucoupde perfonnes
préfèrent,le prayon fadipe : C*eft la même pierre,
ï^uite en poudre & bien broyée à l’eau ; on
peut varier le ton de ces crayons, en ykijoutant
* Meaux-Arts. Tome IL
S
du,cinnabre > d elà terre d’ombre, oti telle autrd
'J terre dent on trouvera que la couleur s’ uniç
agréablement à ce lle de la fanguine. S i , après
l ’avair broyée à l ’eau , on l ’expo le à un feu aifferç
i fort 8c gradué , elle fe durcira au point de recevoir
le p o li, & de donner des étincelles avec le.
■ briquet.
i SCIE. ( fubft., fem. ) La fe ie du graveur etc
' pjerres fines, eft une, efpèçe, de. boule qui Xj
\ la. lame très-mince, 8ç dont on fe fert pour referir*
dre & même, pPUF fpparer tout-àrfait les pierres.
Les ftulpteursfe fervent de feies ordinaires*
SCULPTURE en marbre. Lorfqu’un fculpteun
j ftatuaire veut exécuter une fta.tup , ou un autre.
; fujet en .marbre, ilcomm&nçe par modeler, foin
; en terre, lpit.cn c ire , une ou plufteurs, elquiftep
j de fon ferjee, pour.;tâcher de déterminer , dè»
I ceifoiblescommencemens, fes attitudes, & s’af<
furer de fa compoûtion. Lorfqu’ îl eft fatisfait 8t
qu’il vent s’ arrêter, à une dp fes eiqni^fes, il en
examine toutes les proportions. Mais, comme
dans ces. premiers ob jets , il fe'trouye beaucoup,
; plus d’efprit. & de feu que. de correélion> il eft
obligé d é fa ire un modèle, plus grand & plus;
fini , dont il fait les études d’appès le naturpl. Ce.
deuxieme modèle achevé , H le fait mouler &
tirer en plâtre ; il doit lui fervir à produire uft
troiftéme modèle,, qu’ il fait à l’aide de l’échelle
de proportion.ou pied réduit, de làTnême grandeur
& proportion qu’ il v eut exécuter fon fujet
en marbre. G’eft alors qu’ il redouble d’attention
, qu’ il examine & qu’ il recherche ayec foin
toute la correélion , la fîneffe,, la pureté & l’élégance
des contours. II fait encore mopler ea
plâtre ce trolfiéme modèle, afin de le conferver
dans fa grandeur & dans fa proportion. Pou-r dé-*,
terminer la ba'fo du bloc de marbre , il fait faire
un lit fous la plinthe du bloc ; ce qu’on appelle
faire un Ut fou s plinthe , ç’ eft faire donner à l’ uni
des bouts du b lo c , -un premier trait de feie %
pour en former l’ affife, q ui, dans la langue de,
l ’art, fe nomme plinthe. Ce lit fort donc de bafo
générale au fculpteur pour diriger toutes fes me-
fures & tirer toutes fes lignes. Alors il donne
fur le bloc de marbre les premiers coups de
crayon , puis il le fait épanneler. On appelle
èpanntler, couper les pans du bloc. Le fculpteur
Actuaire, après avoir déterminé la bafedefon,
ouvrage , & avoir delfiné & arrêté fur le bloc ,
avec , fe crayon , les principales malles de foai
D d d d d