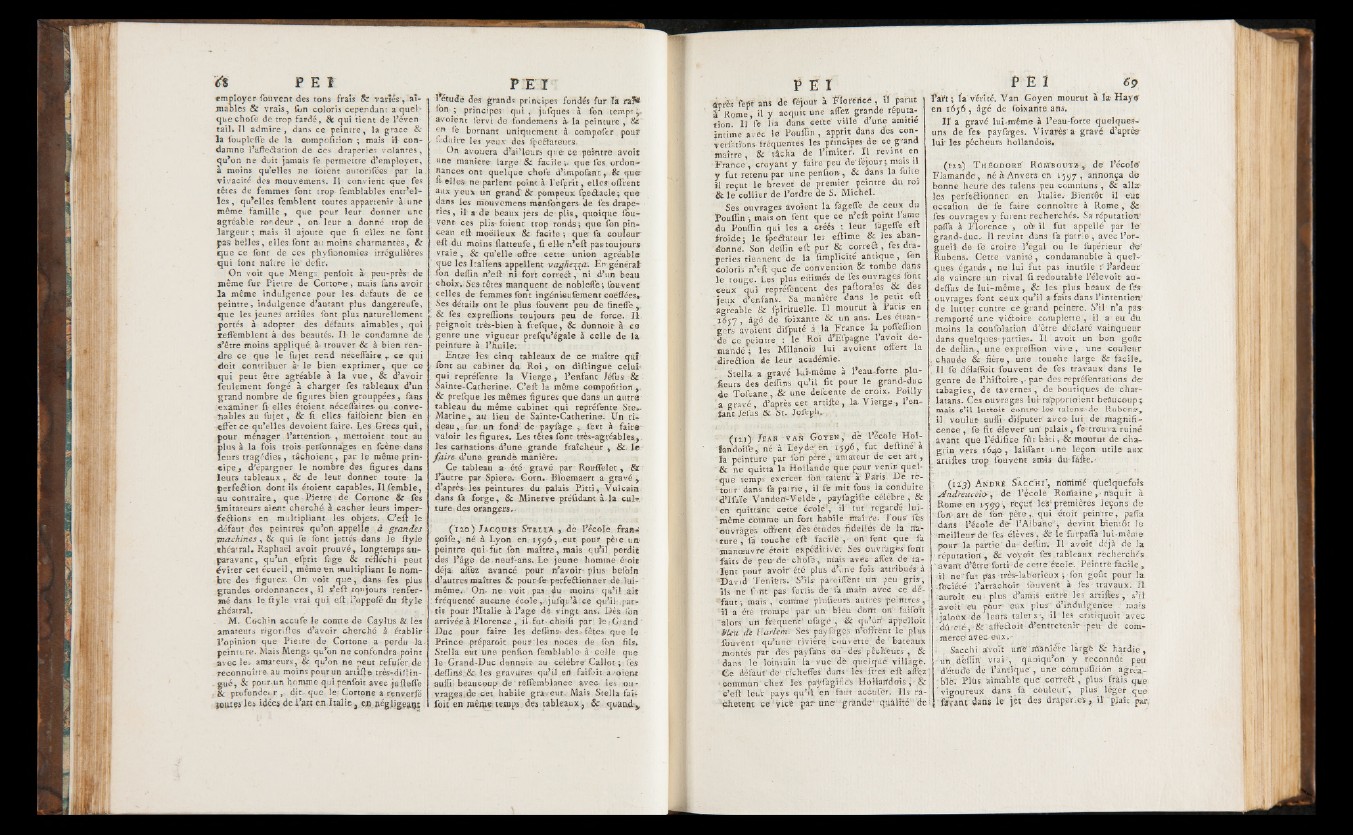
employer foiivent des tons frais 8s variés,-aimables
& vrais, fon coloris cependant a quelque
chofe de trop fardé, 8c qui tient de l’ëven
tail. Il admire , dans ce peintre, la grâce 8c
la fouplcflè de la compontion ; mais il1 condamne
l’aifeéfation de ces draperies volantes,
qu’on ne doit jamais fe permettre d’ employer,
à moins qu’elles ne i'oient aurorifées par la
vivacité des mouvement. Il convient que fes
têtes de femmes font trop- femblables entr’ el-
le s , qu’elles fenvblent toutes appartenir à: une
même famille , que pour leur donner une
agréable rondeur , on» leur a donné trop de
largeur ; mais il ajoute que fi elles ne font
pas belles, elles font au moins charmantes, 8c
que ce font de ces phyfionomies irrégulières
qui font naître le ' defir.
On voit que Mengs penloit à' peu-près de
même fur Pietre de Çortone, mais (ans avoir
la même indulgence pour les- defauts de ce
peintre, indulgence d’autant plus dangereufe,
que les jeunes arciftes font plus naturellement
portés à adopter dès défauts aimables, qui
leflemblent à des beautés. Il le condamne de
s’être moins appliqué à- trouver & à bien rendre
ce que le fujet rend néceflaire r ce qui
doit contribuer à- le bien exprimer, que* ce
qui peut être agréable à la v u e , & d’avoir
feulement fongé à charger fes rableaux d’ un
grand nombre de figures bien grouppée.s, fans
examiner fi elles étoient néceffaires- ou convenables
au fu je t, & fi elles faifoienr bien en
-effet ce qu’elles dévoient faire. Les Grecs qui,
pour ménager l’attention- , mettoient tout au
plus à la fois trois perfonnàges en fcène dans
leurs tragédies, tâchoient, par le même principe
y d’épargner le nombre des figures dans
leurs tableaux r & de leur donner toute la
perfeôion dont ils étoient capables. I l femble,
au contraire, que Pietre de Çortone 8c les
Imitateurs aient cherché à cacher leurs im-per-
feélions en multipliant les objets. C’en le
défaut des peintres qu’on appelle à grandes
machines, & qui fe font jettes dans le ftyle
théa’ ral. Raphaël avoit prouvé-, longtemps auparavant,
qu’un efprit fage & réfléchi peut
éviter cet écue il, même en multipliant le nombre
des figures; On voit que , dans fes plus
grandes ord onnances il sfeft tqujours renfermé
dans le ftyle vrai qui eft. ï.’oppofé du ftyle
théâtral.
M. Cochln accufe le comte de Caylüs &. lès
amateurs rigoriftes d’avoir cherché à établir
l ’opinion que Pietre de Cortone a perdu la
peinture. Mais Mengs quron ne confondra point
avec les amateurs, & qu’on ne peut refuferde
. reconnoîrre> au moins pour un artifte très-diftin-
gué, & pour un homme qui penfoit avec jufteffe
• 8c profondeur , dit. que. le: Çortone a renyerfé
joute» fe» idées de l ’art en.Italie 3 en. nég lig en t
fàstude des grands principes fondés fur la ra?K
Ion ; principes qui., jufques à fon temps
«voient fervi de fondemens à la peinture , &
en lé bornant uniquement à compofer pour
feduire les yeux des fpeâfate’urs.
On avouera d-ai’ Leurs que- ce peintre avoit
une manière- large1 & facile que lès ordonnances
ont quelque chofe d’ impofant, & que’
fi'eHe& ne-parlent point à Telprit, elles-offrent
aux yeux un grand- 8c pompeux fpe&acle; que
dans les mbuvemens racnfongers- de les draperies,
il a de beaux jets de-plis, quoique fou-
vent: ces plis-Toient trop ronds; que fon pinceau
efb moelleux & facile ; que' fa couleur'
eft du moins flatteufe, fi elle n*eft pas-toujours
vraie , & qu’elle offre cette* union agréable
que les Italiens appellent vaghe\^a\ En-générât
fon deffin n’eft ni fort correéf, ni d’ un beau
choix. Ses têtes manquent de nobleffe; fouventf
celles de femmes font ingénieufoment coëffées*
• Ses détails ont le plus fouvent peu de fineffe L
- & fes expreffions toujours peu de force, II.
peignoit très-bien à frefque, & donnoit à ce
genre une vigueur prefqu’égale à celle de la
peinture à l’huile;
Entare lés cinq tableaux de ce maître quî
font au cabinet au- R o i, on di flingue celui;
qui repréfente la V ie r g e , l’enfant Jéfus &
Sainte-Catherine. C’eft la même compofîtion ,
& prefque les mêmes figures que dans un autre
tableau du même cabinet qui repréfente Ste*-
Màriner au lieu de Sainte-Catherine. Un rideau,
fur un fond'de payfage. lèrt à faire
valoir les figures. Les têtes font très-agréables,,
les carnations-d’une grande fraîcheur , &• le
faire d’ une grande manière;
Ce tableau a été gravé par' Roufielet, &
l’autre par Spiere. Corn. Bloemaert a gravé ,
d’après-, les peintures du palais Pitti, Vulcain
dans fa forge, & Minerve préfidant à la cuir,
xure» des orangers.-
( i z o ) Jacques Stella , de l’ecoje fran-i
çoife, né à Lyon en 1596, eut pour père un;
peintre qui-fut .fon maître, mais qu’ il perdit
dés l’âge de neuf-ans. Le jeune homme et oit
déjà? aflez avancé pour iravôir> plus befoin
d’autres maîtres 8c pou r>-fe- p er feét ion p e r d è l üi -
même.. On» ne voit pas du moins qu’ il -.ait
fréquenté aucune école,/>jufiqp’à-rCè qu’ il;,partit
pour l’Italie à l’age dè vingt ans. Dès. ion
arrivée à Florence , il-fut-ch'oifi par- le; Grand'
Duc pour faire les deffins» des » fêtes que le
Prince préparoit pour?-les noces de fon fils»
Stella eut une penfion ferablable' à-celle que
le Grand-Duc donnait au célèbre- Cal lot-; fes
deffinS les gravures qu’ il eiî faifoit, avoient
auffir beaucoup-; de ' relfemblance avec» les qu -
vrag.es!de cet habile graveur. Mais Stella fai*
foit en jnêiue temps, des tableaux , &: quand *
*pf& fet5t' ans de féjout à ï'ïoréncé , iï | w 5 Rome, il y acquit une aflea grande reputa-
tion. I l fe La dans cette v ille dune amitié
intime avec le Pouffin , apprit dans des con-
verfati'ons fréquentés les principes de ce grand
maître, & tâcha de l’ imiter. I l revint en
f tancé croyant y faire peu de'féjour; mais il
y fut retenu par une penuow, 8c dans la fuite
il reçut le brevet de premier peintre du roi
6 le collier de l ’ordre de S. Michel.
Ses ouvrages avoient la fageffe de ceux du
Pouffin ; mais on fent que ce n’eft point 1 ame
du Ppuffin qui les a créés : leur lageffe eft
froide: le fbe&ateur les eftime & les abandonné.
Son deffin eft pur 8c correct, fes draperies
tiennent de la fimplicité antique, ton
coloris n’eft que de'convention & tombe dans
le rouge. Les plus eftimés de les ouvrages font
ceux qui repréfentent des paftorales & des
jeux d’ er.fans. Sa manière dans le peut eft
agreabie & fpirituelle. I l mourut a Pana en
i 657 , âgé de foixanie & un ans. Les étrangers
avoient difputé à la France la poffeffion
de ce peintre : le Roi d^Elpagne l’avoit d e - .
mandé ; lés Milanois lui avoient offert la ;
direélion de leur académie.
1 Stella, a gravé lui-même à l’eau-forte plu-
"fieurs des deffisis qu’ il fit pour le grand-duc
de Tofcane ,. 8c une defeente de croix. Poilly
a gravé, d’après cet artifte , la- Vierge , l’enfant
Jéfus & St. Jofeph,-,
( n i ) ’ Jbak y a s Goyen dé l’icole Hol-
tandoffe,; né à Léydéèèn J ïyçié, fut deftiné’ à
la peinture par fon pèré,! amateur de cet art ,
& ne quitta la Hollande que-pour venir- quel-
que temps exercer fort raient â Paris'. De retour'
dans fa pairie, il fe mit fous la conduite
d’ ifaïe Vanden'-Veldë , paylagifte célèbre , &
■ en quittant cette- école’, il tut regardé ltri-
■ même comme un fort Habile maîtrei Tous lés
ouvragés offienc dès études fidelles dè la' tta-
«ture; fâ touche eft ïaerië , on fpnt que fa
manoeuvre étoit eXpeditivec Ses ouvragés"font
faits de peu’ de choie-, mais avec aflez de' talent
pour avoir'été plus d’ une fois attribués'à
■ David Téniers.' S’ils- parqiffènt un peu gris,
ils-ne f'r r f pas fprlis de fa main avec ce défaut
-, mais', comme plufieiirs autres 'peintres,
il a été trompe par un~ bleu dont oit1 faifoït
'alors un fréquent' ufagé, Si qu’ôrf- appelloit
t'Uu <ft tiariemi Ses pay figés tftârtnt le' plus
fouvént qu’ une" rivière, couverte de bateaux
montés pat des' payfans ou des' pcch’eurs , &
dans le lointain la' vue- dè quelque villâgè.
Ce défaut’ dé‘ richeffes:'darts' les fl-es eft- affpz
'commun ch e i’ les payfagHiés Hollartdois
c’eft leur pays qu’ il en faut accufêr. Iis ri-
chetent ce vie® par une’ grande*-quâlite"de
fart ; la vérité. Van Goyen mourut à la- Haye
en 1656, âgé de {(fixante ans.
I î a gravé lui-même à l’ eau-forte quelques-
uns de fes- pàyfages. Vivar-ès* a gravé d’après;
lui- les pêcheurs hollandois.
(n a ) T héodore Rü j ï b o u t z dé l ’écol©’
Flamande, né à Anvers en 159 7, annonça dé
bonne heure des talens peu ccmniuns , 8c allar
les perfectionner en Italie.- Bientôt il eue
occafion de fe faire connoître à Rome, &
fes ouvrage» y furent recherchés. Sa réputation'
pafia à Florence , où* il fut appelle par le
grand-duc.- Il revint dans fa p'atrie , avec l’orgueil
de fe croire l ’égal ou le fupér-ieur àç-
Rubens. Cette vanité, condamnable à quelques
égards^ ne lui fut pas inutile l’ardeur'
de vain-cre un rival fi redoutable Félevoit au-
deflùs de lui-même, & les plus beaux de fes
i ouvrages font ceux qu’ il a faits dans l?intention!
de lutter contre cè grand peintre. S’ il n’a pas-
remporté une viéloire complerte , il a eu dü
moins la confolation d’être déclaré vainqueur
dans quelques- parties. I l avoit un bon goût
de defiiiv, une expreffion v iv e , une couleur
„ chaude & fière, un© touche large & facile»
’ I l fe délalïbit fouvent de fes travaux dans le
genre de l’hiftoire par-des repréfentations de-
tabagies, de tavernes, de boutiques de charlatans.
Ces ouvrages lui ra'pportoient beaucoup ;
mais s’ il luttoit contre les talens-'de Rubens«,
il voulut- aufli' difputer avec- lui de magnifi-
' cence , fe- fit élev-er-'un palais , fe'trouva ruiné
avant que l’édifice fût b â ti,-& mourut de chagrin
vers 1640 , laiffant une leçon utile aux
I artiftes trop, fouvent amis du-fàfte.*
~ (i 13) A ndré Sacc'hi;, nommé quelquefois
A n d ’reucùixy, de l ’école Romaine, naquit à
Rome en 1-5^9y rè çu f les*premières leçons de
" fort-art de loir père,, qui étoit peintre, pafla
dans l’école de l’Àlba'ne5^ devint bientôt le
-meilleur de fes élèves', 8c le furpaffa lui-même
pour la partie' du- defiin'. Il avoit déjà de Ja
: réputation', & vô'yoit fes .tableaux recherchés
' avant d’êtreforti-de cette école«» Péifttrë facile ,
il ne ’ fut pas très^laborîeux ; fon goût pour la
j ;fociété Farràchoit fouvent à- les travaux. Il
; auroit eu plus d’ àrtiiâ entré les artiftes, s’ il
; avoit' ’eïi p&ur* eux plus" d’ indulgence ; mais
j -jaloilx d© leUrf» talers*, il'le s entiquoît'avec
• dûrCLé, 8c affèéloic d’-entre'tenk -petr de com-
. mêrce1’ avec eux.-
& Sacchi «voit urfè’iflànlè'ré"largè & hardie,
-Un dêifin vrai-', quoiqu’on y reconnût peu
d’écuH'è dé l’antique', une cômpoficiôn agréa-
FlèV Plüs aimàblre quë correéf , plus'frais que
Rigoureux dans fâ couleur', plus' léger que.
l'&yant'dan's le jêt des draperies r il pjaîc par.