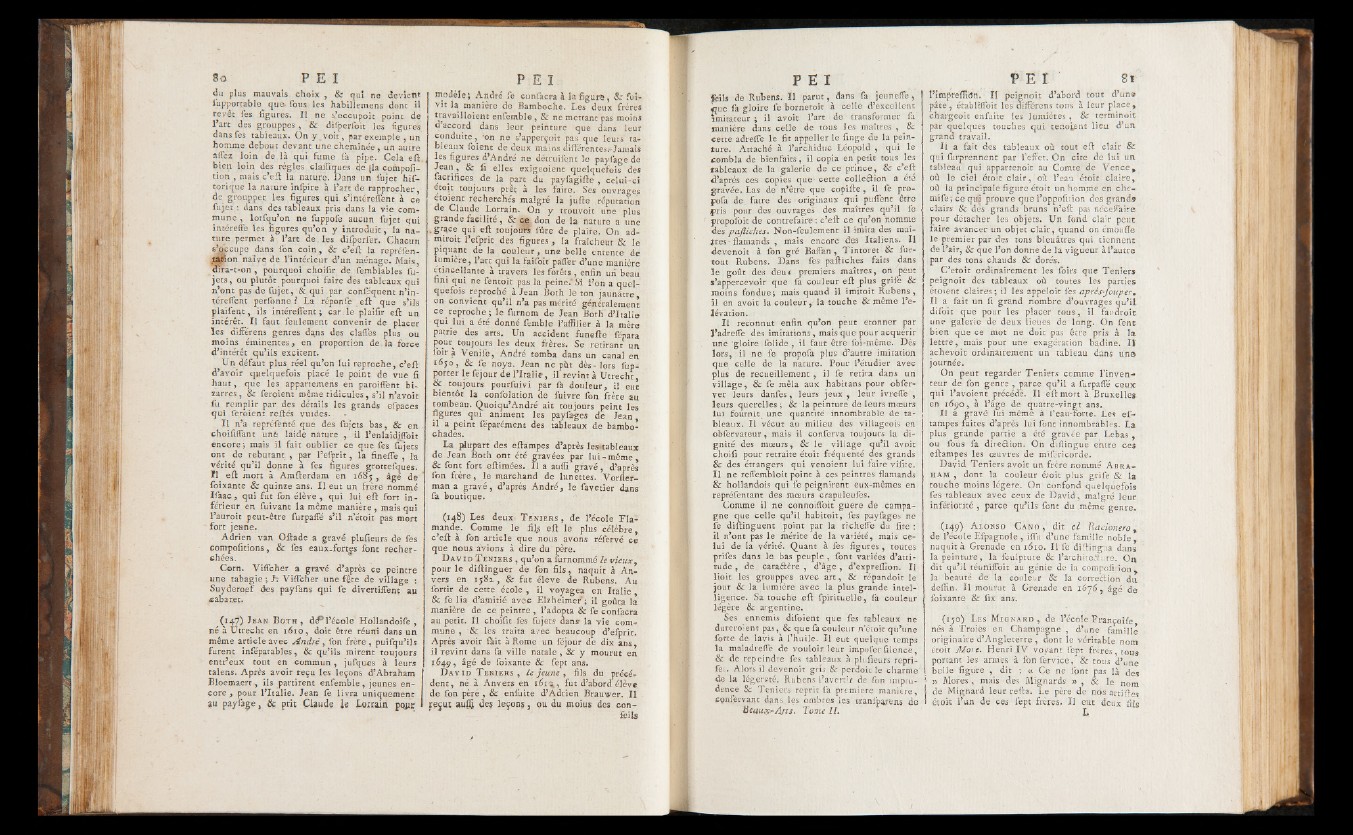
4U plus mauvais choix , & qui ne devient
Supportable^ que. fous les habillemens donc il
revêt Tes figures. Il ne s’occupoit point de
Tart des grouppes, & difperfoit les figures
dans Tes tableaux. On y v o it , par exemple , un
homme debout devant une cheminée, un autre
affez loin de là qui fume fa pipe. Cela eft,
bien loin des règles clafliques de (la compofi-
tion , mais c’eft la nature. Dans un fujet hif-
torique la nature infpire à Part de rapprocher
de groupper les figures qui s’ intéreflentà ce
fujet : dans des tableaux pris dans la vie commune
, lorfqu’on ne fuppofe aucun fujet qui
intéreffe les figures qu’on y introduit, la nature
permet à l’art de. les difperfer. Chacun
^occupe dans fon co in , & c’eft la repréfen-
llplon naïve de l'intérieur d’ un ménage. Mais,
dira-t-on, pourquoi choifir de femblables fuje
ts , ou plutôt pourquoi faire des tableaux qui
n’ùnt pas de fujet, & qui par conféquent n’in-
t;éreflent perfonrie ? La réponfe.eft que s’ ils
plaifent, ils intéreflent ; car . le plaifir eft un
intérêt. Il faut feulement convenir de placer
le s dlfFérens genres dans des clafles plus ou
moins éminentes, èn proportion de. la force
d’ intérêt qu’ ils excitent.
Un défaut plus réel qu’on lui reproche, c’eft
d’avoir quelquefois placé le point de vue fi
h au t, que les appartemens en paroiflent bizarres
, & feroient même ridicules, s’ il n’avoit
fu remplir par des détails les grands efpaces
qui feroient refiés vuides.
I l n’a repréfenté que des fujets bas, & en
choififlant uné laide nature , il l’ enlaidiffoit
encore-, mais il fait oublier ce que fes fiqets
ont de rebutant , par l’efprit, la finefle , la
vérité qu’il donne a fes figures grottefques.
J 1 eft mort à Amflerdam en 1685 , âgé de
foixante & quinze ans. U eut un frère nommé
I faac , qui fut fon é lè v e , qui lui eft fort inférieur
en fuivant la même manière , mais qui
l’auroit peut-être furpafle s’il n’étoit pas mort
fort jeune.
Adrien van Oftade a gravé plufieurs de fes
pompofitions, & fes eaux-fortes font recherchées.
Corn. Viflcher a gravé d’après ce peintre
une tabagie -, h Viflcher une fête de village :
Suyderopf des payfans qui fe divertiflent au
cabaret,
(147) Jean B o th , d ^ l ’école Hollandoife ,
né à Ütrecht en 1610, doit être réuni dans un
même article avec Andr é , fon frère, puifqu’ils
furent inféparabîes, & qu’ ils mirent toujours
entr’eux tout en commun, jufques à leurs
talens. Après avoir reçu les leçons d’Abraham
Bloemaerr, ils partirent enfemble, jeunes encore
y pour l’ Italie. Jean fe livra uniquement
?u payfage, & prit Claude le Lorrain po^ir
modèle; André fe confacra à la figure, & fui>
vit la manière de Bamboche. Les deux frères
travailloient enfemble , & ne mettant pas moins
d accord dans leur peinture que dans leur
conduite, -on ne s’apperçoit pas que leurs ta-
bleaux foient de deux mains différentes*Jamais
les figures d’André ne détruifent le payfage de
Jean, & fi elles exigeoient quelquefois des
facrifices de la part du payfagifte , celui-ci
etoit toujours prêt à les faire. Ses ouvrages
etoient recherchés malgré la jufle réputation
de Claude Lorrain. On y trouvoit une plus
grande fa c ilite , 8c o«| don de la' nature a une
.grâce qui eft toujours fiûre de plaire. On ad-
. miroit l ’efprit des figures > la fraîcheur 8c le
piquant de la couleur, une belle entente de
lumière, l’art qui la faifoit'pafler d’une manière
etincellante à travers les forêts, enfin un beau
fini qui ne fentoit pas la peine.*Si l ’on a quelquefois
reproché à Jean Both le ton jaunâtre
on convient qu’ il n’a pas mérité généralement
ce reproche ; le furnom de Jean Both'd’Italie
qui lui a été donné femble l’affilier à la mère
patrie des arts. Un accident Junefte fépara
pour toujours les deux frères. Se retirant un
foira Venife, André tomba dans un canal en
1050, & fe noya. Jean ne pût dès-lors fup^
porter le féjour de l’I ta lie , il revint à Utrecht,
& toujours pourfuivi par fa douleur, il eut
bientôt la confolation de fuivre fon frère au
tombeau. Quoiqu’André ait toujours peint les
figures qui animent les payfages de Jean,
il a peint féparément des tableaux de bambo-
chades.
La plupart des eftampes d’après les«tableaux
de Jean Both ont été gravées par lu i-m êm e ,
& font fort eftimées. Il a auflï gra vé, d’après
fon frère, le marchand de lunettes. Vorfter-
man a gra vé, d’aprèç André, le favetier dans
fa boutique.
(148) Les deux Teniers , de l ’école Flamande.
Comme le filjs eft le plus célèbre,
c’eft à fon article que nous avons réfervé ce
que nous aîvions à dire du père.
David Teniers , qu’on a furnojïiiné le vieuxr,
pour le diflinguer de fon f ils , naquit à Anvers
en 158a, & fut élève de Rubens. Au
fortir de cette école , il voyagea en Italie ,
& fe lia d’ajnitié avec Elzheimer ; il goûta la
manière de ce peintre , l’adopta & fe confacra
aü petit. I l choifit fes fujets dans- la vie com*
mime , & les traita avec beaucoup d’ éfprit.
Après avoir fiut à Rome un féjour de dix ans,
il revint dans fa v ille natale, & y mourut en
1^49, âgé de foixante & fept ans.
David Teniers , le jeune , fils du précér
dent, né à Anvers en 161^, fut d’abord élève
de fon pèré, & enfuite d’Adrien Brauwer. I l
reçut aufiji des leçons , ou du inoius des conseils
JfeHs de Rubens. I l parut, dans fa jeunefle,
flue fa gloire fe borneroir à celle d’excellent
imitateur ; il avoit l’art de transformer fa
manière dans celle de tous les maîtres , 8c
cette adrefle le fit appeller le finge de la peinture.
Attaché à l’archiduc Léopold , qui le
combla de bienfaits, il copia en petit tous les
tableaux de la galerie de ce prince, 8c c’eft
d’après ces copies que1 cette colleétion a ete
gravée» Las de n’ être que copifte, il fe pro-
pofa de faire des originaux qui puflent être
pris pour des ouvrages des maîtres qu’ il fe
propofoit de contrefaire : c’eft: ce qu’on nomme
des pafiiehes. Non-feulement il imita des maîtres
flamands , mais encore des Italiens. Il
devenoit à fon gré Baflan, Tintoret & fur-
tout Rubens. Dans fes paftiches faits dans
le goût des deu* premiers maîtres, < on''peut
s’appercevoir que fa couleur eft plus grife &
moins fondue; mais quand il imitoit Rubens,
il én avoit la couleur, la touche 8c même l’élévation.
I l reconnut enfin qu’on peut étonner par
J’adrefle des imitations, mais que pour acquérir
une gloire folide , il faut être foi-même. Dès
lors, il ne fe propofa plus d’autre imitation
que celle de la nature. Pour l’étudier avec
plus de recueillement , il fe retira dans un
v illa g e , & fe mêla aux habitans pour obfer-
ver leurs danfes, leurs jeux . leur ivreflè ,
leurs querelles -, & la peinture de leurs moeurs
lui fournit, une quantité innombrable de tableaux.
I l vécut au milieu des villageois en
obfervateur, mais il conferva toujours la dignité
des moeurs, & le village qu’ il avoit
çhoifi pour retraite étoit fréquenté des grands
& des étrangers qui venoient lui faire vifite.
I l ne reflembloit point à ces peintres flamands
& hollandois qui fe peignirent eux-mêmes en
repréfentant des moeurs crapu leu fes.
Comme il ne connoifloit guere de campagne
que celle qu’ il habitoit, fes payfages ne
fe distinguent point par la richefle du fite :
il n’ont pas le mérite de la variété, mais celui
de la vérité. Quant à fes figures , toutes
prifes dans le bas peuple, font variées d’attitude,
de cara&ère , d’â g e , d’expreflïon. Il
li.oit les grouppes avec a r t, & répandoit le
jour 8c la lumière avec la plus grande intel-'
ligence. Sa touche e ft fpirituelle, fa couleur
légère 8c argentine.
Ses ennemis difoient que fes tableaux ne
dureroient pas, 8c que fa couleur n’éioit qu’une
forte de lavis à l’huile. Il eut quelque temps
la maladrefle de vouloir leur impofer filence,
8c de repeindre fes tableaux à plufieurs repri-
fe£. Alors il devenoit gris 8c perdoit le charme'
de la légèreté. Rubens l’avertir de fon imprudence
& Teniers reprit fa première manière,
cpnfèrvant dans les ombres les tranfparéns. de
Beaux-Arts. Tome IL
l’impreflidn. Il peignoit d’abord tout d’une
pâte, établîfloit les aifférens tons à leur place,
chargeoit enfuite les lumières , & terminait
par quelques touches qui tenoipnt lieu d’un
grand travail.
I l a fait des tableaux où tout eft clair 8c
qui fiirprennent par l’effet. On cire de lui un
tableau qui appartenoit au Comte de V en c e ,
où le ciel étoit c la ir , où l’eau étoit claire,
où la principale figure étoit un homme en che-
mife; ce quïï prouve que l’oppofuion des grands
clairs 8c des grands bruns n’ eft pas néceflaire
pour détacher les objets. Un fond clair peut
faire avancer un objet cla ir, quand on émoufîe
le premier par des tons bleuâtres qui tiennent
de l’air, 8c que l’on donne de la vigueur à l’autre
par des tons chauds & dorés.
C ’etoit ordinairement les foirs que Tenier*
peignoit des tableaux où toutes lès parties
étoient claires; il les appeloit fes après-fouper•
I l a fait un fi grand nombre d’ouvrages qu’ il
difoit que pour les placer tous, il faudroit
une galerie de deux lieues de long. On fent
bien que ce mot ne doit pas être pris à la
le ttre, mais pour une exagération badine. II
achevoit ordinairement un tableau dans un©
journée.
On peut regarder Teniers comme l’inventeur
de fon genre , parce qu’ il a furpafle ceux
qui l’avoient précédé. I l eft mort à Bruxelles
en 1690, à l’âge de quatre-vingt ans.
Il a gravé lui même à l’eau-forte. Les eftampes
faites d’après lui font innombrables. La
plus grande partie a été gravée par Lebas ,
ou fous fa dire&ion. On diflingue entre ces
eftampes les oeuvres de miféricorde.
David Teniers avoit un frère nommé Abraham
, dont la couleur étoit plus grife & la
touche moins légère. On confond quelquefois
fes tableaux avec ceux de David, malgré leur
infériorité , parce qu’ ils font du même genre.
(149) AÎonso Cano , dit e l Racionero,
de l’école Efpagnoie , iflu d’ une famille noble,
naquit à Grenade, en 1610. Il fe diftingua dans
la peinture, la fculpture & l’architeéture. On
dit qu’ il réunifloit au génie de la compofi :ion ,
la beauté de la couleur & la correction du
deflin. Il mourut à Grenade en 16 76, âgé de
foixante 8c fix ans,
(150) Les Mignard , de l’école Françoife
nés à Troiès en Champagne , d’ une famille
originaire d’Angleterre , dont le véritable nom
étoit More. H en r iIV voyant fept frères, tous
portant les armes à fon fervice, 8c tous d’ une
belle figure , dit ; « Ce ne font pas là des
y> Mores, mais des Mignards » , & le nom
de Mignard leur refta. Le père de nos artiftes
étoit l’un dé ces fept frères. Il eut deux fils
L