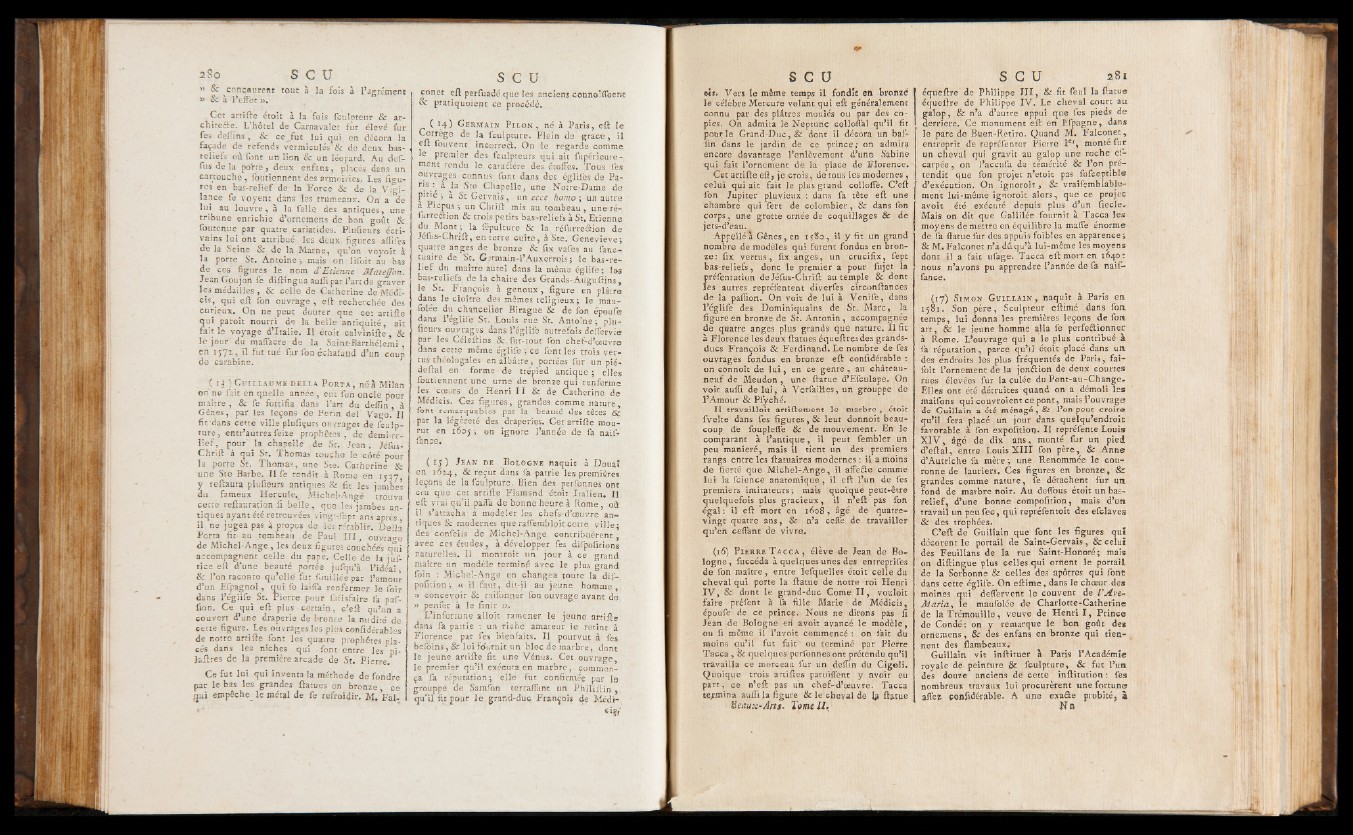
» & concsurent tout à la fois à l’ agrément
» & à l ’effet Si.
Cet artifte étoit à la fois fc'ulpteur & ar-
chireâe. L’hôtel de Carnavalet fut élevé fur
fes deifins, & ce^fut lui qui en décora la
façade de refends vermiculés*& de deux bas-
reliefs où font un lion & un léopard. Au def-
fus de la po'rre , deux enfans, placés dans un
cartouche , foutiennent des armoiries. Les figures
en bas-relief de la Force & de la V ig ilance
fe voyent dans les trumeaux. On a de
lui au louvre , à la falle des antiques, une
tribune enrichie d’ornemens de bon goût &
foutenue par quatre cariatides. Plu fieu rs écrivains
lui ont attribué les deux figures afîifes
de la Seine & de la Marne, qu’on voyoit à"
la porte St. Antoine-, mais on lifoit au bas
de ces figures le nom d' Etienne MateJJbn.
Jean Goujon fe diftingua auffi par l’art de graver
les médaillés , & celle de Catherine de Média
s , qui eft fon ouvrage , eft recherchée des
curieux. On ne peut douter que ce: artifte
qui paroît nourri de la belle antiquité, ait
tait le voyage d’Italie. I l étoit calvinifte, &
le jour du maffacre de la Saint-Barthélemi ,
en 157Z ^ il fut tué fur fon échafaud d’un coup
de carabine.
( i j ) Guillaume della P o r t a , né à Milan
on ne fait en quelle année;, eue fon oncle pour
maître, & fe fortifia dans Part du deftin à
Gênes, par les leçons de Per in d e f Vago. Il
fit dans dette v ille plufiçurs ouvrages de fculp-
rure, entr’autres feize prophètes , de demi-rel
ie f , pour' la chapelle de St. Jean, Jéfits-
Chrift à qui St. Thomas touche le côté pour
la porte St. Thomas, une Ste. Catherine &
une Ste Barbe. Il fe rendit à Rome en 1537,
y refeaura plufiçurs antiques & fit les jambes
du fameux Hercule._ MichehAnge trouva
cettë reftauration fi b e lle , que les jambes an-
tiques ayant été retrouvées vingsfept ans après
il ne jugea pas à propos de les rétablir. Délia
Porta fit. au tombeau de Paul I I I 9 ouvrage
de Michel-Ange , les deux figures couchées qui
accompagnent celle du pape. Celle de la juf-
tice eft d’une beauté portée jufqu’à l ’idéal
& l’on raconte qu’elle fut fouillée par l’amour
d’ un Efpagnol , qui fe laifîa renfermer le foir
dans l’églife St. Pierre pour faGsfaire fa paf-
fion. Ce qui eft plus certain, ç’eft qu’ on a
couvert d’ une draperie de bronze la nudiré de
cette figure. Les ouvrages les plus confidérabîes
de notre artifte font les quatre prophètes placés
dans les niches qui -font entre les pi-
Jaftres de la première arcade de St, Pierre.
Ce fut lui qui inventa la méthode de fondre
par le bas les grandes ftatues en bronze ce
qui empêche_ le métal de fe refroidir. M, Falçonet
eft perfuadé que les anciens connoifloent
& pratiquoient ce procédé.
( 1 4 ) Germain Pilon, né à Paris, eft le
Corrège de la fculpture. Plein de g râ ce , il
eft fou vent incorrect. On le regarde comme
le premier des fculpteurs qui ait fupérieure-
ment rendu le caractère des étoffés. Tous fes
ouvrages connus font dans des églifes de Pa-
a Chapelle, une Notre-Dame de
pitié; a St Gervais, un ecce homo ; un autre
a Picpus ; un Chrift mis au tombeau , une ré-
lurrection & trois petits bas-reliefs à St. Etienne
du Mont ; la fépulture & la, réfurreétion de
Jéfus-Chrift, en terre cuite, à Ste. Genevieve;
quatre anges de bronze & fix vafes au fanc-
tuaire de St. G^rmain-l’Auxerrois; le bas-relie
f du maître autel dans la même églife; les
bas-reliefs de la chaire des Grands-Aùguftins,
le St. François à genoux, figure en plâtra
dans lexloître des mêmes religieux; le mau-
folée du chancelier Birague & de fon époufe
dans l ’églife- St. Louis rue St. Antoine ; p]u-
fieurs ouvrages dans l’églife autrefois deffervie
par les Céleftins &, fur-tout fon chef-d’oeuvre
dans cette même églife ; ce fontles trois vertus
théologales en albâtre, portées fur un pi©-
deftal en forme de trépied antique ; elles
foutiennent une urne de bronze qui renferme
les cçeurs de Henri I I & de Catherine de
Médicis. Ces figures, grandes comme nature,
font- remarquables par la beauté des têtes &
par la légèreté des draperies. Cet artifte mourut
en 1605 ; on ignore l ’année de fa naif*
fanee.
(15) Jean de Bologne naquit à Doua»
en 1 0 Z 4 , & reçut dans fa patrie les premières
leçons de la fculpture. Bien des perfpnnes ont
cru que cet artifte Flamand étoit Italien, I l
eft vrai qu’il paiTa de bonne heure à Rome où
il s’attacha à modeler les chefs-d’oeuvre antiques
& modernes que rafTembloit cette v ille ;
des confeils de Michel-Ange centribuèrent
avec ces études, à développer fes difpofitions
naturelles. Il montroit un jour à ce grand
maître un modèle terminé avec le plus grand
foin : Michel-Ange en changea toute la dif-
pofition; « il faut, dit-il au jeune homme,
» concevoir & raifontier fon ouvrage avant de
» penfer à le finir ».
L’infortune alloit ramener le jeune artifte
dans fa patrie : un riche amateur le retint à
Florence par fes bienfaits. I l pourvut à fes
befôins, & lui fournit un bloc de marbre, dont
le jeune artifte fit une Vénus. Cet ouvrage
le premier qu’ il exécuta en marbre, commença
fa réputation; elle fut confirmée par le
grouppe de Samfon terraffant un Philiftin ,
qu’ il fit pour le grand-duc François de Médirai?*'
eis. Vers le même temps il fondît en bronzé
le célèbre Mercure volant qui eft généralement
connu par des plâtres moulés ou par des co pies.
On admira le Neptune collofl’al qu’ il fit
pour le Grand-Duc, & dont il décora un baf-
iin dans le jardin de ce prince; on admira
encore davantage l’enlèvement d’une Sabine
qui fait l ’ornement de la place de Florence.
Cet artifte eft, je crois , de tous les modernes ,
celui qui ait fait le plus grand colloffé. C’eft
fon Jupiter pluvieux : dans fa tête eft une
chambre qui fert de colombier, & dans fon
corps, une grotte ornée dé coquillages & de
jets-d’eau.
Appelle a Gênes, en 1580, il y fit un grand
nombre de modèles qui furent fondus en bronze:
fix vertus, fix anges, un crucifix, fept
bas-reliefs, dont le premier a pour fujet la
préfentation de Jéfus-Chrift au temple & dont
les autres repréfentent diverfes circonftances
de la paflion. On voit de lui à V enife , dans
l ’églife des Dominiquains de St. Marc, la
figure en bronze de St. Antonin, accompagnée
de quatre anges plus grands que nature. Il fit
à Florence les deux ftatues équeftresdes grands-
ducs François & Ferdinand. Le nombre de les
ouvrages fondus en bronze eft: confidérable :
on connoît de lu i , en ce genre, au château-
neuf de Meudon, une ftatue d’Efculape. On
voit auffi de lu i, a Verfailies, un grouppe de
l ’Amour & Plyché.
I l travailloit artiftement le marbre , étoit
fvelte dans fes figures, & leur donnoit beaucoup
de fouplelfe & de mouvement. En le
comparant à l’antique, il peut fembler un
peu maniéré, mais il tient un des premiers
rangs entre les ftatuaires modernes : il a moins
de fierté que Michel-Ange, il affe&e comme
lui la fcience anatomique , il eft l’un de fes
premiers imitateurs ; mais quoique peut-être
quelquefois plus gracieux, il n’eft pas fon
égal : il eft mort en 1608, âgé de quatre-
vingt quatre ans, & n’a ceffe de travailler
qu’en ceffant de vivre.
(16) P ierre T a c c a , élève de Jean de Bologne,
fuccéda à quelques unes des entreprifes
de fon maître, entre lefquelles étoit ce lle du
cheval qui porte la ftatue de notre roi Henri
IV , & dont le grand-duc Corne I I , vouloit
faire préfent à fa fille Marie de Médicis,
époufe de ce princp. Nous ne dirons pas fi
Jean de Bologne eri avoit avancé le modèle,
ou fi même il l’avoit commencé : on fait du
moins qu’ il fut fait'- ou terminé par Pierre
Tacca , & quelques perfonnes ont prétendu qu’il
travailla ce morceau fur un deffin du Cigoli,
Quoique trois artiftes paroiffent y avoir eu
parc, ce n’eft pas un chef-d’oeuvre. Tacca
termina auffi la figure & le cheval de J# ftatue U eaux-Arts- TwntlL
équeftre de Philippe I I I , & fit feul la ftatue
équeftre de Philippe IV . Le cheval court au
galop, & n’a d’autre appui que fes pieds de
derrière. Ce monument eft en Efpagne, dans
le parc de Buen-Retiro. Quand M. Falconet,
entreprit de repréfenter Pietre Ier, monté fur
un cheval qui gravit au galop une roche et-
carpée, on l’accula de témérité & l ’on prétendit
que fon projet n’etoit pas fufceptible
d’exécution. On ignoroit, & vraisemblablement
lui-mêmè ignoroit alors, que ce projet
avoit été exécuté depuis plus d’ un fiecle.
Mais on dit que Gallilée fournit à Tacca les
moyens de mettre en équilibre la maffe énorme
de fa ftatue fur des appuis foibles en apparence;
& M. Falconet n’à dû qu’ à lui-même les moyens
dont il a fait ufage. Tacca eft mort en 1640:
nous n’avons pu apprendre l’année de fa naii-
fance.
(17) Simon Guillain, naquit à Paris en
1581. Son père, 'Sculpteur eftimé dans fon
temps, lui donna les premières leçons de fon
art, & le jeune homme alla fe perfectionner
à Rome. L’ouvrage qui a le plus contribué à
fa réputation, parce qu’ il étoit placé dans un
des endroits les plus fréquentés de Paris, fai-
foit l’ornement de la jon&ion de deux courtes
rues élevées fur la culée du Pont-au-Change*
Elles ont été détruites quand on a démoli les
maifons qui couvroient ce pont, mais l’ouvrage
de Guillain a été ménagé, & l’on peut croire
qu’ il fera placé un jour dans quelqu’endroit
favorable à fon expofitiorç. I l repréfente Louis
X IV , âgé de dix ans, monté fur un pied
d’ eftal, entre LouisXIII fon père, & Anne
d’Autriche fa mère ; une Renommée le couronne
de lauriers. Ces figures en bronze, &
grandes comme nature, fe détachent fur un.
fond de matbre noir. Au deflous étoit un bas-
relief, d’ une bonne compofition, mais d’un
travail un peufec, qui repréfentoit des efclaves
& des trophées.
C’eft: de Guillain que font les figures qui
décorent le portail de Saint-Gervais, & celui
des Feuillans de la rue Saint-Honoré ; mais
on diftingue plus celles qui ornent le portail
de la Sorbonne & celles des apôtres qui font
dans cette églife. On eftime, dans le choeur des
moines qui deffervent le couvent de VAve-,
JM aria, le maufolée de Charlotte-Catherine
de la Trémouille, veuve de Henri I , Prince
de Condé: on y remarque le bon goût des
ornemens, & des enfans en bronze qui tiennent
des flambeaux;
Guillain vit inftituer à Paris l’Académie
royale de peinture & fculpture, & fut l’un
des douze anciens de cette inftitution : fes
nombreux travaux lui procurèrent une fortune
affez çonfidérable. A une exa&e probité, à
N a