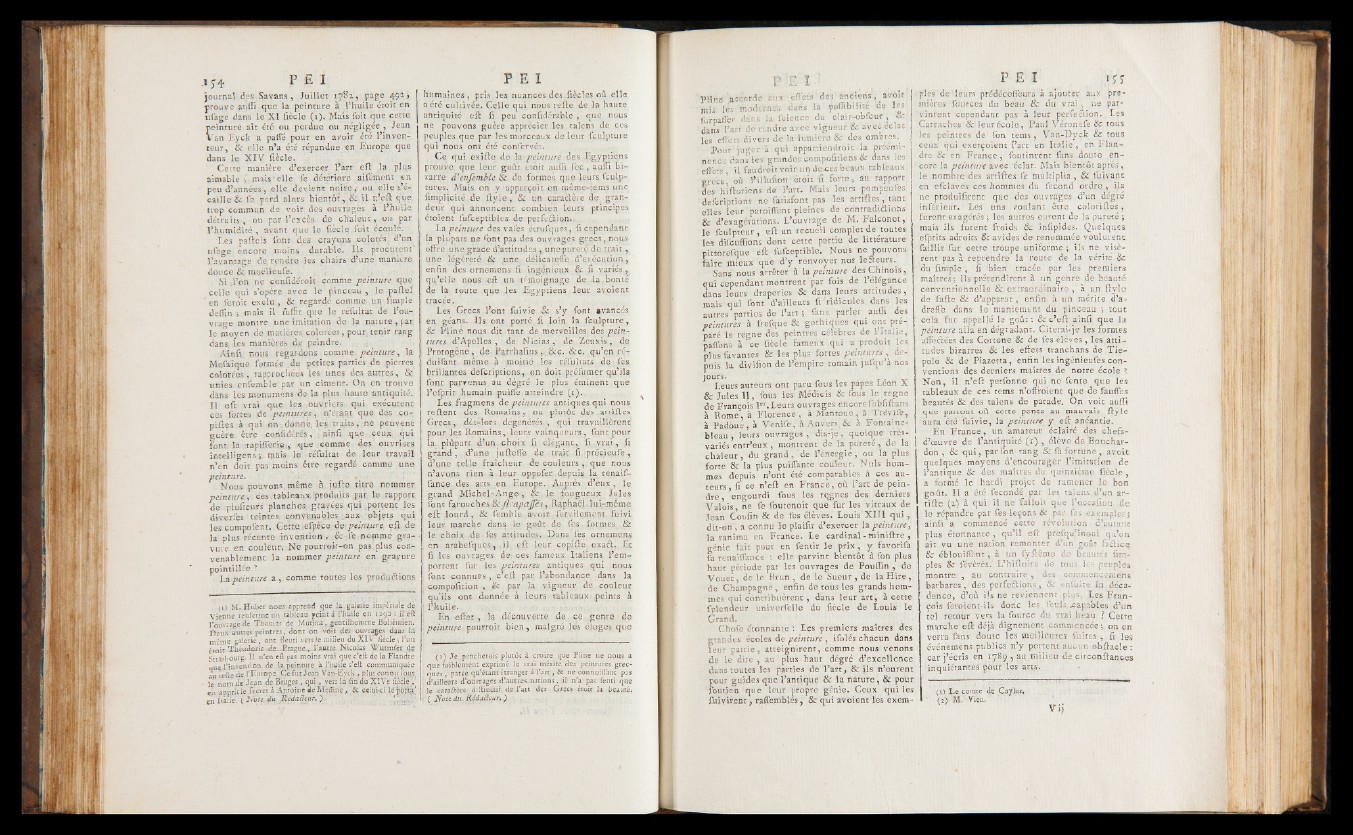
journal des Savans , Juillet 1782, page 491 2,>
prouve aùffi que la peinture à l’huile étoit en
ul'age dans le XI fiècle (1). Mais foit que cette
peinture ait été ou perd.ue ou négligée , Jean
Van Eyck a pafle pour en avoir été l’inventeur,
8c elle n’a é:>é répandue en Europe que
dans le X IV fiècle. ,
Cette manière d’exercer, l’ art eft la plus
aimable Ç: mais ' elle fe détériore aifément. en
peu d’années, e lle devient nqirey ou elle s’é-;
caille & fe perd alors bientôt il n*eft que;
trop commun de voir des ouvrages a l’huile
détruits, ou par l’excès de chaleur, ou- par
l ’humidité, avant que le fiècle l’oit écoulé.
Les paftel’s font des crayons ;colpr,és, d’un
iifage encore moins durable. Ils procurent
l ’avantage de rendre les chairs d’ une manière
douce & moëlleufe.
Si ;l’on ne çonfidéroit comme peinture que
celle qui s’opère . avec le pinceau , le paftel
en feroit exclu , & regardé comme un fimple
defiin ;. mais il fuffic que le réfultat de l’ouvrage
montre Une imitation de la nature , par
le moyen de matières, colorées, pour, tenir rang
dans; Les manières .de peindre.
Adoft nous regardons comme. peinture, la
Mofaïque formée .dq petites, parties de pierres
colorées , rapprochées lçs une? des autres, &
unies .enfemble. par un ciment. On en trouve
dans les monnmens de la plus -haute antiquité.
I l eft vrai que, J.es ouvriers qui exécutent
ces fortes de peintures, n?étant que dé,s ço-
piftes à qui on-. donné les 'trait-s, ne peuvent
guère, être coj*fidérés, ; ainfi qtfe ..ceux qui
font, la ::tapi.fferieque comme des ouvriers
intelligens i mai? le - réfultat de-, leur travail
n’en doit pas moins être- regardé comme une
peinture. . . >. - >7 .n » i , 1
Nous pouvons, même a. jufte titre nommer
peinture :, des.tableaiîXj^produits :parf le .rapport
de plufienr's planches; gravégs qui, ^portent les
diverfes teintes. çonvfe»ableSj..,auX' objets qui
les compoi’ent,. Gèttç ,-efpèce dsipeipture, eft. de
la plus, récente invention., ,&ofe nomme gravure,
en couleur. Ne pourrok-an pas plus convenablement
la nommer peinture en : gravure
pointillée ? . . . ■ ’ : L
La peinture a comme toute? les productions
, (1) M. Hiiber nous apprend que J.a.. galerie impériale de
•Vienne renferme "un tableau peint à 'l’huilë en 1292 : il eft
l’ouvrage de Thomas de Mutina , gentilhomme Bohémien.
j ) e u x autrespeint res, dont 'on -voit des ouvrages dans la
même galerie, ont fleuri vers le milieu du X IV fiècle ; l’un
étoit- Théodoxic ^de-_Erague.,-l’autre Nicolas ^urnifer. d?
Strasbourg. Il n’en eft pas moins vrai que c’eft de la Flandre
queT invention de la peinture à l ’huile s’çft communiquée
au relie de l’Europe Ge fut Jean Van-Eyck plus connu fous,
le hom.de Jean de Bruges ^ qui , vers là findù X lV e fiecieV
en --apprit le fecrêt à Antoine de Melfine 3 5c celui-ci l é g ç ï«
en Italie.' ( Note .du Rédacteur. |
humaines , pris les nuances des.fiècles où elle,
aéré cultivée. Celle qui nous refie de la haute
antiquité eft fi peu confidérable, que nous
ne pouvons guère apprécier les talens de ces
peuples que par les morceaux de leur fculpture
qui nous ont été confervés.
Ce qui exifte de la peinture des Egyptiens
prouve que leur goût etoit auili fec , a uni bizarre
d'enfemble & de formes que leurs fcuip-
tures. Mais on y apperçoit en même-fems upe
fimpJicité de f t y le , & un caractère de, grandeur
qui annoncent combien leurs principes
étoient lufceptibles de perfeélion.
La peinture des vafes étrufques, fi cependant
la plupart ne ront pas des ouvrages grecss nous
, offre -ühe.grace d’attitudes , une-pureté de trai t ,
une légèreté 8c -une déiicatefie, d’exécution,
i enfin des ornemens fi ingénieux é>c fi varié?,,
qu’elle nous cü un témoignage de .la.bonté
de la route que les Egyptiens leur avoient
tracée.
Les Grecs l’ont fuivie 8c s’y font avancés
en géans. Ils ont porté fi loin la fculpture,
& Pline nous dit tant de merveilles des peintures
d’Àpelles , de N ici as , de Zeuxis, de
Protogène, de Parrhafius &rc. &c. qu’ en ré-
duifant même à moitié les réfuitats de fes
brillantes defcriptions, on doit préfumer qu’ ils
font parvenus au degré le plus éminent que
l’ efpric humain puifle. atteindre (1).
Les fragmens de peintures antiques qui nous
" relient des, Romains,; ou plutôt des artiftes
Grecs, dès-lors dégénérés;, qui travaillèrent;
pour les Romains, leurs vainqueurs, font pour
la. plupart d’ un choix fi élégant, fi v r a i, fi
grand, d’ une jtifteffe de trait fi ipréeieufe ,
d’ une telle fraîcheur de couleurs , que nous
n’avons rien à leur oppofer,,dgpuis la renaif-
fance .des arts en Europe.-, Auprès d’eux , le
grand Michel-Ange , 8c,, le fougueux; Jules.
: font farouches & Jlrapajjes ,. Rq p h a ë j lui-même
eft lourd , & femble avoir, fer.y-ile.mept, fuîvi
leur marche dans, le gpût. de le s , formes 8c
I le choix de fes attitude?. Dans les ornemens
; en arabefqués.,- . ji eft leur copîfie.. exaét, Et
fi les ouvrages de- ces fameux Italiens Remportent
fur les peintures antiques qui nous
.font connues , c’eft par l’abondance dans la
;• compôfition , & par la vigueur de couleur
qu’ils ont donnée à leurs tableaux, peints à
t Phuile.
; En effet:, la découverte d e , ce genre de
\ peinture'pourrpit bien, malgré lès éloges que
(î) Je pencherojs plutôt à croire qiie Pline ne nous a
que foibjeménr exprimé le vrai mérite des peintures grecques
parce qu’étant étranger à l’art j & ne connoiffant pas
cPailléurs d’Oü/râges d’autres.nations, il n’a pas fenti que
le càraâèce . dÜUnâif; de l’arc des Grecs étoit la beauté.
( Note du Rédacteur,.) \ .
Pline' accorde aux effets : des anciens, avoir |
mis lés ih'otlérncs dans la poffibilïte de les
furpaffer dans la Science du clair-oblcur , &
dans l’art de rendre avec vigueur & avec éclat j
lçs effets:divers de la lumière 8c des ombres.
Pour'juger à qui àppar.dendroit la prééminence
dans les' grandes compofitions & dans les!
effets il faudroit voir un deèes beaux tableaux
grecs’ où l’ illufion étoit fi forte, au rapport
des hiftoriens de Part; Mais leurs pompeufes
defcriptions ne fatisfont pas les artiftes, tant
elles leur paroiffent pleines de contradictions
& d’ exagérations. L’ouvrage de M. E al conet,
le fculpteur, eft un recueil complet de toutes
les dil'cuflions dont cette partie de littérature
pittorefque eft fufceptible. Nous ne pouvons
faire mieux que d’y renvoyer nos le Sieurs.
Sans nous arrêter à la peinture des Chinois,
qui cependant montrent par fois de l’élégance
dans leurs draperies & dans leurs attitudes,
mais qui font d’ailleurs fi ridicules dans les
autres parties de l’ art j fans parler aufli des
peintures à freÇque & gothiques qui ont préparé
le régné des peintres célèbres de 1 Italie,
paffons à ce fiècle fameux qui a produit les
plus favantes & les plus fortes peinturesY depuis
la divifionde l’empire romain jufqu’à nos
jours.
Leurs auteurs ont paru fous les papes Leon X
& Jules IJ, fous les Médicis & fous le régné
de François Ier. Leurs ouvrages encore fubfiftans
à Rome, à Florence , à Mahtoue, à Trévife,
à Padou e , à Venife, à Anvers, & à Fontaine-,
bleau , leurs ouvrages , dis-je, quoique très-:
variés entr’eux , montrent de la pureté, de la
chaleur, du grand, de l’énergie, ou la plus
forte & la plus puiffante couleur. Nuis hommes
depuis n’ont été-.comparables à ces auteurs,
fi ce n’ eft en France , où l’art de peindre,
engourdi fous les reines des derniers
Valois, ne fe foutenoit que fur les vitraux de
Jean Cou fin & de les élèves. Louis X I I I q u i,
dit-on , a connu le plaifir d’ exercer la peinture,
la ranima en France. Le cardinal -miniftre ,
génie fait pour en fentir le prix , ÿ favorifa
la renaiffance : elfe parvint bientôt à fon plus
haut période par les ouvrages de Pouflin , de
V ouet, de le Brun , de le Sueur , de la H ire ,
de Champagne , enfin de tous les grands hommes
qui contribuèrent, dans leur art, à cette
fplendeur univerfelle du fiècle de Louis le
Grand.
Chofe étonnante 1 Les premiers maîtres des
grandes écoles de peinture , ifolés chacun dans
leur patrie, atteignirent, comme nous venons
de le d ire , au plus haut dégré d’excellence
dans toutes les parties de l ’art, & ils n’ eürent
pour guides que l’antique & la nature, & pour
foutjen que leur propre génie. Ceux qui les
fuiyirent, r^ffemblés, & qui avoient les exempies
de leurs prédéceffeurs à ajouter aux premières
fources du beau & du v rai, ne parvinrent
cependant pas à leur perfeélion. Les
Carraches &-leurécole, Paul Veronefe & tous
les peintres de Ion te ms, Van-Dyck & tous
ceux qui exerçoient Part en Italie , en Flandre
& en France, foutinrent fans doute e n core
la peinture avec éclat. Mais bientôt après,
le nombre des artiftes fe multiplia, & fuivant
en efclaves: ces hommes du fécond ordrè , ils
ne produifirént que des ouvrages d’un dégré
inférieur. Les uns voulant: être coloriftes,
furent exagérés; les autres eurent de la pureté;
mais ils furent froids & infipides. Quelques
efprits adroits & avides de renommée voulurent
faillir fur cette troupe uniforme; ils ne visèrent
pas à reprendre la route de la vérité &:
du fimple, fi bien tracée par les premiers
maîtres; ils prétendirent à un genre de beauté
conventionnelle & extraordinaire , à un ftyle
de faite & d’apparat, enfin à un mérite d’a-.
dreffe dans le maniement du pinceau ; tout
cela fut appelle le goût: & c’eft ainfi que la
peinture alla en dégradant. Citerai-je les formes
affrétées des Cortone & de fes élèves , les attitudes
bizarres & les effets tranchans de T ie -
polo & de Piazetta, enfin les ingénieufes conventions
des derniers maîtres de notre école l
Non, il n’eft perlonne qui ne fente que les
tableaux de ces teins n’ofrroient que de fauffes
beautés & des talens de parade. On voit aufii
que partout où cette pente au mauvais ftyle
aura été fuivie, la peinture y eft anéantie.
En France, un amateur éclaire des chefs-
d’oeuvre de l’antiquité (1) , élève de Bouchar-
don , & q u i, par fon rang 8c fa fortune , avoit
quelques moyens d’encourager l’ imitation de
l’antique 8c des maîtres du quinzième fiècle ,
a formé le hardi projet de ramener le bon
goût. Il a été fécondé par les talens d’un ar-
tifte (2) à qui il ne falloir que l’occafion de
le répandre par fes leçons & par fes exemples;
ainfi a commencé cette révolution, d’autanc
plus étonnante, qu’ il eft prefqu’ inoui qu’on
ait vu une nation remonter d’ an goût factice
& éblouifiànt, à un fyftême de beautés Amples
& févèrés. L’hiftoire de tous les peuples
montre:, au contraire , des commencemehs
barbares, des perfections,, 8c enfuite la décadence,
d’où ils ne reviennent plus, Les François
feroient-ils donc les feuls .capables d’un
tel retour vers la fource du vrai beau ? Cette
marche eft déjà dignement commencée; on en
verra fans doute les meilleures fuites , fi les
événemens publics n’y portent aucun obftacle:
car j’écris en 1789 , au milieu de circonftanc.es
inquiétantes" pour les arts.
(1) L e comte de Cayîus,
(2) M. Vi'cn. ‘
V i j