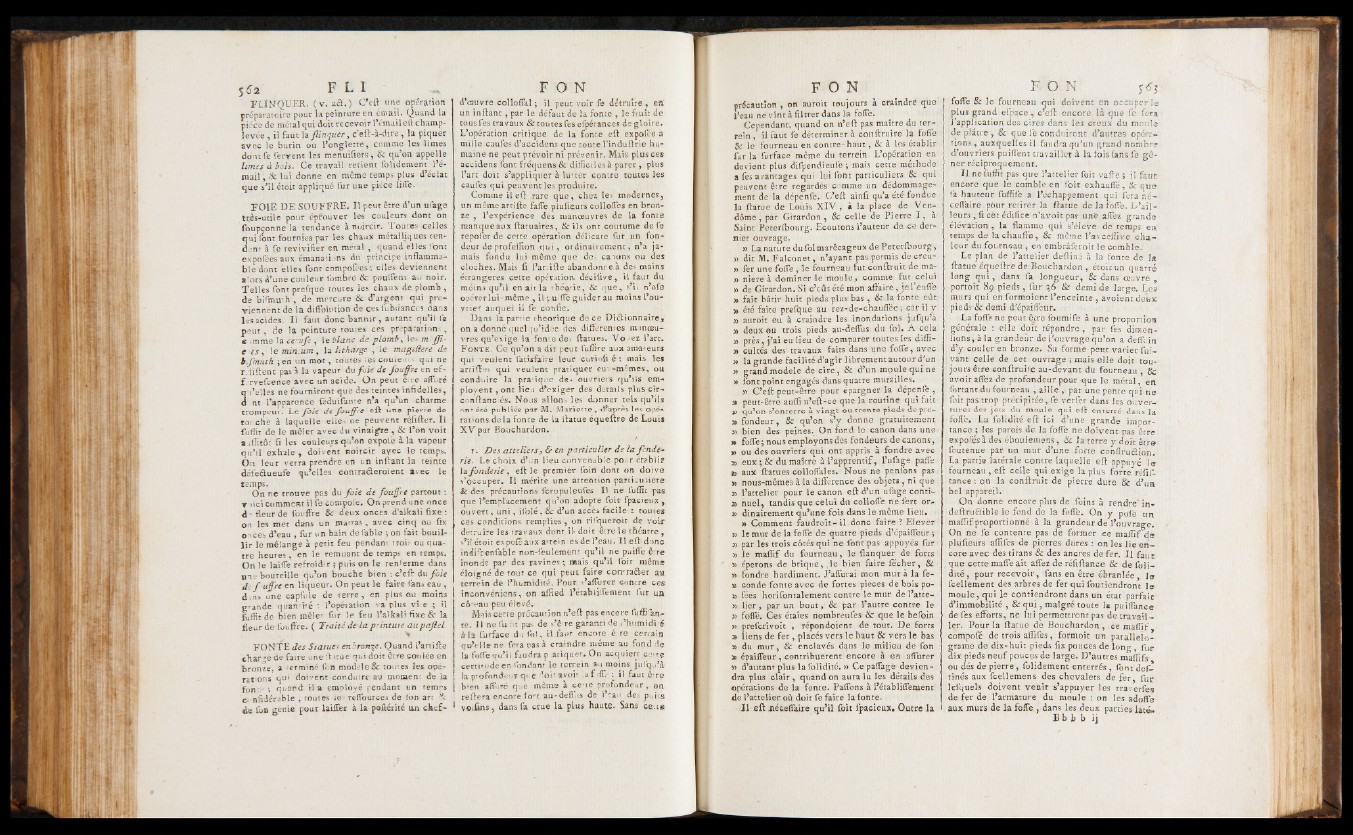
FLINQUER. ( v . a&.) C’eft une opération
préparatoire pour la peinture en émail» Quand la
pièce de métal qui doit recevoir l’ émail eft champ-
levée , il faut la flinquer, c’eft-à-dire , la piquer
avec le burin ou l’onglette, comme les limes
dont fe ferrent les menuifiers , & qu’on appelle
limes à bois. Ce travail retient folîdement l’émail
, & lui donne en même temps plus d’éclat
que s’il étoit appliqué fur use pièce lifle.
FOIE DE SOUFFRE. Il peut être d’ un ufage
très-utile pour éprouver les couleurs dont on
foupçonne la tendance a noircir. Toutes celles
qui (ont fournies par les chaux métalliques tendent
à fe revivifier en métal , quand elles l'ont
expofées aux émanations du principe inflammable
dont elles font compofées*. elles deviennent
alors d’ une couleur l'ombre & pouffent au noir.
Telles font prefque toutes les chaux de plomb ,
de bifmuth , de mercure & d’argent qui proviennent
de la diffolution de ces fubftànces dans
les acides. I l faut donc bannir , autant qu’il fe
peut , de la peinture routes ces préparations,
e ,mme la èeiàfè , le blanc de plomb, les mrjji-
t ts , 1 e min.uni, la liiharge , le magi/iere de
bifmuth ; en un mot, toutes lies couietn s qui ne
r. liftent pas à la vapeur du foie de fouffre en ef-
f rvefcence avec un acide. On peut être attiré
q uelles ne fourniront que des teintes infidelles,
d nt l’apparence féduifante n’a qu’un charme
trompeur. Le foie de fouffre eft une pierre de
touche à laquelle elles ne peuvent refifter. U
fuffit de le mêler avec du vinaigre , & l’on voit
a.tlîitôt fi les couleurs qu’on expole à la vapeur
qu’ il exhale , doivent noircir avec le temps.
On leur verra prendre en un inftant la teinte
défeâueufe quelles contraderoient atvec le
temps.
On ne trouve pas du fo ie de fouffre partout :
v >ici comment il fe compofe. On prend une once
d « fleur de fouffre & deux onces d’alkali fixe :
on les met dans un marras , avec cinq ou fîx
onces d’eau , fur un bain de fable -, on fait bouilli
r le mélange à petit feu pendant rroi.‘ ou quatre
heures , en le remuant de temps en temps.
On le laiffe refroidir ;puis on le renferme dans
une bouteille qu*on bouehe bien : c’eft du foie
d e fu ffr e en liqueur. On peut le faire fans eau ,
dvns une capfule de terre, en plus ou moins
grande quan'tré * l’ opération va plus vî e ; il
fuffit de bien mêle** fur le feu l’aîkalr fixe & la
fleur de fouffre. ( Traité de la peinture aupafiel.
FO NTE des Statues enbron^e. Quand l’artifte
chargé de faire uneftatue qui doit être coulée en
bronze, a terminé fon modèle &. toutes les. opé-
rafons qui doivent conduire au moment de la
font'1 ; quand il a employé pendant un temps
c* nftdérable , routes le : reffources de fon art &
de ion genie pour laiffer à la poftérité un chefd’oeuvre
coHoffaî ; il peut voir fe détruire , cri
un inftant, par le défaut de la fonte , le fruit de
tous fes travaux & toutes fes efpérances de gloire.
L’opération critique de la fonte eft expolée a
mille caufes d’accidens que toute l’induftrie humaine
ne peut prévoir ni prévenir. Mais plus ces
accidens font fréquens & difficiles à parer, plus
l’arc doit s’appliquer à lutter contre toutes les
caufes qui peuvent les produire.
Comme il eft rare q u e , chez les modernes,
un même artifte faffe plulieurs coll.ofiès en bronze
, l’expérience des manoeuvres de la fonte
manque aux ftacuaires, & ils ont coutume de fe
repoler de cette opération délicate fur un fondeur
de profellion q u i, ordinairement, n’a jamais
fondu lui-même que dei catons ou des
cloches. Mais fi l’arcifte abandonre.à des mains
étrangères cette operation, décitïve, il faut du
moins qu’il en a itla théorie, & que, s’ il n’ofe
opérer lui-même,, il pu fie guider au moins l’ ouvrier
auquel il fe confie.
Dans la part ie théorique de ce Di&ionnaire,
on a donné quelqu’ idee des différentes manoeuvres
qu’exige la fonte de> ftatues. Voyez l’art.
F onte. Ce qu’ on a dit peut luffire aux amateurs
qui veulent latisfaire leur curiofié-: mais les
arriftes qui veulent pratiquer eu*-mêmes, ou
conduire la pra'iqne de» ouvriers qu’ ils em-
ployent,ont lieu d’exiger des détails plus cir-
conftancrés. Nous allons les donner tels qu’ ils
ont été publiés par M. Mariette, tPaprès les opérations
delà fonte de la llatue équeftre de Louis
X V par Bouchardon.
t. Des attelïerS) & en particulier de la fende*
rie. Le choix d’ un lieu.convenable pour établir
la fonderie, eft le premier foin dont on doive
s’occuper. Il mérite une attention particul-icre
& des précautions fcrupuleufes II ne fuffit pas
que l’emplacement qu’ on adopte foit fpacieu.x ,
ouvert, u n i, ifolé , & d’un accès facile i toutes
ces conditions remplies , on rifqueroit de voir
détruire les travaux dont.il doit être le théâtre ,
s’il étoit expoffi aux attein.es de l’eau. Il eft donc
indifpenfable non-feulemenr qu’ il ne puiffe être
inondé par des ravines ; mais qu’ il foit même
éloigné de tout ce qui peut faire coirraéter a»
terrein de l’humidité. Pour ‘.’affurer contre ces
inconvéniens, on affied l’étabiiffement fur ua
cô'eau peu élevé.
Mais cerre précaution n’eft pas encore fuffira.n.-
te. Il ne fufit pas de s’ê?re garanti de. i’humidité
à l'a furface du fol, il faut encore erre cerrain
qu-’èlle ne fera pas à craindre même au fond de
la fofie qu’ il faudra p atiquer. On acquiert cette
certitude en fondant le terrein au moins jiufqu’à-
la profondeur qi e doit avoir .aftff.- : il faut être
bien affûté que même à ce1 te profondeur, ©n
: reftera encore fort au-deftus de l’eau des puits.
* voifins, dans fa crue la plus haute. Sans ce.te
précaution , on auroit toujours à craindre que
l ’eau ne vînt à filtrer dans la fofie.
Cependant, quand on n’éft pas maître du terrein
, il faut fe déterminer à conftruiré la fofie
& le fourneau en contre-haut, & a les établir
fur la furface même du terrein L’ opération en
devient plus difpendieufe ; maïs cette méthode
a fes avantages qui lui font particuliers & qui
peuvent être regardés comme un dedommagement
de la dépenfë. C’eft ainfi qu’a été fondue
la ftatue de Louis X IV , à la place de Ven-
dôme, par Girardon , 8c celle de Pierre I , a
Saint Peterfbourg. Ecoutons l’auteur de ce dernier
ouvrage.
» La nature du fol marécageux de Peterfbourg-,
». dit M. Falconet, n’ayant pas-permis de creu-
» fer une fofie , le fourneau fut conftruit de ma-
» niere à dominer le moule, comme fut ^celui.
» de Girardon. Si c’eût été mon affaire, je l’eufie
» fait bâtir huit pieds plus bas , & la fente eût
» été faite prefque au rez-de-chaufféè; car il y
» auroit eu à craindre les inondations jufqu’à
» deux ou trois pieds au-deffus du fol. A cela
» près, j’ai eu lieu de comparer toutes les diffi-
» cultes des travaux faits dans une fofie Vavec
» la grande facilité d’agir librement autour d’un
» grand modèle de c ire, & d’ un moule qui ne
» font point engagés dans quatre murailles.
■$) C’eft peut-être pour épargner la dépênfe ,
» peut-être aufii n’ eft-ce que la routine qui fait
» qu’on s’enterre à vingt ou trente pieds de pre-
» fondeur, & qu’on s’y donne gratuitement
» bien des peines. On fond le canon dans une-
» fofie ; nous employons des fondeurs de canons,
» ou des ouvriers qui ont appris à fondre avec
» eux ; & du maître à l’apprentif, l’ufage paffe
*> aux ftatues collofiales. Nous ne penlons pas :
» nous-mêmes à la différence des objets , ni que
» l’attelier pour le canon eft d’un ufage conti-
» nuel, tandis que celui du colloffe ne fert or-
» dinairement qu’une fois dans le même lieu.
» Comment faudroit-: il donc faire ? Elever
» le mur de la fofie de quatre pieds d’epaifieur ;
» par les trois côtés qui ne font pas appuyés fur •
» le maflif du fourneau, le flanquer de fores
» éperons de brique, ,1c bien faire fecher, &
» fondre hardiment. J’affurai mon mura la fe-
» conde fonte avec de fortes pièces de bois po-
» fées horifontalement contre le mur de l’atte-
» lie r , par un bout, & par l’ autre contre le
» fofie. Ces étaies nombreufes & que le befoin
» preferivoit , répondoient de tout. De forts
» liens de fer , placés vers le haut & vers le bas
» du mur, & enclavés dans le milieu de fon
» épaifieur, contribuèrent encore à en affurer
vy d’autant plus la folidité. » Ce pafiage deviendra
plus clair , quand on aura lu les détails des
opérations de la fonte. Paffons à l’établifferaent
de l’attelier où doit fe faire la fonte.
I l eft néc.efiaire qu’il foit lpacicux. Outre la
! fofie & le fourneau qui doivent en occuper le
plus grand efpace , c’eft encore là que fe fera
| l ’application des cires dans les creux du meule
déplâtré, & que le conduiront d’autres opérr-
I tions , auxquelles il faudra qu’ un grand nombre
(. d’ouvriers puiflènt travailler à la fois fans fe gô-
! nèr réciproquement.
| I l ne fuffit pas que l’attéliei* foit vafte.; il faut
J encore que le comble en foit exhaufle, & que
fa hauteur fuffife a l ’échappement qui fera né-
ceflaire pour retirer la ftatue de la fofie. D’ailleurs
, fi cèt édifice n’a voit pas une affez grande
élévation , la flamme qui s’élève de temps ea
temps de la chauffe, & même l’axcefïïve chaleur
du fourneau , en embrâferoit le comble.
Le plan de l’attelier deftiné à la fonte de la
ftatue équeftre de Bouchardon , étoit un quarré
long q u i, dans fa longueur, & dans oeuvre ,
portoit 89 pieds , fur 36 8c demi de large. Les
murs qui en formoient l’enceinte , avoient deux
pieds & demi d’épaiffeur.
La fofie ne peut être fourni fe à une proportion
générale : elle doit répondre , par fes dira en-
lions, à la grandeur de l’ouvrage qu’on a defiVin
d’y couler en bronze. Sa forme peut varier fui-
! vant celle de cet ouvrage j mais elle doit tou-
• jours être conftruiré au-devant du fourneau , &
avoir affez de profondeur pour que le métal, eil
: fortant du fourneau , aille , par une pente qui ne
foit pasitrop précipitée , fe verfer dans les ouvertures
des jets du moule qui eft enterré dans la
fofie. La folidité eft ici d’une grande importance
; les parois de la fofie ne doivent pas être
expofésà des éboulemens, & la terre y doit être
foutenue par un mur. d’une forte confiruélion.
La partis latérale contre laquelle eft appuyé le
fourneau, eft celle qui exige la plus forte réfil-
tanee : on la conftruit de pierre dure & d’ ua
bel appareil.
On donne encore plus de foins à rendre* in-
deftruftible le fond de la fofie. On y pofè un
maflif proportionné à la grandeur de l’ouvrage.
On ne fe contente pas de former ce maflif de
plulieurs aflifes de pierres dures : on les lie encore
avec des tirans & des ancres de fer. I l fane
, que cette maffe ait affez de réfiftance & de folidité,
pour recevoir, fans en être ébranlée 1®
fcellement des arbres de fer qui foutiendront le-
moule, qui le contiendront dans un état parfait
d’immobilité , & q u i, malgré toute la puiffance
de fes efforts, ne lui permettront pas de travailler.
Pour la ftatue de Bouchardon , ce maflif
compofé de trois aflifes, formoit un parallelo-
grame de dix-huit pieds fix pouces de lo n g , fur
dix pieds neuf pouces de large. D’ autres maflifs
ou dés de pierre, folideinent enterrés , font deC-
tinés aux fcellemens des chevalets de fer, fur
lefquels doivent venir s’appuyer les traverfes
de fer de l’armature du moule : on les adoffe
aux murs de la fofie , dans les deux parties iaté»
B b b b ij