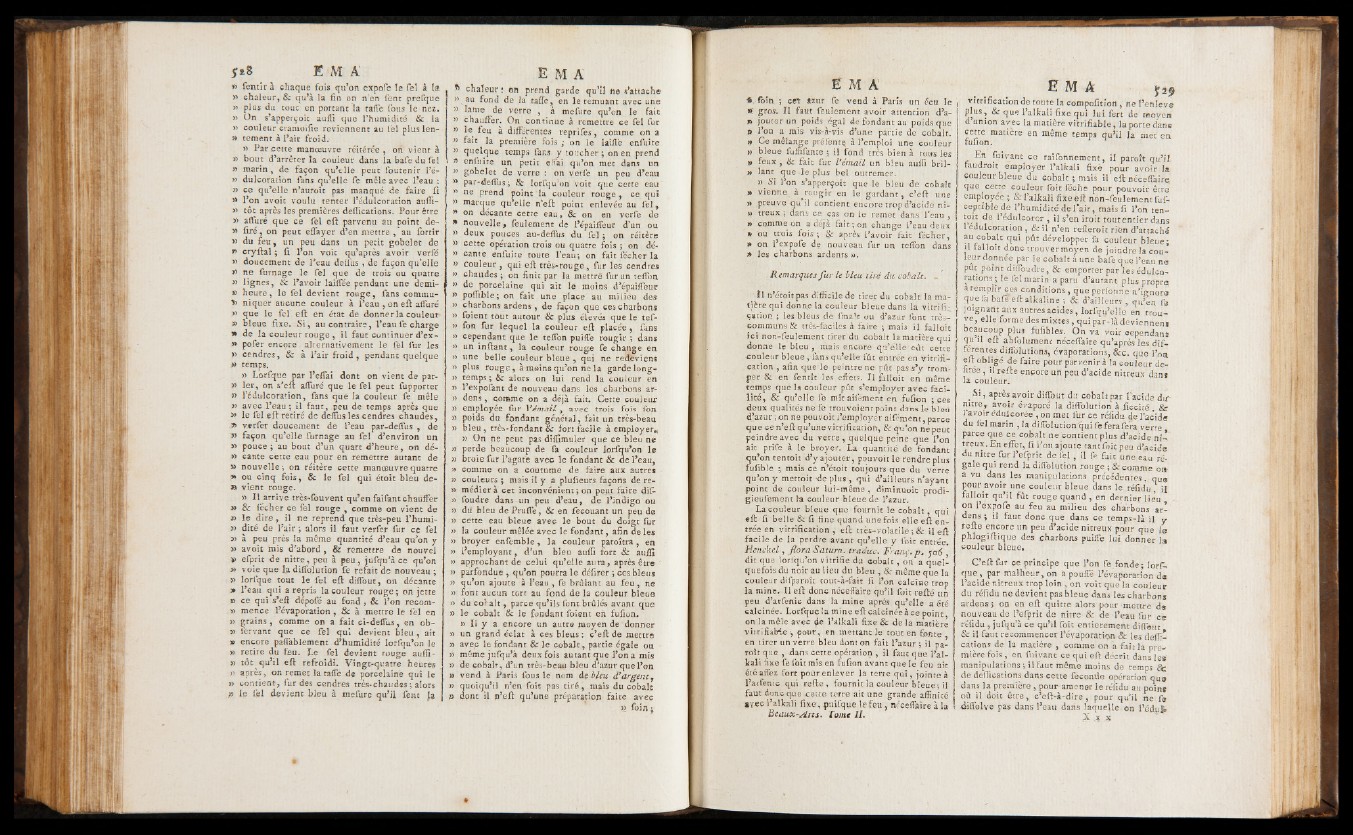
jr*8 E M A
» fëntir à chaque fois qu’on expofe le fel à la
» chaleur, 8c qu’à la fin on n’en fent prefque
» plus du tout en portant la taffe fous le nez.
» On s’apperçoit auffi que l’humidité & la
» couleur cramoifie reviennent au fel pluslen-
» tement à l’ air froid.
» Par cette manoeuvre réitérée, ori vient à
» bout d’arrêter la couleur dans la bafe du fel
» marin, de façon qu’elle peut foutenir l’é-
» dulcoration fans qu’elle fe mêle avec l ’eau :
» ce qu’elle n’auroit pas manqué de faire fi
» l’on avoit voulu tenter l’édulcoration auffi-
» tôt après les premières déifications. Pour être
» afluré que ce fel eft parvenu au point de-
» firé, on peut effayer d’en mettre, au lortir
» du feu , un peu dans un petit gobelet de
r> cryftal ; fi l’on voit qu’après avoir verfé
» doucement de l ’ eau dellus , de façon qu’elle
ne fumage le fel que de trois ou quatre
» lignes, 8c l’avoir laiffée pendant une aemi-
» heure, le fel devient rouge, fans commu-
*> niquer aucune couleur à l’eau , on eft alfuré
» que le fel eft en état de donner la couleur-
» bleue fixe. S i , au contraire, l’eau fe charge
* de la couleur rouge , il faut continuer d’ex-
y* pofer encçre alternativement le fel fur les
» cendres, & à l ’air froid , pendant quelque
» temps.
» Lorfque par l’ effai dont on vient de par*
» 1er, on s’eft afluré que le fel peut fupporter
» l’édulcoration, fans que la couleur fe mêle
» avec l ’eau ; il faut, peu de temps après que
» le fel eft retiré de deffus les cendres chaudes,
» verfer doucement de l’eau par-deffiis , de
JJ façon qu’elle fumage au fel d’environ un
» pouce ; au bout d’ un quart d’heure, on dé-
» cante cette eau pour en remettre autant de
» nouvelle ; on réitère cette manoeuvre quatre
-» ou cinq fois, & le fel qui étoit bleu de-
» vient rouge.
>3 II arrive très-Cbuvent qu’ en faifant chauffer
» & lécher ce fel rouge , comme on vient de
j3 le d ire, il ne reprend que très-peu l ’humi-
» dite de Pair-, alors il faut verfer fur ce fel
» à peu près la même quantité d’eau qu’on y
» avoit mis d’abord, & remettre de nouvel
ï> efprit de nitre, peu à peu, jufqu’à ce qu’on
» voie que la diflblurion fe refait de nouveau ;
» lorfque tout le fel eft diflout, on décante
» l’eau qui a repris la couleur rouge ; on jette
» ce qui s’ eft dépofé au fond , & l’on recom-
» mence l’ évaporation , 8c à metrre le fel en
33 grains, comme on a fait çi-deffus ' en ob- :
» iervant que ce fel qui devient b leu , ait !
» encore paflablement d’humidité lorfqu’on le
» retire du feu. JLe fel devient rouge aufli*
» tôt qu’ il eft refroidi. Vingt-quatre heures
» après, on remet la taffe de porcelaine qui le
» contient, fur des cendres très*chaudes -, alors
y> le fel devient bleu à mefure qu’il fent la j
E M A'
^ chaleur î on prend garde qu’il ne s’attache
» au fond de la taffe, en le remuant avec une
» lame de verre , à mefure qu’on le fait 33 chauffer. On continue à remettre ce fel fur
» le^ feu a differentes reprifes, comme on a 33 fait la première fois ,• on le laifl’e enfuite 33 quelque temps fans y toucher; on en prend
\ » enfuite un petit eiîai qu’on met dans un
I 3) gobelet de verre : on verfe un peu d’ eau
» par-deffus; & lorfqu'on voit que cette eau
>3 ne prend point la couleur rouge, ce qui 3> marque qu’elle n’e ft point enlevée au fe l ,
* on décante cette eau, & on en verfe de
* nouvelle, feulement de l’épaifleur d’un ou 3> deux pouces au-deffus du fel ; on réitère
» cette opération trois ou quatre fois ; on dé-
» cante enfuite toute l’eau; on fait fécher la
» couleur , qui eft très-rouge, fur les cendres
33 chaudes ; on finit par la mettre fur un teffon
ï) de porcelaine qui ait le moins d’épaifleur >3 poflible; on fait une place au miliëu des 3î charbons ardens , de façon que ces charbons
>> fbient tout autour & plus élevés que le tef-
» fon fur lequel la couleur eft placée, fans
» cependant que le teffon puiffe rougir ; dans
» un inftant, la couleur rouge fe change en
» une belle couleur bleue , qui ne redeviens 33 plus rouge, à moins qu’on ne la garde long-
33 temps; oc alors on lui rend la couleur en
» 1 expofant de nouveau dans les charbons ar-
» dens, comme en a déjà fait. Cette couleur
33 employée fur Yémail, avec trois fois fon 33 poids du fondant génétal, fait un très-beau >3 bleu, très-fendant 8c fort facile à employer^ >3 On ne peut pas diffimuler que ce bleu ne
» perde beaucoup de fa couleur lorfqu’on le
33 broie fur l ’agate avec le fondant & de l’eau, 3> comme on a coutume de faire aux autres
33 couleurs ; mais il y a plusieurs façons de re- 3) médier à cet inconvénient ; on peur, faire difc
» foudre dans-un peu d’eau, de l’indigo ou
33 dii bleu dePrufle, & en fècouant un peu de
33 cette eau bleue avec le bout du doigt fur
33 la couleur mêlée avec le fondant, afin de les 3) broyer enfemble, la couleur paroîtra, en
! 3> l’ employant, d’un bleu aufli fort & aufli
3> approchant de celui qu’ elle aura, après être
33 pàrfondue , qu’en pourra le défirer ; ces bleus 3) qu’on ajoute à l’eau, fe brûlant au fe u , ne
33 font aucun tort au fond de la couleur bleue
33 du c o fa l t , parce qu’ ils font brûlés avant que 3> le cobalt & le fondant foient eh fufion.
» Il y a encore un autre moyen de donner >3 un grand éclat à ces bleus : ç’eft de mettre
33 avec le fondant & le cobalt, partie égale ou
>3 même jufqu’à deux fois autant que l’on a mis
» de cobalt, d’ un très-beau bleu d’azur que l’on
» vend à Paris fous le nom de bleu d’argent 7
» quoiqu’ il n’en foit pas t ir é , mais du cobalt
» dont il p’eft qu’une préparation faite avec
| foin;
EMA
*. foin ; cet azur fe vend à Paris un écu le
»: gros. Il faut feulement avoir attention d’a-
» jouter un poids égal de fondant au poids que
9 l’on a mis vis-a-vis d’une partie de cobalt.
* Ce mélange préfentç à l’emploi une couléur
» bleue lumfante ; il fond très bien à tous les
» feu x , 8c fait fur l’émail un bleu aufli bril-
» lanr. que-le plus bel ourremer.
» Si Ion s’apperçoit que le bleu de cobalt
» vienne a^ rougir en le gardant, c’éft une
» preuve qu il contient encore trop d’acide ni- j
» treux ; dans ce cas on le remet dans l’eau ,
® comme on a déjà fait ; on change l’eau deux
9 ou trois fois ; après l’avoir fait fécher,
*• on l’expofe de nouveau fur un teffon dans
» les charbons ardents 3ï.
Remarques fu r le bleu tiré du cobalt. «
[ I l n’étoitpas difficile de tirer du cobalt la matière
qui donne la couleur bleue dans la vitrifie
çation ; les bleus de finale ou d’azur font très-
communs & très-faciles à faire ; mais il falloit
ici non-feulement tirer du cobalt la matière qui
donne le b leu , mais encore qu’ elle eût cette
couleur bleue, fans qu’elle'fût entrée en vitrification
, afin que le peintre ne pût pas s’y tromper
& en fende les effets. Il falloit en même
temps que la couleur pût s’employer avec facili
té , & qu’elle fe mîtaifsment en fufion ; ces
deux qualités ne fe trouvoienr point dans le bleii
d’azur ;on ne pouvoit l’employer aifément, parce
que ce n’eft qu’une vitrification, 8c qu’on ne peut
peindre avec du v erre, quelque peine que l ’on
ait p.rife à le broyer. La quantité de fondant
qu’on tentoit d’y ajouter, pouvoit le rendre plus
fufible ; mais ce n’étoit toujours que du verre
qu’on y mettoit -de plus , qui d’ ailleurs n’ayarnt
point de couleur lui-même , diminuoit prodi-
gieufement l'a couleur bleue de l’azur.
La couleur bleue que fournit le cobalt, qui
eft fi belle & fi fine quand une fois elle eft entrée
en vitrification , eft très-volatile ; & il eft
facile de la perdre avant qu’elle y foit entrée.
Henckel, fo r a Saturn. traduc. Franc, p , *q <$
dit que lorfqu’on vitrifie du cobalt, on a quelquefois
du noir au lieu du bleu , 8c même que la
couleur difparoît tout-a-fait fi l’on calcine trop
la mine. Il eft donc néceffaire qu’ il foit refté un
peu d’arfenic dans la mine après qu’elle a été
calcinée. Lorfque la mine eft calcinéeàce point,
on la mêle avec de l ’alkali fixe & de la matière
vitrifiaMe', pour, en mettant le tout en fonte
en tirçr un verre bleu dont on fait l’azur ; il paraît
que , dans cette opération , il faut que l’alkali
rixe fe foit mis en fufion avant que le feu ait
étéaffiez fort pour enlever la terre q u i, jointe à
l?arfenic qui refte, fournit la couleur bleue; il
faut donc que cette terre ait une grande affinité
*Y€c l’alkali fix e , paifque le feu , ncceffaire à la
Beaux-Arts. Tome II.
E M A . ÿ 2$
vitrification de toute la compofitîon , ne l’enleve
plus, & que l’alkali fixe qui lui fert de moyen
d union avec la matière vitrifiable, la porte dans
cette matière en même temps qu’il la met en
fufion.
En fuiyant ce raifonnement, il paroît qu’ il
faudrait employer l’alkali fixé pour avoir la
couleur bleue du cobalt ; mais il eft néceffaire
que cette couleur foit féohe pour pouvoir être
employée ; & ia lkali fixe eft non-feulement fuf-
ceptible de l’ humidité de l ’a ir, mais fi l’on tentoit
de l ’édulcorer , il s’en irait tout entier dans
1 edulcoratiop , & il n’en relierait rien d’attaché
an cobalt qui pût développer (à couleur bleue;
il falloit donc trouver moyen de joindre la couleur
don née par le cobalt à une bafe que l’eau ne
put point diffoudre, & emporter par les édulcorations
; le fel marin a paru d’aurant plus propre,
a remplir ces conditions , que perfoune n’ ignore
que fa bafé eft alkaline ; & d’ ailleurs , qu’en fe
joignant aux autres acides , lorfqti’ elie en trouve,
elle forme des mixtes, qui par-là devienneng
beaucoup plus fufibles. On va voir cependant
qu il eft abfolumenc néceffaire qu’après les différentes
diffolutions, évaporations, & c . que l ’oa
eft obligé de faire pour parvenir à la couleur de-
firée , il refte encore un peu d’acide nitreux dant
la couleur.
ÿ > après avoir diflout du cobalt par l ’acide dir
nitre, avoir évapore la diffolution à f i c c i t é &
I avoir édulcorée , on met fur ce réfidu de l’acide
du fël marin , la diffolution'qui fe fera fera verre
parce que ce cobalt ne contient plus d’acide nitreux.
En effet, fi l'on ajoute tanrfoit peu décide
du nitre fur l’efprit de fel , il fi> fait une eku ré-
gale qui rend la diffolution rouge ; & comme on
a vu dans les manipulations précédentes, qu«
pour avoir une couleur bleue dans le réfidu 1 il
falloit qu’ il fût rouge quand , en dernier lieu
on l’éxpofe au feu au milieu des charbons ardens
; il faut donc que dans ce temps-là il y
refte encore un peu d’acide nitreux pour que le
phlogiftique des charbons puiffe lui donner la
couleur bleue.
C ’eftfur ce principe que l’on fe.fonde; lorA
que , par malheur, on a pouffé l’évaporation d*
l’acide nitreux trop loin , on voit que la couleur
du réfidu ne devient pas bleue dans les charbons
ardens; on en eft quitte alors pour mettre d«
nouveau de ftefprit de nitre & de l’ eau fur ce
réfidu , jufqu’à ce qu’ il foit entièrement diflout
& il faut recommencer l ’évaporation 8c les déifications
de la matière , comme on a fait la première
fois , en fui vaut ce qui eft décrit dans le*
manipulations ; il faut même moins de temps 8c
de déifications dans cette fécondé opération qu«
dans la première, pour amener le réfidu au poing
où il doit être, c’cft-à-dire, pour qu’il ne fe
diffolve pas dans l’eau dans laquelle on l ’éd.ul*