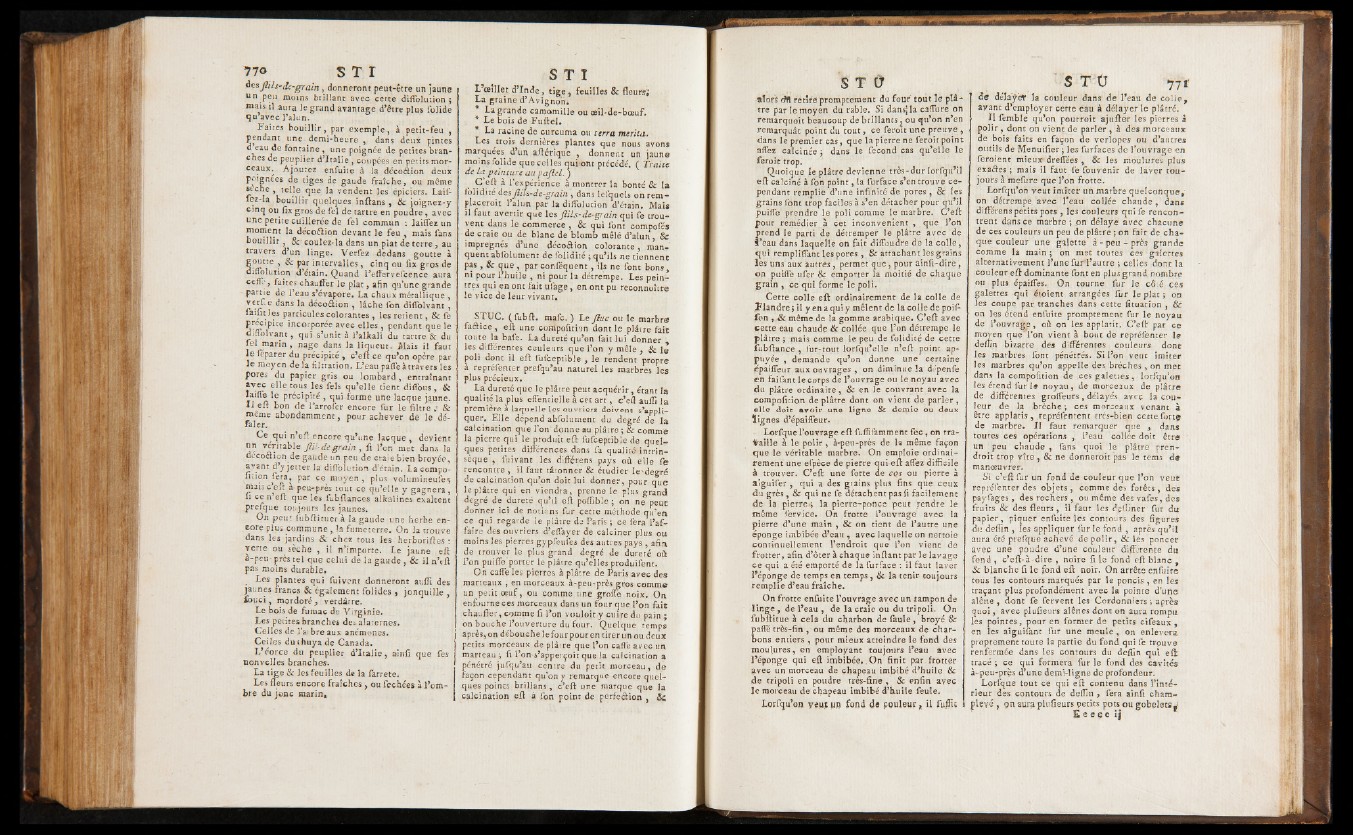
des Jiils-de-gr a in , donneront peut-être lin jaune
un peu moins brillant avec cette diffolution;
»nais il aura le grand avantage d’être plus folide
qu avec l’alun.
Faites bouillir, par exemple., à petit-feu ,
pendant une demi-heure , dans deux pintes
d eau de fontaine, une poignée de petites branches
de peuplier d’Italie , coupées en petits morceaux.
Ajoutez enfuite à la décoéiion deux
^!>1rîneeS t^ es Saude friche t ou même
sèche , telle que la vendent les épiciers. Laif-
lez-la bouillir quelques inftans , & joignez-y
cinq ou fix gros de fel de tartre en poudre, avec
une petite cuillerée de fel commun : laiflez un
moment la décoéiion devant le feu , mais fans
bouillir , &- eoulez-la dans un plat de terre, au
travers d’un linge. Verfez dedans goutte à
goutte , & par intervalles , cinq ou fix gros de
diffolution d’etain. Quand l’ effervefcence aura
-ccfïe, faites chauffer le plat, afin qu’une grande
partie de l ’eau s’évapore. La chaux métallique ,
verffe dans la décoéiion , lâche fon diffolvant ,
faiut les particules colorantes , les retient, & fe
précipité incorporée avec elles , pendant que le
diffolvant, qui s’ unit à l’alkali du tartre & du
fel marin , nage dans la liqueur. Mais il faut
le féparer du précipité , c’eft ce qu’on opère par
le moyen delà filtration. L’eau paffe à travers les
pores du papier gris ou lombard, entraînant
avec elle tous les fels qu’elle tient diffous, &
Iaiff© le précipité , qui-forme une lacque j.aune.
Il eft bon de l’arrofer encore fur le filtre ,T &
meme abondamment, pour achever de le délai
er.
Ce qui n’eft encore qu’une lacque, devient
en véritable Jiil-degrain , fi l’on met dans la
décoéiion de gaude un peu de craie bien broyée,
avant d’y jetter la diffolution d’étain. La compo-
fition fera, par ce moyen , plus volumineufe*;
maisc eft a-peu-près tout ce qu’elle y gagnera,
fi ce n’ elt que les fubftances alkalines exaltent
prefqne toujours les jaunes.
On peut fubftituerà la gaude une herbe encore
plus commune , la fumeterre. On la trouve
dans les jardins & chez tous les herboriftes :
verte ou seche , il n’importe. Le jaune eft
à-peu-près tel que celui de la gaude , & il n’eft
pas moins durable.
Les plantes qui fuivent donneront au {fi des
jaunes francs & également folides , jonquille ,
iouci, mordoré , verdâtre.
Le bois de fumac de Virginie.
Les petites branches des alaternes.
Celles de l’arbre aux anémones.
Ceiles du thuya dç Canada.
L’ éorce du peuplier d’Italie, ainfi que fes
nonvclles branches.
La tige & les feuilles de la {arrête.
Les fleurs encore fraîches, ou fechées à l’ombre
du jonc marin.
L’oeillet d’Inde, tige , feuilles & fleurs*
La graine d’Avignon.
La grande camomille ou oeil-de-boeuf.
* Le bois de Fuftel.
La racine de curcuma ou terra mérita.
Les trois dernières plantes que nous avons
marquées d’un a/lerique , donnent un jaune
moins folide que celles qui*oïu précédé. ( Traite
de La peinture au pajiel. )
, C eft à l’expérience à montrer la bonté & la
folidité des Jlils-de-grain , dans lefquels on rem-
placeroit l’alun par la diffolution d’étain. Mais
il faut avertir que les Jiils-de-gr ain qui fe trouvent
dans le commerce , & qui font compofës
de craie ou de blanc de blomb mêlé d’alun &
imprégnés d’une décoéiion colorante, manquent
abfolument de folidité ; qu’ils ne tiennent
pas , & que , par conféquent , ils ne font bons,
ni pour l’huile , ni pour la détrempe. Les peintres
qui en ont fait ulàge, en ont pu reconnoîtrç
le vice de leur vivant.
STUC. ( fubft. mafe. ) Le Jluc ou le marbrtf
faélice, efl une compofition dont le plâtre fait
toute la bafe. La dureté qu’on fait lui donner ,
les différentes couleurs que l’on y mêle , & le
poli dont il efl: fufceptible , le rendent propre
à représenter prefqu’au naturel les marbres les
plus précieux.
La duretc que Je plâtre peut acquérir, étant la
qualité la plus effentielle à cet art, c’eft auflï la
première à laquelle les ouvriers doivent s’appliquer,
Elle dépend abfolument du degré de la
calcination que l’on donne au plâtre; & comme
la pierre qui le produit efl fufceptible de quelques
petites différences dans fa qualité intrinsèque
, fuivant les diffêrens pays où elle fe
rencontre , il faut tâtonner & étudier le'degré
de calcination qu’on doit lui donner, pour que
le plâtre qui en viendra, prenne le plus grand
degré de dureté qu’il efl poflible ; on ne peut
donner ici de notions fur cette méthode qu’en
ce qui regarde le plâtre de Paris ; ce fera l’affaire
des ouvriers d’effayer de calciner plus ou
moins les pierres gypfeufes des autres pays , afin
de trouver le plus grand degré de dureté où
l’on puiffe porter le plâtre qu’elles produifent.
On caffe les pierres à plâtre de Paris avec des
marteaux , en morceaux à-peu-près gros comme
un petit oeuf, ou comme une groffe noix. On
enfourne ces morceaux dans un four que l’on fait
chauffer, comme fi l’on vouloir y cuire du pain 5
on bouche l’ouverture du four. Quelque temps
1 après, on débouche lefourpour en tirer un ou deux
petits morceaux de plâtre que l’on cafte avec un
marteau; fi l’ons’apperçoit que la calcination a
pénétré jufqu’au centre du petit morceau, de
façon cependant qu’on y remarque encore quelques
points brillans, c’ eft une marque que la
calcination efl à fon point de perfection , &
*1or$ retiré promptement du four tout le plâtre
par le moyen du râble. Si- dans) la caffure on
remarquoit beaucoup de brillants , ou qu’on n’ en
remarquât point du tout, ce feroit une preuve ,
dans le premier cas, que la pierre ne feroit point
affez calcinée ; dans le fécond cas qu’ elle le
feroit trop.
Quoique le plâtre devienne très-dur lorfqu’il
efl calciné à fon point, la furface s’en trouve cependant
remplie d’une infinité de pores , & les
grains font trop faciles à s’en détacher pour qu’il
puiffe prendre le poli comme le marbre. C’eft
pour remédier à cet inconvénient , que l’on
prend le parti de détremper le plâtre ayec de
ï ’eau dans laquelle on fait diffoudre de la colle,
qui rempliffant les pores , & attachant les grains
les uns aux autres , permet que , pour ainfi-dirë,
on puiffe ufer & emporter la moitié de chaque
grain , ce qui forme le poli.
Cette colle efl ordinairement de la colle de
Flandre ; il y en a qui y mêlent de la colle de poif-
fon même de la gomme arabique. C’eft avec
cette eau chaude & collée que l’on détrempe le
plâtre ; mais comme le peu de folidité de cette
fubftance , fur-tout lorfqu’elle n’eft point appuyée
, demande qu’on donne une certaine
^paiffeur aux ouvrages , on diminue la dépenfe
en faifant le corps de l’ouvrage ou le noyau avec
du plâtre ordinaire, & en le couvrant avec la
compoficion de plâtre dont on vient de parler ,
elle doit avoir une ligne & demie ou deux
lignes d’épaiffeur.
Lorfque l’ouvrage efl fuffifamment fec, on travaille
à le polir, à-peu-près de la même façon
que le véritable marbre. On emploie ordinairement
une efpèce de pierre qui-eft affez difficile
à trouver. C’eft une forte de c q s ou pierre à
alguifer , qui a des grains plus fins que ceux
du grès, & qui ne fe détachent pas fi facilement
de la pierre*; la pierre-ponce peut pendre le
même fervice. On frotte l’ouvrage avec la
pierre d’une main , & on tient de l’autre une
éponge imbibée d’eau , avec laquelle on nettoie
continuellement l’endroit que l’on vient de
frotter, afin d’ôter à chaque inftant par le lavage
ce qui a été emporté de la furfa.ee : il faut laver
l’éponge de temps en temps, & la tenir toujours
remplie d’eau fraîche.
On frotte enfuite l’ouvrage avec un tampon de
linge , de l’eau , de la craie ou du tripoli. On
fubftitue à cela du charbon de faule, broyé &
paffé très-fin , ou même des morceaux de charbons
entiers , pour mieux atteindre le fond des
moulures, en employant toujours l’eau avec
l’éponge qui eft imbibée,, On finit par. frotter
avec un morceau de chapeau imbibé d’huile &
de tripoli en poudre très-fine , & enfin avec
Je morceau de chapeau imbibé d’huile feule.
Lorfqu’on veut un fond couleur, il fufflç
de délayer la couleur dans de l’eau de colle9
avant d’employer cette eau à délayer le plâtré.
Il femble qu’on pourroit ajufter les pierres à
polir , dont on vient de parler , à de* morceaux
de bois faits en façon de verlopes ou d’autres
outils de Menuifier ; les furfaces de fouvrage en
feroient mieux* dreffées , & les moulures plus
exaéïes ; mais il faut fe Convenir de laver toujours
à mefure que l’on frotte.
Lorfqu’on veut imiter un marbre quelconque,
on détrempe avec l’eau collée chaude, dans
diftérens petits pots , les couleurs qui fe rencontrent
dans ce marbre ; _on délaye avec chacune
de ces couleurs un peu de plâtre ; on fait de chaque
couleur une galette à-peu-près grande
comme la main; on met toutes ces galettes
alternativement l’une fur'l’autre ; celles dont la
couleur eft dominante font en plus grand nombre
ou plus épaiffes.. On tourne fur le cô:é ces
galettes qui étoient arrangées fur le plat ; on
les coupe par tranches dans cette fituarion , &
on les étend enfuite promptement fur le noyau
de l’ouvrage, où on les applatit, C’eft par ce
moyen queTon vient à bout de repréfenter le
deffin bizarre des differentes couleurs dont
les marbres font pénétrés. Si l’on veut imiter
les marbres qu’on appelle des brèches , on met
dans la compofition de ,ces galettes, lorfqu’on
les étend fur 1« noyau, de morceaux de plâtre
de differentes groffeurs, délayés avec la couleur
de la brèche; ces morceaux venant à
être applaris , re,préfentent très-bien cette fortç
de marbre. Il faut remarquer que , dans
toutes ces opérations , l’eau collée doit être
un peu chaude , fans quoi le plâtre prendront
trop vîte , & ne donneroit pas le tems de
manoeuvrer.
Si c’eft fur un fond de couleur que l’on veut
repréfenter des objets , comme des forêts , des
payfages , des rochers , ou même des vafes, des
fruits & des fleurs, il faut les dgffiner fur du
papier, piquer enfuite Ife's contours des figures
du deffin , les appliquer fur le fond , après qu’il
aura été prefque achevé de polir, & lés poncer
avec une poudre d’une couleur différente du
fond , c’eft-à-dire , noire fi le fond eft blanc ,
& blanche fi le fond eft noir. On arrête enfuite
tous les contours marqués par le poncis, en les
traçant plus profondément avec la pointe d’une
alêne, dont fe fervent les Cordonniers; après
quoi, avec plufieurs alênes dont on aura rompu
les pointes, pour en former de petits cifeaux ,
en les aiguifant fur une meule, on enlever®
proprement toute la partie du fond qui fe trouve
renfermée dans les contours du deflin qui eft
tracé ; ce qui formera fur le fond des cavités
à-peu-près d’une demi-ligne de profondeur.
Lorfque tout ce qui eft contenu dans l’intérieur
des contours de deffin , fera ainfi chara-
pleyé , on aura plufieurs petits pots ou gobelets jl
£ e c c e i j