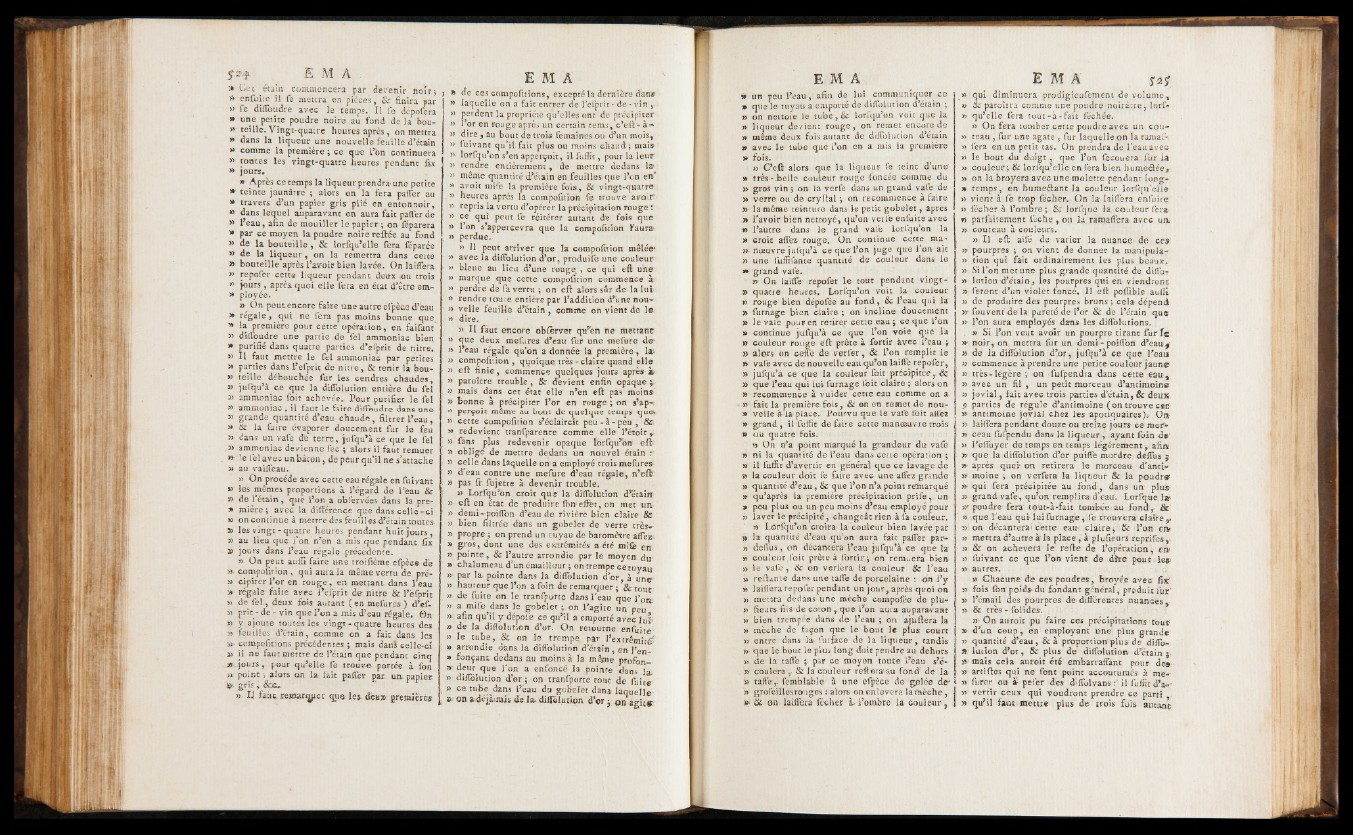
E MA .
» Cec étajn commencera par devenir noir;
* enfuite il fe mettra en pièces, & finira par
» fe diffoudre avec le temps. I l 1e dépofera
* une petite poudre noire au fond de la bou-
» teille. Vingt-quatre heures après , on mettra
» dans la liqueur une nouvelle feuille d’étain
» comme la première ; ce que l’on continuera
« tontes les vingt-quatre heures pendant ftx 1
» jours»
» Après ce temps la liqueur prendra une petite
» teinte jaunâtre ; alors on la fera paffer au
» travers d’un papier g.ris plié en entonnoir,
» dans lequel auparavant on aura fait palfer de
» l’eau, afin de mouiller le papier ; on féparera
* par ce moyen la poudre noire retirée au fond
» de la bouteille , & lorfqu’elle fera féparée
» de la liqueur , on la remettra dans cette
» bouteille ajJrès l’avoir bien lavée. On laiffera.
» repofer cette liqueur pendant deux ou trois
» jours , après, quoi elle fera en état d’être env^
» ployée,
» On peutencore faire une autre efpèce d’eau
» régale , qui ne fera pas moins bonne que
* la première pour cette opération., en faifant
» diffoudre une partie de fol ammoniac bien
* purifié dans quatre parties d’efprit de nitre,
» I l faut mettre le fol ammoniac par petites
» parties dans L’ efprit de nitre, & tenir la feou-
» teille débouchée for les cendres chaudes,
» jufqu’ à c.e que la diffolution entière du fel
» ammoniac foit achevée.. Pour purifier le fel
» ammoniac , il faut le faire diffoudre dans une
» grande quantité d’ eau chaude, filtrer l’ eau,
» & la faire évaporer doucement fur le feu
» dans un vafe dfe terre, j-ufqu’ à ce que le fel
ammonjac devienne foc ; alors il faut remuer
»- îe fel avec un bâton, de peur qu’il ne s’attache
» au vaiffeau.
>5 On procède avec cette eaurégale en fuivant
» les mêmes proportions à l’égard de l ’eau &
» de l’étain, que l’on a obfervées dans la pre-
* mière ; avec la différence que dans celle -c i
» on continue à mettre des feuilles d’ etain toutes
53 les vingt-quatre heures pendant huit jours,
» au lieu que i’bn n’en a mis que pendant fix
p jours dans l’eau régale précédente.
» On peut aufii faire une troifième efpèce dè
»• compofition , qui aura la même vertu de pré-
» cipirerl’or en rougre, en mettant dans l’eau
» régale faite avec refprit de nitre & l’èfprit
» de fo l, deux fois autant (en melurés) d’ef-
» prit - de - vin que l’on a mis d’eau régale. 0n
» y ajoute toutes les vingt-quatre heures des
» feuilles d’érain, comme on a fait dans les
» ccmpofitions précédentes ; mais dans celle-ci :
» il ne faut mettre de l’étain que pendant cinq
» jours, pour qu’ elle fe trouve portée à fon
». point -, alors on la. fait paffer par. un. papier:
g» grir., &rc..
». II. faut remarquer que. les-deux- premières
E M A
j » de ces compofitions, excepté la dernière dans
» laquelle on a fait entrer de l ’efprit - de- vin ,,
w perdent la propriété qu’elles ont de précipiter
» l ’or en rouge après un certain tems, c’eft-à-»
» dire , au bout de trois lèmaiires ou d’ un mois,
» fuivant qu’ il.fait plus ou moins chaud; mais
lorfqu’on s’en apperçoit, il- fuffit, pour la- leur
» rendre entièrement, de mettre dedans las
» même quantité d’étain en feuilles que l’on en*
» avoir mile la première fois, & vingt-quatre-
» heures après la compofition fe trouve avoir
» repris la vertu d’opérer la précipitation rouge î
» ce qui peut fe réitérer autant dë fois que
» l’on s’appercevra que la compofition l’aura
» perdue.
» Il peut arriver que la compofition mêlée*
» avec la diffolution d’or, produife une couleur
s » bleue au lieu d’une rouge,, ce qui eft une
» marque que certe compofition commence à
» perdre de fa vertu ; on eft alors sûr de la lu i
■ » rendre tosure entière par l’addition d’ une nou-
- » velle feuille d’etain, comme on vient de le
, » dire.
» II faut encore obferver qu’ en ne mettant
» que deux mefares d’eau fur- une •meftire dek
» 1 eau régale qu’on a donnée la première-, jt»
» compofition , quoique très-claire quand elle
• » eft fin ie , commence quelques jours après à)
» paroître trouble, 8c devient enfin opaque j,
, » mais dans cet état elle n’ en eft pas moins
» bonne à précipiter l’or en rouge ; on s’ap-r
» perçoit même au bout de quelque temps que?
» cette compofition s’éclaircit peu - à - peu , &
33 redevient tranfparente comme elle l’étoit r
» fans plus redevenir opaque Ibrfqu’on efo
» oblige de mettre dedans un nouvel étain v
» celle dans laquelle on a employé trois mefures-
» d’èau contre une mefure d’ eau régale, n’ effr
» pas fi fujette à- devenir trouble.
? » Lorfqufon croit que la diffolution d’étain-
» eft en état de produire Ibn eftët, on met un
» demi-poiflbn d’eau de rivière bien claire &
» bien filtrée dans un gobelet de verre très--
>3 propre ; on prend un tiuyau dë baromètre affez>
» gros, dont une des extrémités a-été mîfe en
» pointe, & l’autre arrondie par le moyen du
» chalumeau d’un émaillcmr ; on trempe ce tuyau
»• par la pointe dans la diffolution d’o r, à une
» hauteur que l’pn a foin de remarquer ; & tout
» de fuite on le tranfporte dans l'eau qu*- r ont
» a mife dans le gobelet ; on l ’agite un peu
afin qu’ il y dépofe ce qu’ il a emporté avec lu i
» de la diflolution d’or. On retourne enfuite
» le tube, & on le trempe par l’extrémité
» arrondie dans la diffolution d’éraîn, en l’en-
» fonçant dedans au moins à la même profon-
y» deur que l'on- a enfoncé la pointe dans la>
»- diffolution d’ér ; on tranfporte tout de fuite
» c e tube dans l’ eau du gobelet dana laquelle
»• on aidéjuuais de la* diffolution d’or ;; on agit#
E M A
» un peu l’ eau, afin de lui communiquer ce
» que le tuyau a emporte de diffolution d’etain ;
» on nettoie le tu b e ,& lorlqu’on voit que la
» liqueur devient rouge, on remet encore de
» même deux fois autant de diffolution d’etain
» avec le tube que l’on en a mis la première
» fois.
» C’eft alors que la liqueur fe teint d’une
» très-.belle couleur roug.e foncée comme du
» gros vin > on la verfe dans un grand vafe de
» verre ou de cryftal ; on recommence à faire
yy la même teinture dans le petit gobelet, après
» l’avoir bien nettoyé, qu’ on verfe enfuite avec
» l’autre dans le grand vafe lorfqu’on la
» croit affez- rouge. On continue cette ma-
» noeuvre jufqu’à ce que l’on juge que l ’on ait
» une fuffilante quantité de: couleur dans le
» grand vafe.
» On laifïe repofer le tout pendant vingt-
» quatre heures. Lorfqu’on voit la couleur
» rouge bien dépofée au fond, & l’eau qui la
» fumage bien claire ; on incline doucement
» le vafe pour en retirer cette eau ; .ce que l’on
» continue jufqu’à ce que l’on vôie que la
w couleur rouge eft prête à forcir àvec l’eau ;•
» alors ôn çeffe de verfer, & l’on remplit le
» vafe avec de nouvelle eau qu’on laiffe repofer,
» jufqu’à ce que la couleur foit précipitée,. &
» que l’ eau qui lui fumage lbit claire ; alors on
» recommence à vuider cetie eau comme on afait
la première fois , & on en remet de nou-
» velle à la place. Pourvu que le vafe foit affez
» grand, il fuffit de faire cette manoeuvre trois
» ou quatre fois.
» On n’a point marqué la grandeur du- vafe
» ni la quantité de l’eau dans cette opération ;
» il fuffit d’avertir en général que ce lavage de
» la couleur doit fe faire avec une affez grande
» quantité d’ eau, & que l’on n’a point remarqué
» qu’après la première précipitation prife, un
» peu plus ou un-peu moins d’eau employé pour
» laver le précipité, changeât rien à fa couleur.
» Lorfqu’on croira la couleur bien lavée par
» la quantité d-’eau qu’en aura fait paffer par-
» deffus, on décantera l’eau jufqu’ à ce que la
» couleur foit prête à fortir,; on remuera bien
» le vafo , & on verfera- la couleur & l ’eau
» reliante dans une taffo de porcelaine : on l’y
» laifiëra repofer pendant un joury après quoi on
» mettra dedans une mèche compofée de plu-
» fieurs fiis de coton , que l’on aura auparavant
» bien trempée dans de l ’eau ; on a-juftera la
» mèche de façon que le bout le plus court
» entre dans la furface de la liqueur, tandis
»> que le bout le plus long doit pendre au dehors
» de la. taffe ; par ce moyen toute l’èau s’ë-
»' coulera , & la couleur reliera au fond de la
» taffey femblable à une efpèce de gelée de*
» grofeillesrouges : alors on enlevera la mèche ,
» & on laiffera lécher à- l’ombre la couleur ,
E M A y a ;
» qui diminuera prodigieufement de volume,
» 8c paroîtra comme une poudre noirâtre, lorf-
n qu’elle fera tou t-à -fa it féchée.
» On fera tomber certe poudre avec un cou-
» teau , fur une agate , fur laquelle on la ramaf-
» fera en un petit tas. On prendra de l'eauavec
» le bout du d o ig t, que l’on fecouera fur la
» couleur; & lorfqu’elle en fera bien humeélée*
» on la broyera avec une molette pendant long-
» temps, en humeélant la couleur lorfqu’clie
» vient à Ce trop fécher-. On la-laiffera eni’uïte
» fécher à l’ombre ; & lorfq.ue la couleur fera
« parfaitement leche , on la ramaffera avec un.
» couteau à couleurs.
» Il eft aifé de varier la nuance de ce»
» pourpres ; on vient de donner la manipula-
; » tion qui fait ordinairement les plus beaux,
i » Si l ’on mec une plus grande quantité de diflor
» Iutïon d’étain, les pourpres qui en viendront
» feront d’un violet foncé. Il eft poflible auffi
» de produire des pourpres bruns ; cela dépend
» fouvent de la pureté de l’or & de l’étain qu®
, » l’on aura employés dans les diffolutions. » Si l’on veut avoir un pourpre tirant fur f« »■ noir, on mettra fur un demi - poifibn d’eau *
» de la diffolution d’or, jufqu’ à ce que l'eau
» commence à prendre une petite couleur jaune
» très-légère ; on fufpendra dans cette e a u ,
» avec un fil , un petit morceau d’antimoine
» jo v ia l, fait avec trois parties d’étain, & deux
$ parties de régule d’antimoine (on trouve c e t
» antimoine jovial chez les âpotiq.uaires). O a
» laiffera pendant douze ou treize jours ce mor1*
f » ceau fûfpendu dans la liqueur, ayant foin de
» l 'èffuyer de temps en temps légèrement, afia
» que la diffolution d’or puiffe mordre dëffus 5
» après quoi- on retirera le morceau d’anti-
» moine ; on verfera la liqueur & la poudrtf
» qui fera précipitée au fon d , dans un plu»
» grand vafe , qu’on remplira d’eau. Lorfque la*
» poudre fera tout-à-fair tombée ; au fond , &
» que l'eau qui lui fumage ,;fe trouvera claire
»' on décantera» cette eau claire j & l’on erv
» mettra d’autre à la place, à plufieurs reprifes ,
» & on achèvera le retire de l ’opération, e»
» fuivant ce que l’on vient de dire pour le#
» autres.
» Chacune de ces poudres, Broyée avec fijt
» fois fon poids-du fondant général, produit fur
» l ’émail des pourpres de différentes nuances,
» & très - fol ides.
» On auroit pu faire ces précipiratïons fout
» d’ un coup, en employant une plus grande
» quantité a’eau, & à proportion plu» de diffo-
»• lution d?o r , & plus de diffolution d’etain *
mais cela auroit été embarraffant pour de»
» artiftes qui ne font point accoutumés à me»
1 » furer ou à- peler dès diffolvans il fuffit d’ a--
J y> vërtir ceux qui voudront prendre ce parti •
1 » qu’ il faut mettre plus de trois fois autant