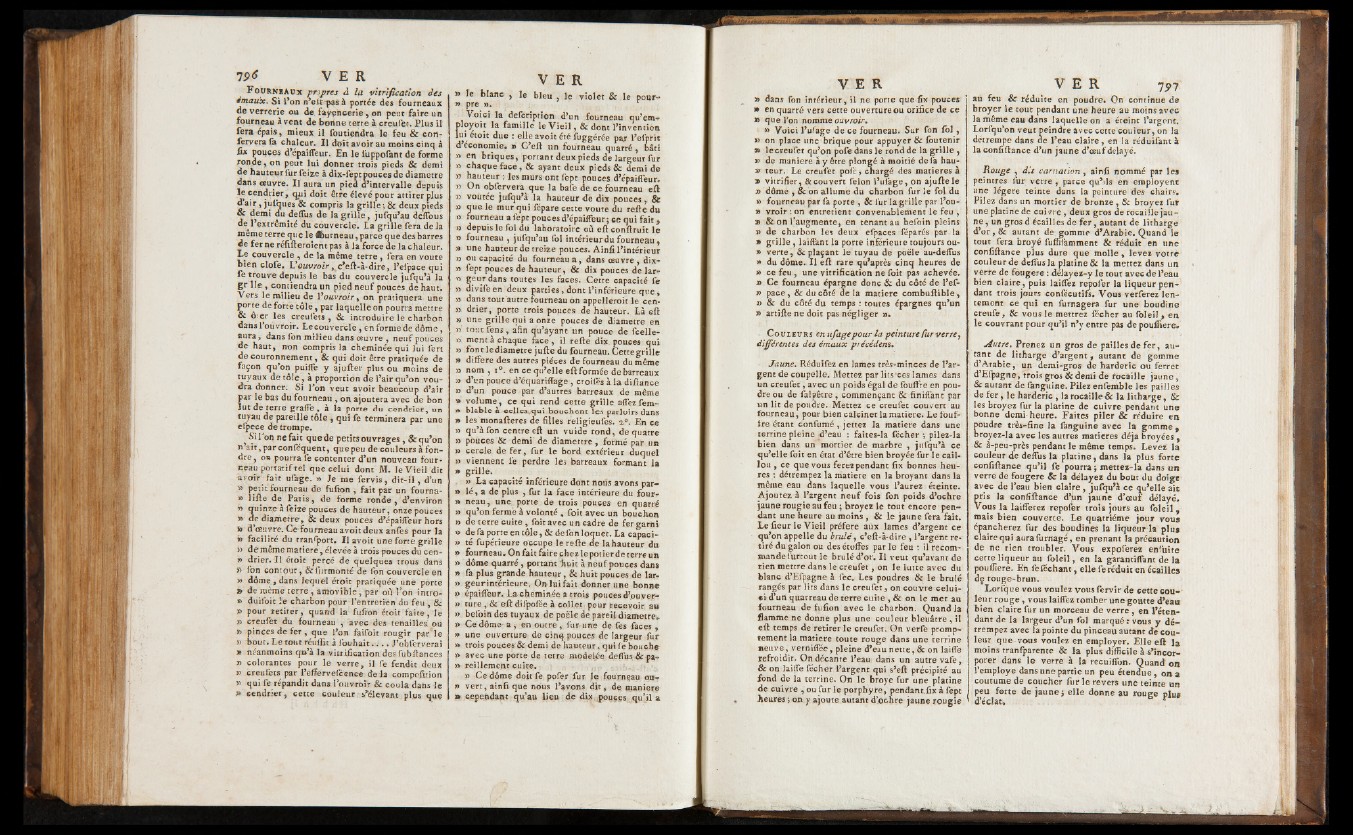
F ourneaux propres â la vitrification des
émaux. Si l’on n’etr pas à portée des fourneaux
de verrerie ou de. fayehcerie, on peut faire un
fourneau à vent de borine terre à creufet. Plus il
fera épais, mieux i l fou tiendra le feu & con-
fervera fa chaleur. I l dort avoir au moins cinq à
fix pouces d’épaiffeur. En le luppofant de forme :
ronde, on peut lui donner trois pieds & demi
de hauteur fur feize à dix-fept pouces de diamètre
dans oeuvre. I l aura un pied d’ intervalle depuis
, ®endrier , qui doit être élevé pour attirer plus
d’a ir , julques & compris la grille ; & deux pieds
& demi du delTus de la g r ille , jufqu’au deffous
de l’extrémité du couvercle. La grille fera delà
même terre que le dburneau, parce que des barres
de fer ne réfifteroient pas à la force de la chaleur.
Le couvercle , de la même terre , fera en voûte
bien clofe. Vouvroir ^c’eft-à-dire, l’elpace qui
fe trouve depuis le bas du couvercle jufqu’à la
g r l i e , contiendra un pied neuf pouces de haut.
Vers le milieu de Vouvroir t on pratiquera une
porte de forte tô le , par laquelle on pourra mettre
& o:er les creufets , & introduire le charbon
dans 1 oüvroir. Lecouvercle , en forme de dôme,
aura, dans fon milieu dans oeuvre , neuf pouces
de haut, non compris la cheminée qui lui fert
de couronnement, & qui doit être pratiquée de
façon qu’on puiftè y ajufler plus ou moins de
tuyaux de tôle , à proportion de l’air qu’on voudra
donner. Si l ’on veut avoir beaucoup d’air !
par le bas du fourneau , on ajoutera avec de bon
lut de terre graffe , à la porte du cendrier, un
tuyau de pareille tôle , qui fe terminera par une
efpece de trompe.
S il on ne fait que de petits ouvrages , & qu’ on
i» ait, par conféquent, que peu de couleurs à fondre,
os pourra le contenter d’ un nouveau fourneau
portatif tel que celui dont M. le V ie il dit
avoir fait ulage. » Je me fervis, d i t - i l , d’un
» petit fourneau de fufton , fait par un fourna-
» lifte de P a iis , de forme ronde , d’environ
» quinze à feize pouces de hauteur, onze pouces
» de diamètre, & deux pouces d’épaifleur hors
ï» d’oeuvre. C e fourneau avoit deux anfes pour la
» facilité du transport. I l avoit une forte grillé
» de même matière, élevée à trois pouces du cen-
» drier. I l étoit percé de quelques trous dans
$ fon contour, &furmonté de fon couvercle en
» dôme, dans lequel étoit pratiquée une porté
a de meme terre , amovible, par où l ’on intro-
» duifoit îe charbon pour rentretien du feu , &
» pour retirer , quand la fufton étoit faite , l e
» creufet du fourneau , avec des tenailles: ou
*> pinces de fe r , que l’on faifoit rougir par le
» bour. Le tout réufRt à fouhait . i . . J’ofiferverai
» néanmoins q»’à la vitrification des fubftances
» colorantes pour le verre, il fe fendit deux
» creufets par l’effervefcence de là compofition
» qui fe répandit dans l’ouvroir & coula dans le
» cendrier, cette couleur, s’élevant plus que
» le blanc , le bleu , le violet & le pour-
» pre ».
Voici la defcnption d’ un fourneau qu’em-
ployoit la famille le V i e i l , & dont l’ invention
lui étoit due : elle avoit été fuggérée par l’efprit
d’économie. » G’ eft un fourneau quarré, bâti
» en briques, portant deux pieds de largeur fur
» chaque face , & ayant deux pieds & demi de
» hauteur : les murs ont fept pouces d’épaifieur.
» On obfervera que la bafe de ce fourneau eft
» voûtée jufqu’à la hauteur de dix pouces, &
» que le mur qui fépare cette voûte du refté du
» fourneau a fept pouces d’épaiffèur ; ce qui fait,
» depuis le fol du laboratoire où eft conftruit le
» fourneau , jufqu’au fol intérieur du fourneau,
» une hauteur de treize pouces. Ainfi l’ intérieur
» ou capacité du fourneau a , dans oeuvre , dix-
» fept pouces de hauteur, & dix pouces de lar-
» geurdans toutes les faces. Cette capacité fe
» divifeen deux parties, dont l ’inférieure que «
» dans tout autre fourneau on appelleroit le cen-
» drier, porte trois pouces de hauteur. Là eft
» une grille qui a onze pouces de diamètre en
» tout fens, afin qu’ayant un pouce de fcelle-
» ment a chaque fa ce , il refte dix pouces qui
» font le diamètre jufte du fourneau. Cette grille
» différé des autres pièces de fourneau du même
» nom , i° . en ce qu’elle eft formée de barreaux
» d’un pouce d’équariflage, croifés à la diftance
» d’un pouce par d’autres barreaux de même
» volume, ce qui rend cette grille aflez fem~
» blable à celles^qui bouchent les parloirs dans
» les monafteres de filles religieufes. z°. En ce
» qu’à fon centre eft un vuide rond, de quatre
» pouces & demi de diamettre, formé par un
» cercle de fe r , fur le bord extérieur duquel
» viennent le perdre les barreaux formant la
» grille.
, » La capacité inférieure dont nous avons par-
» lé , a de plus , fur la face intérieure du four-
» neau, une porte de trois pouces en quarré
» qu’on ferme à volonté , foit avec un bouchon
» de terre cuite , foit avec un cadre de fer garni
»> de fa porte en tôle, & de fon loquet. La capaci-
» té fupérieure occupe le refte de lahauteur du
» fourneau. On fait faire phez le potier de terre un
» dôme quarré , portant huit à neuf pouces dans
» fa plus grande hauteur, & huit pouces de lar-
» geurintérieure. On lui fait donner une bonne
P épaiffeur. La cheminée a trois pouces d’ouver-
» ture, & eû difpofée à collçt, pour recevoir au
» befoin des tuyaux de poêle de pareil diamètres
» Ce dôme' a * en outre, fur-une de les faces ,
» une ouverture de cinq pouces de largeur fur
» trois pouces & demi de hauteur, qui fe bouche
» avec une porte de terre modelée deffus & pa-
» reillement cuite.
» Ce dôme doit fe pofer fur le fourneau ou-
» vert, ainfi que nous l’avons d it, dp, maniéré
» cependant qu’au lieu de dix pouces qu’il a
» dans fon intérieur, il ne porte que fix pouces
» en quarré vers cette ouverture ou orifice de ce
» que l’on nomme ouvroir.
» Voici l’ ufage de ce fourneau. Sur fon l o i ,
» on place une brique pour appuyer & foutenir
» le creufet qu’on pofe dans le rond de la grille ,
» de maniéré à y être plongé à moitié de fa hau-
» teur. Le creufet pofé * chargé des matières à
» vitrifier,.& cou vert félon l’ufage, on ajuftele
» dôme , & on allume du charbon fur le fol du
» fourneau par fa porte , & lur la grille par l’ou-
» vroir : on entretient convenablement le feu ,
» & on l’augmente, en tenant au befoin pleins
» de charbon les deux efpaces féparés par la
» grille , laiflant la porte inférieure toujours ou-
» verte, & plaçant le tuyau de poêle au-deffus
» du dôme. I l eft rare qu’après cinq heures de
» ce feu , une vitrification ne foit pas achevée.
jo Ce fourneau épargne donc & du côté de l’ef-
» pace, & du côté d elà matière combuftible,
» & du côté du temps : toutes épargnes qu’ un
» artifte ne doit pas négliger ».
C o u l e u r s enufage pour la peinture fur verre,
différentes des émaux précédent
Jaune. Réduifez en lames très-minces de l ’argent
de coupelle. Mettez par lits*ces lames dans
un creufet , avec un poids égal de fouffre en poudre
ou de falpêtre, commençant & Unifiant par
un lit de poudre. Mettez ce creufet couvert au
fourneau, pour bien calciner la matière. Le fouffre
étant confumé, jettez la matière dans une
terrine pleine d’ eau : faites-la fécher -, pilez-la
bien dans un mortier de marbre , jufqu’à ce
qu’elle foit en état d’être bien broyée fur le caillou
, ce que vous ferez pendant fix bonnes heures
: détrempez la matière en la broyant dans la
même eau dans laquelle vous l’aurez éteinte.
Ajoutez à l’argent neuf fois fon poids d’ochre
jaune roùgie au feu ; broyez le tout encore pendant
une heure au moins , & le jaune fera fait.
Le fieur le V ieil préféré aux lames d’argent ce
qu’on appelle du brûlé, c*eft-à-dire , l’argent retiré
du galon ou des étoffes par le feu : il recommande
l'urtout le brûlé d’or. Il veut qu’avant de
rien mettre dans le creufet, on le lutte avec du
blanc d’Efpagne â fec. Les poudres & le brûlé
rangés par lits dans le creufet, on couvre celui-
ci d’un quarreau de terre cuite , & on le met au
fourneau de fufton avec le charbon. Quand la
flamme ne donne plus une couleur bleuâtre , il
eft temps de retirer le creufet: On verfe promptement
la matière toute rouge dans une terrine
neuve, vernifféc, pleine d’ eau nette, & on laifle
refroidir. On décante l’eau dans un autre vafe,
& on laifle fécher l’argent qui s’eft précipité au
fond de la terrine. On le broyé fur une platine
de cuivré , ou fur le porphyre, pendantfixà fept
heures ; on y ajoute autant d’ochre jaune rougie
aù feu & réduite en poudre. On continue ds
broyer le tout pendant une heure au moins avec
la même eau dans laquelle on a éteint l’argent.
Lorfqu’on veut peindre avec cette couleur, on la
détrempe dans de l’eau claire, en la réduifant à
la confiftance d’un jaune d’oeuf délayé.
Rouge , dit carnation, ainfi nommé par les
peintres fur verre, parce qu’ ils en employent
une légère teinte dans la peinture des chairs.
Pilez dans un mortier de bronze, & broyez fut
une platine de cuivre , deux gros de rocaille jaune
, un gros d écailles de fer, autant de litharge
d’or, & autant de gomme d’Arabie. Quand le
tout fera broyé fuffifamment & réduit en une
confiftance plus dure que molle, levez votre
couleur de deffus la platine & la mettez dans un
verre de fougere : délayez-y le tout avec de l’eau
bien claire , puis laiflez repofer la liqueur pendant
trois jours confëcutifs. Vous verferez lentement
ce qui en furnagera fur une boudiné
creufe, & vous le mettrez fécher au foleil > en
le couvrant pour qu’il n’y entre pas de pouiliere»
Autre. Prenez un gros de pailles de fer, autant
de litharge d’argent t autant de gomme
d’Arabie, un demi-gros de harderic ou ferrec
d’Efpagne , trois gros & demi de rocaille jaune,
& autant de fànguine. Pilez enlemble les pailles
de fer, le harderic, la rocaille& la litharge, &
les broyez fur la platine de cuivre pendant une
bonne demi-heure. Faites piler & réduire en
poudre très-fine la ianguine avec la gomme f
broyez-la avec les autres matières déjà broyées ,
& à-peu-près pendant le même temps. Levez la
couleur de defius la platine, dans la plus forte
confiftance qu’il fe pourra ; mettez-la dans un
verre de fougere & la délayez du bout du doigt
avec de l’eau bien claire, jufqu’à ce qu’elle ait
pris la confiftance d’jün jaune d’oeuf délayé.
Vous la laiflerez repofer trois jours au foleil,
mais bien couverte. Le quatrième jour vous
épancherez fur des boudinés la liqueur la plus
claire qui aurafurnagé, en prenant la précaution
de ne rien troubler. Vous expoferez enfuite
cette liqueur au foleil, en la garantiflant de la
pouffiere. En leféchant, elle fe réduit en écailles
de rouge-brun.
Lorfque vous voulez vous fervirde cette couleur
rouge, vous laiflez tomber une goutte d’eau
bien claire fur un morceau de verre, en l’étendant
de la largeur d’un fol marquer vous y détrempez
avec la pointe du pinceau autant de couleur
que vous voulez en employer. Elle eft la
moins tranfparente & la plus difficile à s’incorporer
dans le verre à la recuiffon. Quand on
l’employe dans une partie un peu étendue, on a
coutume de coucher fur le revers une teinte un
peu forte de jaune; elle donne au rouge plus
d’éclat. r