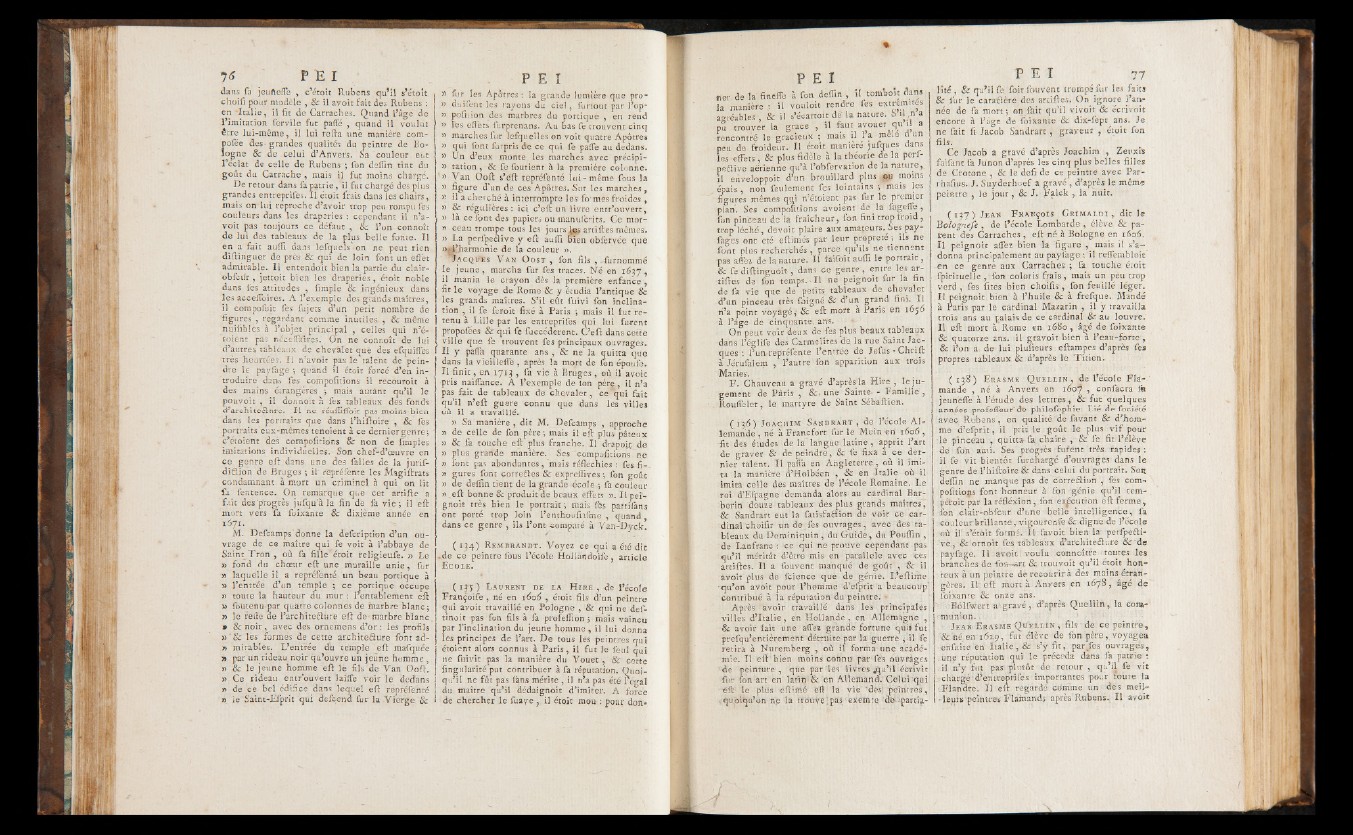
16 P E I
dans fa jeuficfle , c’étoit Rubens qu’ il s’étoit
choifi pour modèle , 8c il avoir fait des Rubens :
en ‘I ta lie , il fit de Carraches. Quand l’âge de
l ’imitation fervile fut paffé , quand il voulut
être lui-même, il lui refia une manière com-
pofée des- grandes qualités du peintre de Bologne
& de celui d’Anvers. Sa couleur eut
l ’éclat de celle de Rubens ; fon deflin tint du
goût du Carrache , mais il fut moins chargé.
De retour dans fa patrie, il fut chargé des plus
grandes entreprifes. II.ëtoit frais dans les chairs,
mais on lui reproche d’avoir trop peu rompu fes
couleurs dans les draperies : cependant il n’a-
voit pas toujours ce défaut , & l ’on connoît
de lui des tableaux de la plus belle fonte. Il
en a fait aufli dans lefquels on ne peut rien
diftinguer de près 8c qui de loin font un effet
admirable. Il entendoic bien la partie du clair-
obfcifr , jettoit bien les draperies, étoit noble
dans les attitudes , fimple & ingénieux dans
les accefîbiies. A l ’exemple des grands maîtres,
il compofûic fes fa jet-s d’ un petit nombre de
figures , regardant comme inutiles. , 8c même
rmifibles à l’objet principal , celles qui n’é-
toient pas ncceflaires. On ne connoîc de lui
d’autres tableaux de cheVâlet que des efquiffes
très heurtées. I l n’avait pas le talent de peindre
le payfage -, quand il étoit forcé d’en introduire
dans fes compofition s il recouroit à
des mains étrangères ; mais autant qu’ il le
pouvoit , il donnoit à fes tableaux des fonds
d’architeélnre. I l ne réufïifToit pas moins bien
dans les portraits que dans l’hiftoire , & fes
portraits eux-mêmes tenoient à ce dernier genre;
c’étoient des compofitions 8c non de fimpies
imitations individuelles. Son chef-d’oeuvre en
ce genre qft.dans une des falles de la jurif-
didion de Bruges ; il' rë'préfente les Magiftrats
condamnant à mort un criminel à qui on lit
fa fentence. On remarque que cet artifte a
fait dés progrès jufqu’à la fin dé fa vie ; il eft
mort vers fa foixante 8c dixième année en
1671.
M. Defcamps donne la defeription d’un ouvrage
de ce maître qui fe voit à l’abbaye de
Saint Tron , où fa fille'étoit religieufe. » Le
» fond du choeur eft une muraille unie, fur
» laquelle il a repréfenté un beau portique à
» l’entrée d’un temple ; ce portique occupe
» toute la hauteur du mur : rentablement eft
» foütenu-par quatre colonnes de marbre blanc;
» lé refte de l’architedûre eft de-marbre blanc
9 8c noir, avec des ornemens d’or : les profils
» "& lés formes de cette architedure font âd-
» mirablés. L’entrée du temple eft mafquee
» par un rideau, noir qu’ouvre un jeune homme
» 8c le jeune homme eft le fils de Van Ooft.
» Ce rideau entr’oüvert laide voir le dedans
» de ce bel édifice dans lequel eft repréfeihté
» le S’aint-Efprit qui defeena fur la Vierge &
P E I
» fur les Apôtres : la grande lumière que pro-
>> duifent-les rayons du c ie l , furtout par l’op-
» pofition des marbres du portique , en rend
» les effets furprenans. Au bas fe trouvent cinq
» marches fur lefquelles on voit quatre Apôtres
w cIui f°nt furpris dë ce qui fe paffe au dedans.
» Un d’eux monte les marches avec précipi-
» tation, 8c fe foutient à la première colonne.
'» Van Ooft s’eft repréfenté lui-même fous la
» figure d*un de ces Apôtres. Sur les marches,
» il a cherché à interrompre les fo mes froides ,
» & régulières : ici c’eft un livre entr’ouvert,
» là ce l’ont des papiers ou manulcrits. Ce mor-
» ceau trompe tous les jours ^ artiftes mêmes.
» La perlpedïve y eft aufii Bien obfervée que
»«^harmonie de la couleur ».
Jacques V an Oost , fon fils , -fiirnommé
le jeune, marcha fur fes traces. Né en. 1637,
il mania le crayon dès la première enfance,
fit le voyage de Rome 8c y étudia l’antique &
les grands maîtres. S’ il eût fuivi fon inclination
, il fe feroit fixé à Paris ; mais il fut re-
| tenu à Lille par les entreprifes qui lui furent
I propofées & qui fc fuccéderent. C’eft dans cette
l v ille que fe trouvent fes principaux ouvrages,
j II y paffa quarante ans , & ne la quitta que
dans la vieillefle , après la mort de fon époufe.
Il fin it, en 1713 , fa vie à Bruges , ©ù il a voie
pris naiffance. A l’exemple de ion père, il n’a
pas fait de tableaux de chevalet , ce*qui fait
qu’il n’eft guere connu que dans les villes
où il a travaillé.
» Sa manière , dit M. Defcamps , approche
» de celle de fon père; mais if eft plus pâteux
» & fa touche eft plus franche. Il drapoft de
» plus grande manière. Ses "compofitions ne
» fent pas abondantes, mais réfléchies : fes fi-_
» gures font correéles 8c expreflives ; fon goût
» de deflin tient de la grande école ; fa couleur
»..eft bonne & produit de beaux effets ». I l peignoir
très bien le portrait ; mais fes parti fan s
ont porté trop loin l’enthoufnfme , quand,
dans ce genre, ils l’ont -comparé à Van-Dyck.
( 134) Rembrandt. Voyez ce qui a été dit
.de ce peintre lous l’école Hollàndoife, article
Ecole.
( i ^j ) Laurent de la Hi r e , dë l’école
Françoife , né en 1606 , étoit fils d’un peintre
qui avoit travaillé en Pologne , & qui ne def-
tinoit pas fon fils à fa profeffion ; mais vaincu
par l’inclination du jeune homme , il lui donna
les principes de l’art. De tous les peintres qui
étoient alors connus à Paris, il fut le feul qui
ne fuivit pas la manière du V o u e t, 8c cette
Angularité put contribuer à fa réputation. Quoiqu’
il ne fût pas fans mérite , il n’a pas été régal
du maître qu’ il dédaignait d’imiter. A force
de chercher le fuave, il étoit mou : pour don-
P E I
«er de la fineffe à fon deflin , il tomboït dans
la manière : il vouloir rendre fes. extrémités
agréables , & il s’écartoit de' la nature. î> il n a
pu trouver la grâce , il faut avouer ou il a
rencontré le gracieux ; mais il 1 a mêle d un
peu de froideur. Il étoit maniéré jufques dans
les effets, & plus fidèle à la théorie de la perl-
peélive aerienne qu’à l’obfervation de la nature,,
il enveloppoit d’ un brouillard plus |qu moins
r épais , non feulement fes lointains ; mais les
figures mêmes qui n’étoient pas fur le premier
plan. Ses compofitions avoient de la fagefle,
fon pinceau de la fraîcheur, fon fini trop froid,
trop léché, dëvoit plaire aux amateurs.^Ses pay-
fages ont été eftimés par leur propreté ; ils ne
font plus recherchés , parce qu’ ils ne tiennent
pas aflez de la nature. I l faifoit aufli le portrait,
& fe diftinguûit, dans ce genre, entre les artiftes
de fon temps. '1 1 ne peignoit fur la fin
de fa vie que de petits tableaux de chevalet
d’ un pinceau très foi g né & d’ un grand fini, d
ri’a point v o y a g é e f t mort à Paris en 1056
à l ’âge de cinquante, ans. *
On peut voir deux dé fes plus beaux tableaux
dans l’églife dés Carmélites de la rue Saint Jacques;
l’un-repréfenté l’entrée de Jefus-Chrift
à Jérufalem , l ’autre fon apparition aux trois
Maries.
F. Chauveau a gravé d’après la Hire , le jugement
de Pâris , une Sainte- - Famille ,
. Rouflelet, le martyre de. Saint Sébaftien.
( 1 3 6 ) Joachim Sandrart , de l ’école A llemande
, né à Francfort fur le Mein en 1606 ,
fit des études de la~ langue la tine, apprit l’ art .
de gravêr 8c de peindre, 8c fe fixa à ce der- ,
nier talent. Il paffa en Angleterre , où il imita
la manière d’Holbéen , & en Italie où il-
imita celle des maîtres de l’école Romaine. Le
roi d’Efpagne demanda alors au cardinal Bar-
berin douze tableaux des plus grands maîtres,
& Sandrart eut la fatisfa&ion de voir ce cardinal
choifir ün de^fès ouvragés , avec dés tableaux
du Dominiquin, du Guide, du Pouflin ,
de Lan franc : ce qui ne prouvé cependant pas
qu’ il méritât d’ être mis en parallèle avec :cës
artiftes. Il a fouvent manqué de goût , & il
avoit plus dë feienee què de génie. L’éftithe
•qu’on avoit pour l’homme dvefpfit a beaucoup*
contribué à la réputation du peintre.1 -
Après avoir travaillé dans les principales ;
villes d’ Italie, en Hollande, en Allemagne ,
& avoir fait une affé* grande fortune qüil futi
prefqu’ entièrement détruite par la guerre ; il fe
retira à Nuremberg , où il forma une académie.
Il eft bien moins connu parfës oùyfàges.
de peinture , qüe par les livres iqu’ iî écrivit
fur fomàrt ën latin!'& en Allemand.'Cëlïri'qui
éft le plus eftirrié eft la vie ’ dés! peintres ,
- quoiqu’on n.e la tiouŸeïpas (è3Éémre dë ipartia-
P E I 77
Hté , 8c qu’ il fe foiî fouvent trompé fur les faits
& lur le caractère des artiftes. On^ ignore l’ année
de fa mort ; oh ftit qu’il vivoit 8c ecrivoit
encore à l’âge de foixante & dix-fept ans. Je
ne fait fi Jacob Sandrart , grayeur , étoit fon
fils. | K
Ce Jacob a gravé d’après Joachim , Zeuxrs
faifant fa Junon d’après les cinq plus belles filles
de Crotone , & le défi de ce peintre avec Par-
rhafius. J. Suyderhoef a gravé , d’après le même
peintre , le jour, 8c J. Falck ,J a nuit.
( 1 3 7 ) Jean F rançois Grimaldi ,. dit le
Bologneje , de l’école Lombarde , élève 8c parent
des Carraches , eft né à Bologne en 1606.
I l peignoit aflez bien la figure , mais il s’adonna
principalement au payfage : il reflembloit
en ce genre aux Carraches ; fa touche étoit
fpirituelle , fon coloris frais, mais un peu trop
verd , fes fîtes bien choifis , fon feuillé léger.
Il peignoit bien à l’huile & à frefque. Mandé
à Paris par le cardinal Mazarin , il y travailla
trois ans au palais de ce cardinal 8c au louvre.
Il eft mort à Rome en 1680, âgé de foixante
& quatorze ans. il gravoit bien à l’eau-forte",
& l’ on a de lui plufieursveftampes d’après fes
propres tableaux & d’après le Titien.
( 138) Erasme Quellin , de l’école Flamande
, né à Anvers en 160^., confacra fe
jeunefle" à l’étude des lettres., & fut quelques
années profefleur'de philofophie: Lié de fociété
avec Riibens, en qualité de favant & d’homme
d’ efprit, il prit le goût le plus ;v i f pour
le pinceau , quitta-fa .chaire ,\& le fit l’élève
de fon ami. Ses progrès furent très, rapides ;
il fe vit bientôt furchargé d’ouvrages dans le
genre de l’hiftoire 8c dans celui du portrait. Soit
deflin ne manque pas dé correction , fes com-
pofitioçs font honneur à fon génie qu’il tem-
pélroit par la réflexion, fon e^cution eft ferme,
fon clair-obfcur d’ une belle intelligence,. fa
couleur brillante y vigoufeufe & digne de Péeqle
-où i f s’ëtôit formé. Il favoit bien la perfpeéli-
ve , & ?ornoit fes, tableaux d’architeéture & de
payfage. I l avoit; voulu connoître -toutes les
branches de fos^r-t & trouvoit qu’ il étoit honteux
à un peintre dé recourir à des mains étrangères.
IL e ft mort it Anvers en 1678, âgé de
foixante 8c onze ans.
’ Bolfwert a'-gravé, d’ après Q u e llin , la cora-
■ munion., ■ ■ 1
Jean» Erasme Quellin , fils • de ce peintre,
'Sc 'hé en ■ 162.0, fut élève de fon'père, voyagea
-ertfiiite en I ta lie , & s’y fit, par/es ouvragés,
.. ùfie réputation qui le précéda dans fa patrie :
1 il n’y fut pas plutôt de retour , qu’ il -fe vit
{ chargé'd?encreprifes importantes pour toute la
^Flandre. I l eft regardé comme un des meil-
-leurs pelpu^s Flâinands après Rubens.: Il avait