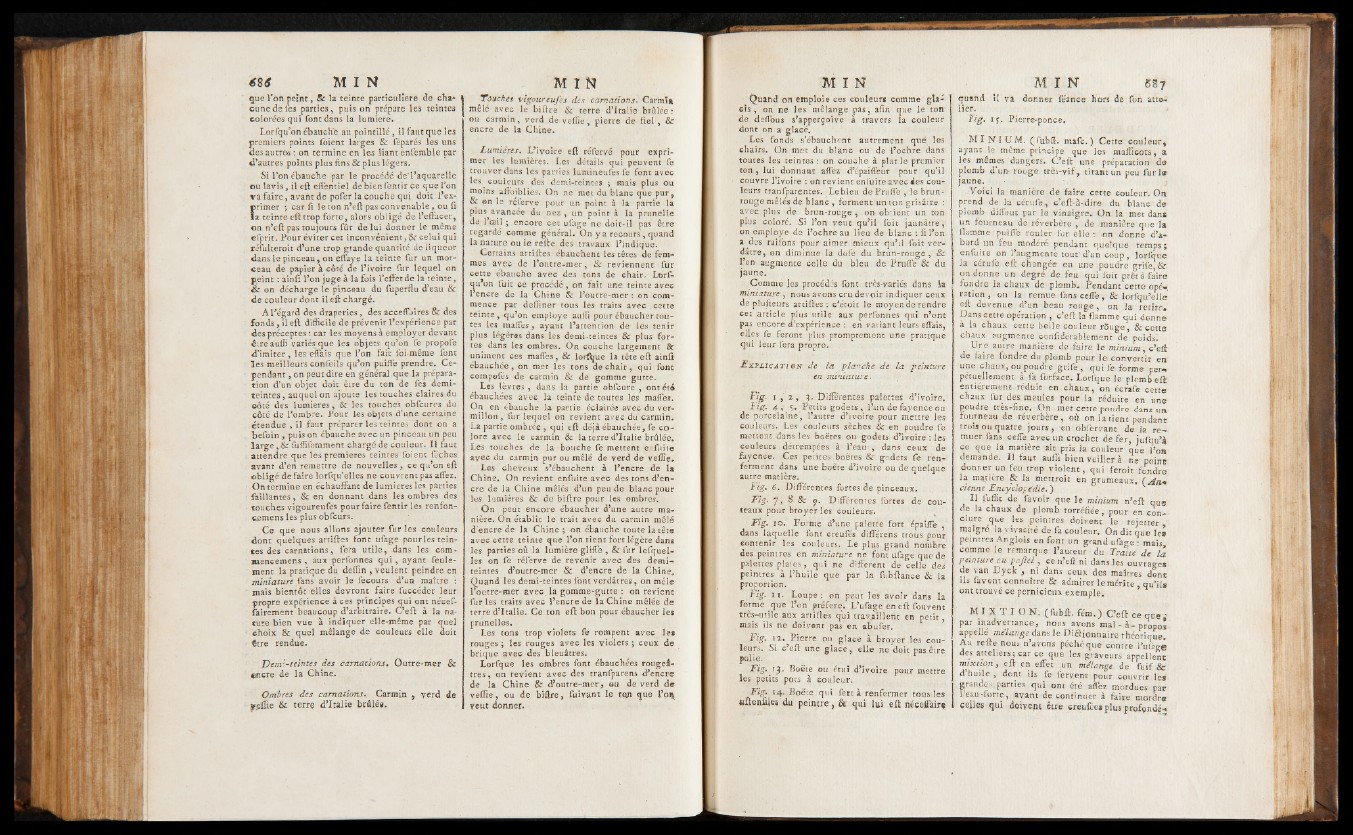
que Ton peint, & la teinte particulière de cha*
cune de Tes parties , puis on prépare les teintes
colorées qui font dans la lumière.
Lorfqu’on ébauche au pointillé, il faut que les
premiers points loient larges & féparés les uns
des autres : on termine en les liant enlemble par
d’autres points plus fins & plus légers.
Si l ’on ébauche par le procédé de'l’aquarelle
ou la v is , il eft effentiel de bien fentir ce que l’on
va faire, avant de pofer la couche qui doit l’exr
rimer •, car fi le ton n’ eft pas convenable, ou fi
a teinte eft trop forte, alors obligé de l’effacer,
on n’eft pas toujours fûr de lui donner le même
efprit. Pour éviter cet inconvénient,& celui qui
réfulteroit d’ une trop grande quantité de liqueur
dans le pinceau, on effaye la teinte fur un morceau
de papier à côté de l’ ivoire fur lequel on
peint : ainfi l’on juge à la fois l’effet de la teinte,
& on décharge le pinceau du fuperflu d’eau &
de couleur dont il eft chargé.
A l’égard des draperies, des acceffoires & des
fonds, il eft difficile de prévenir l’expérience par
des préceptes : car les moyens à employer devant
être auffi variés que les objets qu’on fe propofe
d’imiter, les effais que l’on fait foi-même font
les meilleurs confeils qu’on puifle prendre. Cependant
, on peut dire en général que la préparation
d’un objet doit être du ton de fes demi-
teintes , auquel on ajoute les touches claires du
coté des lumières, & -les touches obfcures du
côté de l’ombre. Pour les objets d’une certaine
étendue , il faut préparer les teintes dont on a
befoin , puis on ébauche avec un pinceau un peu
large ,& fuffifamment chargé de couleur. Il faut
attendre que les premières teintes foient féches
avant d’en remettre de nouvelles , ce qu’on eft
obligé défaire lorfqu’elles ne couvrent pas affez.
On termine en échauffant de lumières les parties
faillantes, & en donnant dans les ombres des
touches vigoureufes pour faire fentir les renfon-
cemens les plus obfcurs.
Ce que nous allons ajouter fur les couleurs
dont quelques artiftes font ufage pour les teintes
des carnations, fera utile, dans les com-
mencemens , aux perfonnes q u i , ayant feulement
la pratique du deffin , veulent peindre en miniature fans avoir le fecours d’un maître :
mais bientôt elles devront faire fuccéder leur
propre expérience à ces principes qui ont néçef-
fairement beaucoup d’arbitraire. C’ eft à la nature
bien vue à indiquer elle-même par quel
choix & quel mélange de couleurs elle doit
être rendue.
Verni-teintes des carnations. Outre-mer &
encre de la Chine.
Ombres des carnations. Carmin , verd de
jf,eftie & terre d?Italie brâlée.
Touches vigoureufes des carnations. Carmin
mêlé avec le biftre & terre d’ Italie brûlée:
ou carmin, verd de veffie, pierre de f ie l , &
encre de la Chine.
Lumières. L’ ivoire eft réfervé pour exprimer
les lumières. Les détails qui peuvent fe
trouver dans les parties lumineufesfe font avec
les couleurs des demi-teintes ; mais plus ou
moins aftoiblies. On ne met du blanc que pur,
& en le rélerve pour un point à la partie la
plus avancée du nez , un point à la prunelle
de l’oeil ; encore cet ufage ne doit-il pas être
regardé comme général. On y a recours, quand
la nature ou le refte des travaux l ’indique.
Certains artiftes ébauchent les têtes de femmes
avec de l’outre-mer, & reviennent fur
cette ébauche avec des tons de chair. Lorfi»
qu on fuit ce procédé, on fait une teinte avec
l’encre de la Chine & l’outre-mer : on commence
par deffiner tous les traits avec cette
teinte, qu’on employé aulli pour ébaucher toutes
les maffes, ayant l ’attention de- les tenir
plus légères dans les demi-teintes & plus fortes
dans les ombres. On couche largement &
uniment ces maffes, & lorftjue la tête eft ainfi
ébauchée, on met les tons de chair, qui font
compefés de carmin 8c de gomme gutte.
Les lèvres , dans la partie obfcure , ont été
ébauchées avec la teinte de toutes les maffes.
On en ébauche la partie éclairée avec du v,er-
millon, fur lequel on revient avec du carpiin.
La partie ombrée , qui eft déjà ébauchée, fe colore
avec le carmin & la terre d’Italie brûlée.
Les touches de la bouche fe mettent enfuite
avec du carmin pur ou mêlé de verd de veffie.
Les cheveux s’ébauchent à l’encre de la
Chine. On revient enfuite avec des tons d’encre
de la Chine mêlés d’ un peu de blanc pour
les lumières & de biftre pour les ombres.
On peut encore ébaucher d’une autre manière.
On établit le trait avec du carmin mêlé
d'encre de la Chine; on ébauche toute la tête
avec cette teinte que l’on tient fort légère dans
les parties où la lumière gliffe , & lur lefquel-
les on fe réferve de revenir avec des demi-
teintes d’outre-mer & d’encre de la Chine.
Quand les demi-teintes font verdâtres, on mêle
l ’outre-mer avec la gomme-gutte : on revient
fur les traits avec l’ encre de la Chine mêlée de
terre d’Italie. Ce ton eft bon pour ébaucher les
prunelles.
Les tons trop violets fe rompent avec les
rouges ; les rouges avec les violets ; ceux de
brique avec des bleuâtres.
Lorfque les ombres font ébauchées rougeâtres
, on revient avec des tranfparens d’ encre
de la Chine & d’outre-mer, ou de verd d©
veflie, ou de biftre, fuivant le ton que l’o^
veut donner.
Quand on emploie ces couleurs comme glacis
, on ne les mélange pas, afin que le ton
de deffous s’apperçoive à travers la couleur
dont on a glacé.
Les fonds s’ébauchent autrement que les
chairs. On met du blanc ou' de l’ ochre dans
toutes les teintes : on couche à plat le premier
ton , lui donnant affez d’épaiffeur pour qu’il
couvre l’ivoire : on revient enfuite avec des couleurs
tranfparentes. Lebleu dePruffe , le brun-
rouge mêlés de blanc , forment un ton grisâtre :
avec plus de brun-rouge , on obtient un ton
plus coloré. Si l’on veut qu’ il foie jaunâtre,
on employé de l ’ochre au lieu de blanc : fi l’on
a des raifons pour aimer mieux qu’ il foit verdâtre,
on diminue la dofe du brun-rouge , &
l ’on augmente celle du bleu de Pruffe & du
jaune.
Comme les procédés font très-variés dans la
miniature , nous avons cru devoir indiquer ceux
de plusieurs artiftes: c’étoit le moyen de rendre
cet article plus utile aux perfonnes qui n’ont
pas encore d’expérience : en variant leurs effais,
ellesxfe feront plus promptement une pratique
qüi leur fera propre.
Explicati @n de la planche en miniature ■ de la peinture
Fig. i 2 , 3. Différentes palettes d’ivoire.'
Fig. 4 y 5. Petits godets , l’ un de fayence ou
de porcelaine, l’autre d’ ivoire pour mettre les
couleurs. Les-couleurs sèches & en poudre fe
mettent dans les boëtes ou godets d’ ivoire : les
couleurs détrempées à l’eau , dans ceux de
fayence. Ces petites boëtes & godets fe renferment
dans une boëte d’ ivoire ou de quelque
autre matière.
Fig. 6. Différentes fortes de pinceaux.
Fig. 7 , 8 & Différen tes fortes de couteaux
pour broyer les couleurs.
Fig. 10. Forme d’ une palette fort épaiffe
dans laquelle font creufés différens trous pour
contenir les couleurs. Le plus grand nombre
des peintres en miniature ne font ufage que de
palettes plaies, qui ne different de celle des
peintres à l ’huile que par la fubftance & la
proportion.
Fig. 11. Loupe : on peut les avoir dans la
forme que l’on préféré. L’ufage en eft fouvent
très-utile aux artiftes qui travaillent en p etit,
mais ils ne doivent pas en abufer.
Fig. la . Pierre ou glace à broyer les couleurs.
Si c’eft une gla ce , elle ne doit pas être
polie.
Fig. \3* Boëte ou étui d’ivoire pour mettre
les petits pots à couleur.
Fig. 14, Boëte qui ferc à renfermer tous les
*ïftenfijes du peintre, & qui lui eft néçeffairq
quand 11 va donner féance hors de fon atto-
iier.
ï ig . i j . Pierre-ponce.
M I N I UM . ( fubft. mafe. ) Cette couleur,
ayant le même principe que les mafficots, a
les mêmes dangers. C’eft une préparation d©
plomb d’un- rouge très-vif, tirant un peu fu r ie
jaune.
Voici la manière de faire cette couleur. On
prend de. la cerufe, c’eft-à-dire du blanc de
plomb diffout par le vinaigre. On la met dans
un fourneau de réverbère , de manière que la
flamme puiffe rouler fur elle :■ on donne d’abord
un feu modéré pendant quelque temps ;
enfuite on l’augmente tout' d’un coup, lorfque
la cérufe eft changée en une poudre grife, &.
on donne un degré de feu qui foit prêt à faire
fondre la chaux de plomb. Pendant cette opération
, on la remue fans ceffe, & lorfqu’elle
eft devenue d’ un beau rouge, on la retire.
Dans cette opération , c’eft la fiamraéqui donne
à la chaux cette belle couleur rôuge, & cette
chaux augmente confidérablement de poids.
Ure autre manière de .faire le minium, c’eft
de faire fondre du plomb pour Je, convertir en
une chaux,ou poudre gr ife , qui fe forme per«,
pétuellement à fa furfacé. Lorfque le plomb eft:
entièrement réduit en chaux, on écrafe cette
chaux fur des. meules pour la réduire en une
poudre très-fine. On met cette poudre dans un
fourneau de réverbère, où on la tient pendant
trois ou quatre jours , en obiervant de la remuer
fans ceffe avec un crochet de fer, jufqu’ à
çe que la matière ait pris la couleur que l’on
demande. Il faut aiiffi bien veiller à ne point
donner un feu trop v iolent, qui feroit fondre
la matière & la mettrait en grumeaux. ( A n «
cienne Encyclopédie. )
U Suffit de favoir que le minium n’ efi: que
de la chaux de plomb torréfiée, pour en conclure
que les peintres doivent le reietter
malgré, la vivacité de fa couleur. On dit que les
peintres Anglois en font un grand ufage : mais,
comme le remarque l’auteur du Traite de la
peinture au p a jle l, ce n’ eft ni dans les ouvrages
de van Dy ck , ni dans ceux des maîtres dont
ils favent connoître & admirer le mérite , qu’ils
ont trouvé ce pernicieux exemple.
M I X T I O N. (fubft. fém.) C ’eft: ce q û e j
par inadvertance, nous avons m al-à -p ro p o s
appelle mélange dans le DiSionnaire théorique.
Au refte nous n’avons péché que contre l’utoeè
des atte lie z ; car ce que les graveurs appellent
mixtion, eft en effet un mélange de fuif &
d’h u i le , dont ils fe fervent pour couvrir le .
grandes,parties qui ont été affez mordues par
l’e'au -fo rteavant de continuer à faire mordra
celles qui doivent être ereufée» plus profonde